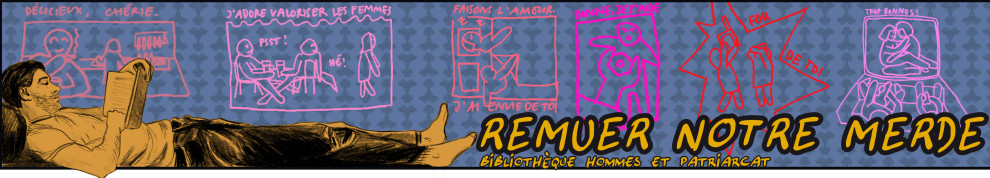…à votre équilibre psychique, votre autonomie, et la richesse de vos relations sociales
…à votre équilibre psychique, votre autonomie, et la richesse de vos relations sociales
Ce petit recueil propose quelques stimulations pour réfléchir à la question de l’amour, une contribution à un débat (à construire) afin de trier les choses de l’amour qui nous sont trop souvent présentées en kit : soit tu prends tout, soit la solitude éternelle te guette !
Publié par Infokiosques.net
noël 2010
PDF mis en page
PDF page par page
Nous ne sommes pas à l’origine de la première brochure « contre l’amour », parue il y a quelques années. Pourtant, nous avions envie de nous inscrire dans cette histoire.
… toujours contre l’amour, donc !
Parce qu’il appauvrit les possibles relationnels, écrasant tout sur son chemin si nous n’y prenons garde.
Ce petit recueil propose quelques stimulations pour réfléchir à la question, une contribution à un débat (à construire) afin de trier les choses de l’amour qui nous sont trop souvent présentées en kit : soit tu prends tout, soit la solitude éternelle te guette !
Pourtant nous voulons l’affection sans la jalousie, l’intensité sans la dépendance, les câlins sans l’exclusivité, les sexualités sans l’orientation et beaucoup plus encore. Cet encore que nous cherchons à saisir et à formuler, mais que l’emballage du kit (sous vide et dans un film opaque) nous empêche de voir. C’est bien ce qu’on dit : l’amour rend aveugle.
Bon… on a pris ce qui nous est venu, un peu comme ça, sans nous donner vraiment les moyens de dépasser les normes dominantes. C’est donc surtout hétéro, tout comme les images, histoires et représentations les plus visibles autour de nous. Mais nous savons aussi que les choses de l’amour peuvent être autres, et cela ne dispense pas de les questionner.
Minie and Moskowitz
1971, film de John Cassavetes
Titre français : Ainsi va l’amour
Minnie est jouée par Gena Rowlands
Minnie : You know, in movies it’s never like that. You know, I think that movies are a conspiracy. I mean it. I mean it, they are actually a conspiracy because they set you up, Florence. They set you up from the time you’re a little kid. They set you up to believe in everything. They set you up to believe in ideals and… and strength and good guys and romance… and of course love.
Love, Florence.
Minnie : Tu sais, au cinéma, ce n’est jamais comme ça. Tu sais, je crois que le cinéma, c’est une conspiration. Sérieux, je le pense. Et tu sais pourquoi ? Parce qu’il nous conditionne, Florence. Il nous conditionne depuis notre enfance. Il nous conditionne à gober n’importe quoi. Il veut nous faire croire à… à des idéaux et… et la virilité et les gars gentils et le romantisme… et biensûr, l’amour.
À l’amour, Florence.
Florence : Love ? (laughing)
Minnie : So, you believe it, right ? You go out, you start looking. Doesn’t happen, you keep looking. You get a job, like us, and you spend a lot of time fixing up things… your appartment and jazz… and… and you learn how to be feminin, you know, quotes « feminin », you learn how to cook… (laughing)
Florence : L’amour ? (elle rit)
Minnie : Et alors, on y croit, n’est-ce pas ? On sort, on cherche. Cela n’arrive pas, on continue à chercher. On prend un boulot, comme nous, et on passe un temps fou à bricoler des choses, un appartement et toutes ces conneries… et… et on apprend à être féminines, tu sais, « féminine » entre guillemets, on apprend à faire la cuisine… (elle rit)
There’s no Charles Boyer in my life, Florence, you know. I never even met a Charles Boyer. I never met Clark Gable, I never met Humphrey Bogart, I never… I never met any of them, you know who I am. I mean, they don’t exist, Florence, that’s the truth ! But the movies set you up, you know. They set you up, and no matter how bright you are, you believe it. And Florence, do you know that we are bright ?
No, I know that sounds silly, but… (laughing)
Florence, we’re geniusses compared to some of them… Isn’t it crazy ? Isn’t it crazy ? I mean, you go to the movies, and…
Il n’y a pas de Charles Boyer dans ma vie, tu sais Florence. Je n’ai même jamais rencontré de Charles Boyer. Je n’ai jamais rencontré Clark Gable, je n’ai jamais rencontré Humphrey Bogart, je n’ai jamais… Je n’ai jamais rencontré aucun d’eux. Tu sais qui je suis, Florence. Je veux dire, ils n’existent pas, Florence, voilà la vérité ! Mais le cinéma t’avait fait croire le contraire, tu sais. Il te conditionne, et peu importe que tu sois futée, tu marches. Et Florence, sais-tu que nous sommes futées, toutes les deux ?
Non, je sais que c’est idiot… (elle rit)
Florence, nous sommes des génies comparées à certaines. C’est pas dingue, ça ? C’est pas dingue, ça ? Je veux dire, on va au cinéma, et…
Pour ne pas vivre seul·e
1972, écrit par Sébastien Balasko et Daniel Fort,
interprété par Dalida
Pour ne pas vivre seul·e
On vit avec un chien
On vit avec des roses
ou avec une croix
Pour ne pas vivre seul·e
On s’fait du cinéma
On aime un souvenir
une ombre, n’importe quoi
Pour ne pas vivre seul·e
On vit pour le printemps
et quand le printemps meurt
pour le prochain printemps
Pour ne pas vivre seule
Je t’aime et je t’attends
pour avoir l’illusion
de ne pas vivre seule
de ne pas vivre seule
Pour ne pas vivre seules
des filles aiment des filles
et l’on voit des garçons
épouser des garçons
Pour ne pas vivre seul·e·s
D’autres font des enfants
des enfants qui sont seul·e·s
comme tous les enfants
Pour ne pas vivre seul·e
On fait des cathédrales
où tous ceux qui sont seuls
s’accrochent à une étoile
Pour ne pas vivre seule
Je t’aime et je t’attends
pour avoir l’illusion
de ne pas vivre seule
Pour ne pas vivre seul·e
On se fait des ami·e·s
et on les réunit
quand viennent les soirs d’ennui
On vit pour son argent
ses rêves, ses palaces
mais on n’a jamais fait
un cercueil à deux places
Pour ne pas vivre seule
Moi je vis avec toi
je suis seule avec toi
tu es seul avec moi
Pour ne pas vivre seul·e
On vit comme ceux qui veulent
se donner l’illusion
de ne pas vivre seul·e
Obsesión
2002, écrit par Anthony Santos,
interprété par Aventura
N°1 des ventes de disques pendant 7 semaines après sa sortie en France
Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada
Pensando en tu belleza y loco voy a parar
el insomnio es mi castigo
Tu amor será mi alivio
Y hasta que no seas mía no viviré en paz
Y conocí tu novio pequeño y no hermoso
Y sé que no te quiere por su forma de hablar
además tú no lo amas porque no da la talla
no sabe complacerte como lo haría yo
Pero tendré paciencia porque no es competencia
Por eso no hay motivos para yo respetarlo
Lui :
Il est cinq heures du matin et je n’ai pas dormi du tout
pensant à ta beauté à en devenir dingue
l’insomnie est mon châtiment
ton amour sera mon reconfort
et tant que tu ne seras pas mienne je ne pourrai vivre en paix
et j’ai rencontré ton copain, petit et pas beau
et à sa manière de parler je sais qu’il ne t’aime pas
en plus, tu ne l’aimes pas car il ne fait pas le poids
il ne sait pas te faire plaisir comme je le ferais
mais je serai patient car il ne peut rivaliser
c’est pourquoi je n’ai aucune raison de le respecter
No, no es amor,
lo que tu sientes se llama obsesión,
una ilusión, en tu pensamiento,
que te hace hacer cosas,
así funciona el corazón
Elle :
Non, ce n’est pas de l’amour
ce que tu ressens s’appelle une obsession
Une illusion de ta pensée
qui te fait faire des choses
C’est ainsi que fonctionne le cœur
Bien vestido y en mi lexus,
pasé por tu colegio,
me informan que te fuiste,
como loco te fui alcanzar
pero es que no te encontraba, y eso me preocupaba
para calmar mi ansia yo te quería llamar,
pero no tenía tu numero, y tu amiga ya me lo negó,
ser bonito mucho me ayudó, y eso me trajo la solución
yo sé que le gustaba, y le di una mirada,
con par de palabritas tu número me dió,
del celular llamaba, y tu no contestabas,
luego te puse un beeper, y no había conexión,
mi única esperenza es que oigas mis palabras
(no puedo, tengo novio) no me enganches por favor
Lui :
Bien habillé, assis dans ma Lexus (bagnole de luxe)
Je suis passé à ton lycée
Illes m’ont dit que tu étais partie
Comme un fou je suis parti à ta recherche
mais je ne te trouvais pas et je me faisais du souci
Pour calmer mon angoisse, je voulais t’appeller
mais je n’avais pas ton numéro et ton amie me l’avait déjà refusé
Être beau gosse me sert beaucoup et m’a apporté la solution
Je savais que je lui plaisais et je lui ai fait de l’œil
et avec quelques mots doux elle m’a donné ton numéro
Je t’ai appellé de mon portable mais tu ne décrochais pas
ensuite je t’ai envoyé un texto mais je n’avais plus de réseau
Mon unique espoir est que t’entendes mes mots, je t’en prie
Elle :
Je ne peux pas, j’ai un copain
Lui :
Ne me laisse pas comme ça, je t’en prie
NO, no es amor,
(Él : Escúchame por favor)
lo que tu sientes se llama obsession,
(Él : ¿Qué es ?)
una illusion, en tu pensamiento,
(Él : Ya pierdo el control)
que te hace hacer cosas,
asi funciona el corazon
(Él : Mi amor, no me dejes así, por favor, no digas más)
Elle :
NON, ce n’est pas de l’amour
(Lui : écoute-moi, je t’en prie)
Elle :
Ce que tu ressens
s’appelle une obsession
(Lui : C’est quoi ?)
Elle :
Une illusion de ta pensée
(Lui : je perds le contrôle)
Elle :
qui te fait faire des choses
C’est comme ça que fonctionne le cœur
(Lui : Mon amour, je t’en prie, ne me laisse pas comme ça, n’en dis pas plus)
Hice cita pa’la psiquiatra a ver si me ayudaba
pues ya no tengo amigos por sólo hablar de ti
Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte
Sera possible que de una obsesión yo pueda morir ?
Y quizás pienses que soy tonto, pribón y también loco
Pero es que en el amor soy muy original
J’ai pris un rendez-vous à l’hôpital psychiatrique pour voir s’illes pourraient m’aider
Bon, je n’ai déjà plus d’amis car je ne parle que de toi
ce que je veux, c’est te parler, pour essayer de t’embrasser
est-il possible que je puisse mourir d’une obsession ?
et peut-être tu penses que je suis stupide, bête voire fou
mais c’est juste que je suis original en ce qui concerne l’amour
No me enamoro como otros
Conquisto a mi modo
Amar es mi talento te voy a enamorar
Disculpa si te ofendo pero es que soy honesto
Con lujo de detalles escucha mi versión
Con crema de chocolate, huntarte y devorarte
Llevarte a otro mundo en tu mente corazón
Vente en una aventura,
hagamos mil locuras,
voy a hacerte caricias que no se han inventado
Lui :
Je ne tombe pas amoureux comme d’autres
je fais des conquêtes à ma manière
Aimer est ma vocation, je vais te rendre amoureuse
pardonne-moi si je t’offense, mais c’est que je suis honnête
écoute ma version riche en détails
Avec de la crème de chocolat te couvrir et te dévorer
t’amener dans un autre monde dans ta tête, ma chérie
Viens vivre une aventure, on fera mille folies
je te ferai des caresses qui n’ont pas encore été inventées
No es amor, No es amor,
Es una obsesión
Elle :
Ce n’est pas de l’amour, ce n’est pas de l’amour,
c’est une obsession
Fidélité
1991, nouvelle de Greg Egan,
traduit de l’anglais par Quarante-Deux
Je sortis discrètement du lit, bien décidé à ne pas réveiller Lisa avant de revenir avec le petit-déjeuner, mais elle remua et avança la main vers moi. Ses paupières étaient toujours parfaitement fermées et à ce que j’en savais, elle ne faisait peut-être que s’agiter dans son sommeil ; je ne pus toutefois m’empêcher de saisir cette main tendue.
Elle ouvrit les yeux et sourit. Nous nous embrassâmes. Nous étions tous deux encore à moitié endormis ; c’était comme le songe d’un baiser, doux et langoureux. Je n’étais plus sur mes gardes : ce qu’on dit dans un rêve ne compte pas.
« Je t’aime », murmurai-je.
Elle eut un petit mouvement de recul. Très léger mais indiscutable. Je me maudis en silence, mais l’erreur était irrattrapable. Je pensais sincèrement ce que j’avais dit, et j’étais sûr qu’elle me croyait ; l’ennui, c’était que toutes mes déclarations lui en rappelaient inévitablement d’autres. D’autres qui avaient paru tout aussi convaincantes sur le moment.
Alors que je me redressais et je commençais à me détourner, elle dit d’une voix neutre : « Vraiment ? Et pour combien de temps ? »
J’aurais dû l’ignorer, quitter la pièce, préparer le petit-déjeuner. L’atmosphère aurait fini, comme à chaque fois, par se détendre. Pourtant, je n’ai jamais été capable de tourner les talons ; quelque part, je ne sais comment, j’ai été conditionné à croire qu’il vaut toujours mieux s’expliquer.
Je m’armai de courage et me retournai pour lui faire face. « Tu sais très bien ce que je ressens pour toi. Dis-moi, ai-je jamais fait une seule chose qui puisse te laisser penser que j’aie cessé de t’aimer ? » Ce qui était une nouvelle erreur : les protestations types de l’époux chagriné puaient tout autant la trahison.
Elle était assise, maintenant, les bras croisés, et se berçait doucement d’avant en arrière en un mouvement compulsif et perturbant. « Non. Je me demandais seulement combien de temps tu comptes que cela dure. »
L’expérience m’avait appris que rien de ce que je pourrais exprimer n’arriverait à la rassurer. Il n’existait pas de bonne réponse. J’aurais aussi bien pu hausser les épaules en disant : Mais merde, comment veux-tu que je sache ?
« Toute ma vie. Du moins je l’espère. » Je regrettai tout de suite d’avoir ajouté ce bémol maladroit, en dépit de son honnêteté manifeste, mais je n’aurais pas dû m’en faire car elle l’ignora totalement.
« Toute ta vie ? Vraiment ? Pas dix ans, comme mes parents ? Pas douze, comme les tiens ? Pas cinq, comme mon frère ? Pas six mois, comme ta sœur ? Nous allons faire figure d’exception, alors ? Leur amour fut tel qu’il se moqua de toutes les règles ! » Il n’était jamais nécessaire de mentionner ses deux ex-maris ni mes deux ex-femmes ; ils étaient là, implicitement, tout en haut de ces listes qui énonçaient notre échec inéluctable.
« Il nous faudra juste faire un peu plus d’efforts qu’eux », dis-je platement.
Je ne mettais plus beaucoup d’énergie dans mon argumentation. Ce n’était pas que je m’étais rallié à son pessimisme absurde, ni que j’étais devenu indifférent à sa douleur. Je l’aimais, et cela me faisait mal de la voir ainsi en proie à de telles craintes, même si je considérais qu’elles étaient tout à fait injustifiées. J’en avais assez de discuter, cependant, dans la mesure où aucun raisonnement ni aucune ardeur dans l’expression n’avaient l’air de pouvoir l’atteindre. J’avais espéré qu’une fois que nous serions mariés, elle commencerait au moins à accepter la possibilité d’un véritable avenir que nous pourrions avoir ensemble. Elle semblait, au contraire, être devenue plus inquiète que jamais et je ne savais pas ce que je pouvais faire de plus pour la convaincre de mon dévouement.
« Tout le monde fait des efforts, dit-elle d’un ton dédaigneux. Et ça les mène à quoi, exactement ? »
Je fis un bruit de pure exaspération. « À quoi ça sert de se tracasser pour ça ? Tout marche bien pour le moment, non ? Si des problèmes surgissent, on s’en occupera. Ou du moins, on essaiera. Quoi d’autre ? On s’est marié, on a prêté serment. Qu’est-ce qu’on peut faire de plus, bordel, nous comme les autres ? »
J’avais dû hausser le ton plus que je ne l’aurais voulu ; notre psychopathe de voisin frappa le mur deux fois avec quelque chose de lourd, juste au moment où Lisa répondit : « On pourrait utiliser Verrou. »
Je faillis rire, mais j’hésitai, attendant le signe qu’elle plaisantait effectivement. Comme blague, cela aurait été excellent. On se serait effondré dans un fou rire, on aurait roulé ensemble sur le lit en essayant de se surpasser l’un l’autre à coups de slogans parodiques : « Vous craignez la disparition de la flamme qui brûle entre vous et votre âme sœur ? Alors, plus aucun souci à vous faire ! Pour une relation amoureuse qui dure, et qui dure, et qui dure… »
Mais elle ne plaisantait pas.
« Ce qu’il y a entre nous, c’est important, non ? »
J’approuvai de la tête sans dire un mot.
« Ça vaut la peine qu’on le protège, non ?
— Oui. » Un peu hébété, je m’assis sur le lit.
« Ben ? »
Je sortis de ma stupeur. « Tu n’as donc aucune confiance en moi ? En nous ? Qu’est-ce que tu crois ? Que nos sentiments vont nous échapper s’ils ne sont pas coulés dans le béton ?
« Ça s’est déjà vu », dit-elle doucement.
Je la fixai en secouant la tête. Elle me rendit mon regard. D’un air de supplique. D’un air de défi. Tandis que mon indignation s’estompait, je pris conscience d’une deuxième chose, bien plus douloureuse : j’avais cru avoir compris ses craintes — après tout, j’avais moi aussi été blessé, j’avais moi aussi été déçu — mais maintenant il était clair que j’étais loin d’avoir pris la pleine mesure du sentiment d’insécurité dont elle souffrait. Nous n’étions mariés que depuis trois mois mais étions ensemble depuis près de deux ans — et qu’avais-je fait, durant tout ce temps, pour l’aider à se dégager de cette détresse qui l’écrasait ? Je l’avais écoutée en hochant la tête. Je l’avais traitée avec condescendance, j’avais débité quelques lieux communs. Comment avais-je pu rester à ce point aveugle à sa douleur, et pendant aussi longtemps ?
Le pire de tout, c’était que je ne voyais toujours pas ce que j’aurais pu faire de plus.
« Tu as dit qu’il fallait faire davantage d’efforts. En voilà un qui serait vraiment sérieux.
— Mais non. Nous n’en ferions alors plus du tout, bien au contraire. »
Cette réplique déclencha sa colère. « Ah oui ? Et qu’y a-t-il de si horrible à rendre les choses faciles ? Je ne suis pas masochiste. Je n’ai pas besoin de souffrir pour être heureuse. Je n’ai pas besoin de lutter. Qu’est-ce que tu crois, que ça donne plus de valeur aux choses ? Que ça les rend plus dignes d’intérêt ? J’ai déjà fait le tour de toutes ces conneries et je sais que ce n’est pas ce que je veux moi. Alors, si tu penses que l’amour, c’est une histoire de martyre, tu devrais peut-être… »
Le mur trembla de nouveau, puis Sarah se mit à pleurer.
C’était la petite fille que Lisa avait eue d’un premier mariage ; elle avait neuf ans mais garderait l’âge mental d’un nourrisson toute sa vie à cause d’une syphilis congénitale. Le mari de Lisa savait qu’il était atteint de la maladie mais il ne s’était jamais donné la peine de l’en informer. Toutes deux étaient guéries, maintenant, le corps débarrassé de toute trace d’infection, mais le mal qui avait été fait à Sarah était irréversible.
Je sentis l’indignation coutumière monter en moi. Pas étonnant qu’elle soit cynique ; si quelqu’un pouvait l’être, c’était bien elle… Un instant plus tard, je ne pus cependant m’empêcher de penser : Qu’est-ce qu’elle est en train de raconter ? Qu’à sa connaissance, je ne vaux pas mieux que lui ? Parce que si c’était vraiment ce qu’elle croyait…
« J’y vais », murmurai-je. Je me penchai et l’embrassai de nouveau, et je m’aperçus que je tremblais.
Sa colère était retombée ; à mon avis, elle s’était enfin rendu compte à quel point ses propos m’avaient secoué. « Tu vas y réfléchir ? dit-elle. S’il te plaît ? »
J’hésitai puis fis signe que oui. Je trouvais l’idée complètement folle, mais comment pouvais-je simplement balayer ce qu’elle percevait comme unique porteur d’espoir.
« Je ne veux pas te perdre, dit-elle.
— Ça n’arrivera pas. » Je ne voulais en dire plus : quelques mots de réconfort stéréotypés mais honnêtes, quelque déclaration d’amour banale mais sincère.
Mais ça aurait été parfaitement inutile. Elle avait déjà entendu tout ça auparavant.
* * *
Nous ne reparlâmes de Verrou que trois mois plus tard, mais j’y pensai beaucoup dans l’intervalle, souvent quand j’aurais dû être en train de travailler.
« La lune de miel est terminée », me disait mon patron sans humour chaque fois qu’il me surprenait à rêvasser à mon poste de travail. J’avais trente-six ans et un emploi à responsabilité — même s’il était sans aucune perspective d’avenir —- dans une entreprise de génie chimique, mais je commençais à avoir l’impression de n’être qu’un jeune commis de bureau dans un état de confusion adolescente. Les gens de mon âge étaient censés avoir une totale maîtrise de leurs relations affectives, mais si deux mariages ratés n’avaient pas suffi, la suggestion de Lisa avait emporté les dernières traces d’autosatisfaction que je pouvais encore entretenir. Peut-être était-ce une bonne chose ; je ne voulais pas prendre pour acquis ce qu’il y avait entre nous. Mais je n’avais pas plus envie de passer chaque instant de veille à le remettre en question, à l’analyser, à le disséquer.
Avec Verrou, bien sûr ce genre de problèmes ne se poserait plus jamais…
Tout l’intérêt des implants neuraux était dans la modification du cerveau permettant ainsi à l’utilisateur d’accéder à des états mentaux, à des compétences ou à des croyances qu’il n’aurait jamais pu atteindre autrement. Que ce soit des hallucinations ludiques ou le mandarin en cinq minutes, le renforcement absolu (ou le refus catégorique) d’une conviction religieuse, d’une préférence sexuelle, d’une allégeance politique chancelante, d’une attitude indésirable, il n’y avait plus une seule fonction neurale, aussi sacrée ou aussi banale fût-elle, qu’un implant ne pouvait façonner selon les exigences de l’utilisateur.
La demande pour ces dispositifs n’avait jamais baissé ; apparemment, la plupart des gens n’étaient guère satisfaits par une personnalité en grande partie formée sans qu’ils aient eu leur mot à dire dans l’affaire. Quand le respect qui semblait initialement dû au cerveau avait été surmonté, des millions de consommateurs des nations les plus riches avaient adopté sans réserve la technologie.
Mais pas tout le monde, cependant. Certaines personnes trouvaient même l’idée complètement répugnante — déshumanisante ou blasphématoire — et les fabricants d’implants ne découvraient aucun moyen de les convaincre du contraire. D’autres, qui ne se sentaient pas offusqués par le principe en soi, se refusaient obstinément à considérer qu’ils avaient besoin d’une quelconque modification. En dépit des efforts des médias pour promouvoir le nouveau culte de l’amélioration personnelle, les sondages mettaient en évidence une minorité non négligeable qui avait les moyens de s’offrir la technologie, qui n’avait pas de scrupules d’ordre éthique profondément ancrés, mais qui ne voulait pas changer, tout simplement.
Comme on dit : le Marché a horreur du vide.
Les implants ordinaires envoyaient une armée de nanomachines créer des liens entre leur processeur optique et plusieurs millions de neurones, les électrodes microscopiques qu’ils y enchâssaient servant à suivre et à manipuler les signaux électrochimiques qui entraient et sortaient de chaque cellule. S’il y avait un nombre suffisant de connexions de ce type, et sous réserve d’une puissance de calcul adaptée, l’implant pouvait outrepasser les fonctions de certaines portions du cerveau et s’y substituer.
Verrou ne faisait rien de tel. Il ne mettait en place aucune dérivation neurale — il n’introduisait pas la moindre électrode. À l’inverse, ses nanomachines provoquaient quelques dégâts au niveau des neurones cibles, en des endroits soigneusement sélectionnés, détruisant ainsi la capacité normale des cellules à modifier la force des contacts synaptiques existants et à en former de nouveau — et ce, d’une façon si délicate et si précise qu’elles restaient totalement intactes et fonctionnelles sur tous les autres plans. Il figeait donc de fait certaines parties du cerveau, rendant tout changement impossible.
Verrou était fait pour des gens qui se trouvaient sur la crête d’une vague. Des gens qui étaient parfaitement heureux de ce qu’ils étaient, mais qui avaient des craintes sur ce qu’ils risquaient de devenir.
Si l’on en croyait la rumeur, une dizaine d’auteurs à succès et de vedettes au sommet des palmarès pouvaient témoigner : l’utilisation de Verrou au moment opportun leur avait permis de pondre bien plus d’imitations de leurs meilleures ventes que ce qui aurait été autrement concevable. Harrison Oswald avait avoué, sur l’holovision internationale, que les quatres dernières de ses cinq trilogies, dans la série du Serpent jaune qui lui avait rapporté des millions, devaient leur cohérence thématique inébranlable à Verrou, et le groupe Insistent Rhythms avait copié une demi-douzaine de fois son premier morceau à grand succès avec une telle fidélité que même les ordinateurs coréens spécialisés en piratage de style n’avaient pas pu les concurrencer.
Dans les professions créatives, cependant, Verrou avait été un désastre total. Les jeunes mathématiciens et les chercheurs en sciences théoriques qui avaient espéré prolonger la période productive qui se terminait habituellement avant la trentaine s’étaient au contraire retrouvés prématurément épuisés et sans aucune originalité intellectuelle. Le moteur de la créativité, au lieu de se voir évité la dégradation, s’était transformé en un bloc rigide et inutile.
Bien entendu, ni Lisa ni moi n’avions de raison de vouloir agir sur nos vies professionnelles ; les parties du cerveau responsables de ses talents d’assistante juridique et de mes compétences d’ingénieur demeureraient libres de se développer et de changer — ou de décliner — selon les exigences de nos carrières respectives.
Restait à savoir si les voies que nous voulions figer pouvaient être repérées par l’implant. Malgré toute ma réticence à l’admettre, je ne voyais pas pourquoi cela ne serait pas possible. Je n’étais en proie à aucun délire mystique sur l’origine de l’amour ; si je ressentais un tel sentiment, c’était qu’il était là, dans mon crâne, tout aussi susceptible d’être décelé que la triste muse de Harrison Oswald — et bien plus digne d’être préservé. Les journaux à sensation prétendaient que les mariages entre célébrités qui duraient plus d’un an devaient tous leur longévité à Verrou ; ces histoires n’étaient pas toutes forcément vraies… mais elles n’étaient pas toutes nécessairement fausses non plus.
Bien sûr, au début, je n’étais pas rassuré. Une partie de moi-même se débattait sous l’effet d’une répulsion viscérale bien prévisible à l’idée de fossiliser une parcelle de mon cerveau, quelle qu’elle soit, et encore plus celle qui s’occupait de mes sentiments pour Lisa. Choisir librement d’agir en fonction de nos ressentis était une chose, mais accepter de leur être asservi — d’être incapable de même vouloir s’en libérer — ôterait tout sens à la notion même d’engagement. Lésions cérébrales auto-infligées. Paralysie affective. Une parodie d’amour. C’était obscène.
En même temps, il me fallait cependant admettre qu’il y avait quelque chose de presque enivrant dans la possibilité de détourner ainsi l’avenir — de détourner ainsi l’avenir —- de dicter de façon absolue quelle serait la vie émotionnelle de la personne que j’allais devenir. J’y sentais comme un parfum d’immortalité. Je savais que je n’étais pas la même personne que cinq ans, dix ans, vingt ans plus tôt. J’avais beau verser une larme sur ces moi perdus, je ne pouvais les ressusciter (et pour être tout à fait honnête, je n’en avais pas vraiment envie), mais je pouvais éviter de me retrouver moi-même en situation d’être pleuré à mon tour.
Avec Verrou, je pouvais perdurer.
Progressivement, mes réticences initiales commencèrent à me paraître infantiles et irrationnelles. Nous ne serions pas « émotionnellement paralysés », pas insensibles ; nous serions précisément aussi amoureux et réceptifs l’un à l’autre qu’actuellement — ni plus, ni moins. Quant à être « l’esclave » de mes sentiments, ne l’étais-je pas déjà ? Et pour être franc, j’en étais heureux, je ne voulais pas me libérer, et la notion d’être ou de ne pas être « capable » de ressentir autre chose était un concept pour le moins flou. Admettons que j’aie gardé les mêmes sentiments pour Lisa toute ma vie sans utiliser Verrou : comment aurais-je pu dans ce contexte et concrètement avoir été « capable » de cesser de l’aimer ? On ne vit qu’une fois ; c’est non seulement futile de penser à ce qui « aurait pu se passer », mais c’est dénué de tout sens. Et si tout ce que Verrou faisait c’était d’éliminer des choix que je n’aurais de toute façon pas faits, en quoi cela impliquait-il une perte de liberté ?
Et puis, au diable la philo ; nous avions tous deux pris des mesures pour protéger d’autres éléments de notre bonheur : santé, biens, emplois. Les sentiments que nous éprouvions l’un pour l’autre avaient une bien plus grande importance, évidemment, mais n’était-ce pas là une raison de plus pour vouloir les mettre à l’abri de toute menace ?
J’étais toujours convaincu que Verrou n’était pas nécessaire, et je ne pouvais nier que ce peu de foi qu’avait Lisa en moi me faisait mal — mais si je l’aimais, je pouvais m’en abstraire et regarder les choses de son point de vue. Elle avait été marquée, elle avait été blessée, elle avait été trahie, de façon répétée — elle était en droit d’être rongée par le doute. Qu’attendais-je d’elle exactement — qu’elle aille s’acheter un implant qui la transformerait, sans discernement, en une optimiste béate au sourire figé ?
Pour son bien, je pouvais quand même ravaler mon orgueil.
Je pris donc ma décision : j’allais accepter.
Cependant, après avoir elle-même mis le sujet sur le tapis, Lisa n’en avait plus reparlé. Je me demandais si le simple fait d’avouer qu’elle pensait à Verrou n’avait pas eu un effet cathartique, si elle n’avait rien voulu d’autre que me choquer pour que je prenne ses craintes plus au sérieux.
Dans l’espoir que c’était bien le cas, je résistais à toute tentation de discuter de notre relation ; au lieu de perdre mon temps à proclamer ma flamme, j’essayais d’être plus démonstratif. Je préparais ses plats préférés. Nous faisions l’amour quand elle voulait, et comme elle voulait. Je vendis mon synthétiseur vidéo pour payer une garde d’enfant, et nous sortîmes tous les samedis soir pendant des mois. Je l’écoutais même me parler de son travail, et pas une fois ne laissai mon regard se perdre dans le vide.
C’est vrai, j’avais agi à peu près de la même façon avec Alison et Maria, quand les choses avaient commencé à se gâter. Ça avait pourtant été différent : j’étais jeune et naïf, et j’avais une confiance en moi tellement excessive que c’en était pathétique. Rétrospectivement, je voyais clairement que je n’avais jamais pu donner ni à l’une ni à l’autre ce qu’elle désirait vraiment. Alison était à la recherche d’un compagnon amusant qui savait tenir sa place et s’occuper de ses affaires : un gigolo discret, et rien de plus. Je crois bien qu’elle avait fini par en trouver un. Maria avait voulu quelqu’un qui la traite comme une enfant pour le reste de ses jours — comme une fillette de douze ans, douée et pleine de promesses, la petite préférée de tout le monde. Quelqu’un d’autre aurait peut-être découvert un moyen de la faire évoluer, mais moi je n’avais manifestement pas pu.
Et Lisa ? Lisa désirait une relation durable, stable et fidèle. Ce qui était très exactement ce que j’étais disposé à fournir.
* * *
Le mariage de la sœur cadette de Lisa s’avéra décisif. Son père et sa mère y assistaient tous les deux, accompagnés de leurs amants du moment. Lisa et moi, nous nous étions mariés à la mairie, en secret ; maintenant, je comprenais pourquoi. Je ne savais plus où me mettre tandis que ses parents passaient progressivement de quelques insultes murmurées à un véritable concours de vociférations, la mariée étant la plus grande partie de la journée en larmes.
Au début, Lisa parut accepter tout ça avec nonchalance, presque avec amusement, mais au milieu de la réception, je l’entendis s’en prendre au marié, lui disant qu’il n’était qu’un misérable salopard qui tiendrait tout juste une semaine.
Cette nuit-là, nous restâmes allongés dans les bras l’un de l’autre, trop déprimés pour penser au sexe mais aussi pour dormir. Mon regard se portait sans cesse vers notre « photo de mariage » posée sur la table de nuit, un cliché Polaroïd bon marché en deux dimensions qu’un passant serviable avait bien voulu prendre à la sortie de la mairie. Elle ne datait que de six mois, mais semblait étrangement archaïque au clair de lune. Lisa avait une expression sereine, mais moi j’arborais un sourire stupide. C’était ce sourire, décidai-je, qui réussissait, allez savoir pourquoi, à faire paraître l’image à ce point vieillie.
Personnellement, je ne pensais pas que le comportement des parents de Lisa pouvait avoir la moindre influence sur le devenir de notre mariage à nous. Au diable l’hérédité et l’éducation : nous pouvions construire nos propres vies. Lisa voyait les choses autrement, cependant, et il semblait bien que rien de ce que j’avais pu faire ces derniers mois n’avait changé son attitude. Plus on était heureux maintenant, plus dure serait la chute, et c’était tout.
Je lui opposai une résistance de pure forme.
« Nous ne pourrions jamais finir comme ça, insistai-je. Nous n’accepterions pas une telle situation.
— Qu’est-ce que tu crois ? Qu’un beau matin ils se sont concertés et ont décidé de se haïr ?
— Non. Mais nous sommes prévenus. Nous ne tomberons pas dans les mêmes pièges.
— Tu veux que je te parle de mes grands-parents ?
— Pas spécialement, non. »
Je croyais avoir déjà pris ma décision, mais je sentis ma résolution vaciller. Pendant un moment, je la tins dans mes bras, essayant de tout passer en revue une fois encore.
Personne n’a envie d’être objectif en matière de cœur, mais il fallait que je me force ; sinon, comment pouvais-je espérer faire un choix rationnel pour Verrou. Ça n’était pas très utile de faire comme si l’amour était une sorte de qualité spirituelle ou de force morale — tout en évaluant par ailleurs les avantages qu’il y avait à le cheviller en place à coups de robots moléculaires. Que l’on se serve ou non de l’implant, le simple fait qu’on ait pu envisager d’en passer par là avait déjà changé ce que l’amour représentait pour nous.
Alors donc. Toute l’idéologie moderne discourant sur le respect et l’engagement avait été greffée sur d’anciens instincts régissant la procréation et l’élevage des enfants. Dans certaines espèces, cela se résumait au sexe ; dans la nôtre, parce que notre progéniture mettait tellement longtemps à devenir indépendante, nous avions développé des sentiments pour nos partenaires qui perduraient bien au-delà de la copulation. Les gens parlaient de couples qui « exprimaient leur amour » par le sexe et en élevant des enfants, mais la vérité était exactement en sens contraire : ce sentiment abstrait et intellectualisé n’était rien d’autre qu’une façon pour chacun de rationaliser ses instincts, de nier sa faiblesse animale, d’attribuer à ses actions des motivations qui convenaient à des êtres humains civilisés.
Tout cela ne me dérangeait absolument pas. Ce serait se bercer d’illusions et tout à fait risible que de vouloir nier à l’amour sexuel son origine dans la biologie de la reproduction. Je n’avais jamais prétendu que mon désir de rendre Lisa heureuse était pure philanthropie et que j’étais un saint. Si cela avait été le cas, j’aurais travaillé à Calcutta ou à São Paulo, dispensant mon amour à tous en parts égales, au lieu de mener une vie de petit-bourgeois en ne pensant qu’à nous deux et à Sarah. Admettre cela ne diminuait en rien mon sentiment pour elle — mais ça rendait d’autant plus absurde tout le chiqué qu’on pouvait faire à ce sujet. Que l’on soit amoureux l’un de l’autre était un accident. Ce n’était pas écrit dans les étoiles. Ce que le hasard avait créé, il pouvait le défaire — sauf si nous choisissions de rendre la chose impossible.
« Tu te souviens de ce que tu as dit à propos de Verrou ? »
Elle ne répondit pas tout de suite et, l’espace d’un instant, je me contins : Ne fais pas l’imbécile ; elle n’a jamais pensé ça sérieusement.
« Bien sûr que je m’en souviens.
— C’est toujours ce que tu veux ? »
Son visage était dans l’ombre ; je n’avais aucune idée de ce qu’elle pouvait bien penser. Il me vint soudain à l’esprit que si j’avais fermé mon clapet, elle n’aurait peut-être plus jamais évoqué le sujet.
« Oui. »
Pendant un petit moment, je ne pus plus m’exprimer. Une voix dans ma tête hurlait des choses incompréhensibles, parlant d’une camisole de force imposée à mon âme, d’une laisse contrôlant mes organes génitaux, de barbelés entourant mon lit de noces. Sur la photo du mariage, le petit sourire que j’arborais ressemblait au rictus d’un cadavre congelé. Je laissai la réaction émotionnelle suivre son cours jusqu’au bout, comme si elle n’avait rien à voir avec moi.
« Alors, c’est ce que je veux moi aussi. Ça me fait peur, mais si c’est vraiment ce que tu désires… », dis-je enfin.
Elle rit. « Ne sois pas effrayé ! Il n’y a pas de quoi avoir peur. Tu sais déjà exactement comment ça sera. »
Je ris aussi. Elle avait raison. Bien sûr qu’elle avait raison ! Et de surcroît, elle était de toute évidence plus heureuse qu’elle ne l’avait jamais été depuis bien longtemps, et n’était-ce pas là l’objectif ?
Elle m’embrassa, avec insistance, et je laissai les vieux instincts prendre le dessus — ce faisant, je savais que d’une certaine façon nous les avions enfin transcendés.
* * *
Le lendemain, j’achetai les implants. Ils coûtaient moins cher que ce à quoi je m’attendais, seulement cinq cents dollars pièce — au total, moins de quatre jours de salaire. L’illustration sur l’emballage montrait une personne souriante et sereine, de sexe indéterminé, dont le crâne contenait un coffre incrusté de joyaux qui rayonnait comme une Arche d’alliance hollywoodienne, bien visible à travers la chair et l’os en raison de son éclat. Au-dessus, on pouvait lire la promotion qu’en faisait Harrison Oswald : « Je n’envisagerais jamais d’utiliser un autre implant que Verrou ! Verrou, c’est pour ceux d’entre nous qui ont déjà tout ce qu’il faut ! »
Nous lûmes le mode d’emploi ensemble. La programmation simple : il vous demandait ce que vous vouliez verrouiller, et il suffisait de le lui dire. Il n’y avait aucun risque que l’implant se trompe en interprétant les mots : il n’essayait même pas de les comprendre. Après avoir enregistré un schéma verbal — tel que la phrase « Mes sentiments pour Lisa » —, il examinait le cerveau de l’utilisateur, déterminait quelles voies neurales étaient activées par ledit schéma, et les marquait en tant que cible pour la préservation. Il n’était en rien nécessaire qu’il ait lui-même le moindre début de signification pour ces mots ; tout ce qui comptait, c’était le sens que l’utilisateur leur donnait.
J’avais nourri quelques craintes : les nanomachines risquaient-elles, pour une raison ou une autre, d’oublier leur programmation et de se déchaîner sur le cerveau, infligeant à tous les neurones sans exception leurs dégâts bien spécifiques. Cela nous laisserait pire que morts : nous serions pris au piège dans un présent éternel, incapables d’élaborer des souvenirs à long terme, les systèmes neuraux concernés ayant perdu leurs capacités à changer. La notice d’utilisation me rassura cependant : le processus d’altération d’un seul neurone entraînait l’autodestruction de la nanomachine correspondante, et l’implant n’en contenait pas suffisamment pour léser le cerveau en entier.
Nous ne nous précipitâmes pas. Nous avions tous deux pris des congés et avions emprunté de l’argent pour pouvoir placer Sarah pendant deux semaines au Centre ; cela ne plaisait pas à Lisa — elle trouvait déjà assez difficile d’avoir à l’y conduire chaque jour —-, mais nous avions convenu qu’il nous fallait du temps pour pouvoir nous consacrer à nous-mêmes, sans aucune distraction.
Lisa insista sur le fait que nous devions « nous préparer » avant d’utiliser les implants. Je n’étais pas certain que cela avait un sens, mais je me laissai faire pour préserver une ambiance harmonieuse. La nature précise de l’état d’esprit dans lequel on se trouvait au moment où nous mettrions les implants en action n’avait certainement aucune importance ; Verrou ne s’occupait que de connexions neurales, et celles-ci se modifiaient à un rythme beaucoup plus lent que les éclairs électrochimiques transitoires de la pensée. Au sein des voies existantes, il y avait toujours eu, et il y aurait toujours, de la place pour une large palette d’humeurs ponctuelles. C’était justement tout cette gamme de possibilités (et la probabilité que chacune se manifeste) que nous allions préserver avec Verrou.
Mais sur une période de quelques jours, peut-être pourrions-nous renforcer les voies les plus désirables en les utilisant de façon répétée, et faire que les autres s’atrophient, ne serait-ce que partiellement.
Comment peut-on en pratique optimiser son amour, c’était la question. Faut-il rester les yeux plantés dans ceux de sa bien-aimée en murmurant de douces inepties ? Doit-on avoir des relations sexuelles afin de se sentir comblé, ou au contraire s’en abstenir pour aiguiser le désir ? Faut-il écouter de la musique romantique ? Aller voir des films d’amour ? Évoquer les premiers jours, ou préparer notre avenir infini et merveilleux ?
En fin de compte, nous décidâmes de sortir ; au cinéma, au théâtre, à des expositions. Après tout, l’amour c’était surtout faire ensemble les choses qui nous plaisaient, et non pas nous morfondre à la maison dans l’espoir de vivre un moment fortuit d’extase transcendantal. Le double luxe de ne pas avoir à aller au travail et à s’occuper de Sarah me remplissait d’une sorte de plaisir coupable, mais je me serais bien plus diverti si je n’avais pas eu à m’inquiéter constamment de savoir si j’étais effectivement en train de renforcer les synapses sur lesquelles j’étais censé agir, au lieu d’œuvrer — accidentellement, inconsciemment, ou par pur manque de discipline mentale — à consolider des modes de pensée négatifs.
Au bout des quinze jours, si Lisa parlait, ou souriait, ou me touchait et que je ressentais autre chose qu’une adoration pure et simple, je m’imposais des acrobaties absurdes pour essayer de corriger ma réaction. Toute la panique et la claustrophobie que je croyais avoir maîtrisées commencèrent à me revenir. Lisa paraissait nerveuse, elle aussi, mais je n’osais pas proposer qu’on remette l’affaire à plus tard. Je ne voulais pas repousser l’échéance ; je ne pouvais supporter l’idée de passer ainsi une journée de plus, tellement obsédé par la continuelle surveillance de mes émotions qu’elles s’en trouvaient en danger constant de se désintégrer pour ne laisser derrière elles qu’une série de tics mentaux automatisés. Il ne restait que deux possibilités : soit nous procédions comme prévu, soit nous laissions tout tomber — et revenir en arrière était impensable. Lisa ne m’aurait plus jamais fait confiance. Je l’aurais perdue. Je n’avais pas le choix.
La veille, je n’arrivai pas à dormir mais je fis semblant. Lisa faisait sans doute de même. Peu importait : une honnêteté parfaite, ce n’était pas vraiment ce que nous cherchions. Il existait des implants capables de fournir ça — ainsi que tous les autres aspects d’un amour de compte de fées — mais nous avions décidé de nous contenter de la chose véritable.
Allongé dans le noir, respirant avec un calme étudié, je songeais à ce qu’avait été ma vie après mon second divorce, avant de rencontrer Lisa. Trois ans de stupeur grise, à osciller entre apitoiement et apathie. À rester à la maison à écouter la radio déverser des chansons qui parlaient de danser, de boire, de baiser toute la nuit. Moi, toute la nuit, j’avais l’impression de ne rien faire jamais. Sans parler de dormir.
J’étais sûr d’une chose au moins : je ne pourrais plus jamais vivre de cette façon. Je n’étais plus tout à fait certain de tenir à Lisa au point de faire ce qu’elle attendait de moi uniquement pour lui faire plaisir, mais cela avait cessé, je ne sais pourquoi d’être le problème. La vérité était plus simple : moi, j’avais besoin de quelqu’un, et elle aussi. Ce que nous ressentions l’un pour l’autre n’avait plus d’importance. Je n’étais pas en train de faire un quelconque sacrifice ; ce n’était pas pour lui prouver mon amour. Tout se résumait maintenant à une certitude : il valait mieux être enchaîné l’un à l’autre que rester seul.
À mon réveil, mon humeur sombre s’était estompée, du moins en partie. La simple vue de Lisa le matin pouvait encore me rendre ivre de joie ou presque, et des restes de l’ancienne affection spontanée — que j’avais jadis ressentie sans le moindre effort — réapparurent pendant un moment. Nous prîmes notre petit-déjeuner en silence. Je souriais tellement que mes joues m’en faisaient mal.
Quand j’allai chercher les implants, mes paumes étaient trempées de sueur. Je me souviens alors à quel point j’avais été joyeux et absolument détendu le jour de mon mariage — mais le serment n’avait à cette occasion été fait que de mots ; cette fois-ci, j’avais plus l’impression d’entrer dans un pacte suicidaire. Cette idée était pourtant absurde. Qui allions-nous tuer ? Nous n’allions pas changer, nous n’allions rien sentir du tout. Nous étions en train d’assassiner l’avenir, mais tout le monde le fait, et mille fois par jour.
« Ben ?
— Quoi ?
— Tu es prêt ? Tu es sûr ? »
J’eus un sourire un peu forcé. Espèce de salope. Ne me tente pas. « Bien sûr que je suis prêt. Et toi ? »
Elle hocha la tête, puis détourna le regard. Je lui saisis la main par-dessus la table et lui dis avec le plus de douceur possible : « C’est effectivement ce que tu voulais. Après, plus de doutes en vue, plus de craintes. »
Les implants étaient de la taille d’un grain de sable. Avec une pince fine, nous les plaçâmes chacun dans son programmateur, puis nous énonçâmes les mots à partir desquels ils dresseraient la carte de notre amour. Nous les mîmes ensuite dans les applicateurs, prêts à être introduits dans une narine. À partir de là, ils s’enfonceraient droit dans notre cerveau et disperseraient des robots de la taille d’un virus qui produiraient en nous certains dégâts plus subtils que tout ce que nous avions pu subir auparavant.
Je fis une pause pour tenter de me ressaisir, pour essayer de repousser toutes mes appréhensions. Quel intérêt y aurait-il à reculer maintenant ? Que pourrais-je y gagner ? J’avais déjà délimité très précisément mon amour, je l’avais dépouillé de tout contexte, je l’avais définitivement dépersonnalisé. En quoi les nanomachines pourraient-elles faire pire ?
Tandis que Lisa levait son applicateur, je me vis bondissant sur mes pieds, tendant le bras, lui faisant tomber la chose des mains. Je n’en fis rien, cependant. Je me hâtai au contraire de l’imiter, de peur de flancher à la dernière minute si j’hésitais.
Il y eut quelques secondes de tension, puis elle se mit à sangloter de soulagement et je fis de même. Le souffle coupé, nous tombâmes tout tremblants dans les bras l’un de l’autre, le visage noyé de larmes. Quoi que nous ayons fait, la décision avait été prise et c’était fini. Pour l’instant, c’était plus que suffisant.
Un peu plus tard, je la portai jusqu’à notre chambre. Nous étions trop épuisés pour faire l’amour. Nous dormîmes vingt heures d’affilée et nous réveillâmes juste à temps pour aller chercher Sarah et la ramener à la maison.
* * *
Tout ce qui précède remonte à quinze ans, mais au risque d’énoncer l’évidence même, je dirais que bien peu de choses ont changé depuis.
Bien sûr, j’aime toujours Lisa. Il m’arrive encore de m’oublier, de temps en temps, et de le lui dire. Elle accueille à chaque fois mes déclarations avec autant de scepticisme.
« Combien de temps crois-tu que ça va durer ? » me demande-t-elle.
Il n’y a toujours aucune bonne réponse. Elle connaît la vérité tout aussi bien que moi, mais invariable, celle-ci est impuissante à atténuer ses angoisses.
Sarah a vingt-quatre ans maintenant. Son adolescence a été un enfer ; elle était presque intenable mais ces derniers temps elle est devenue une véritable source de joie pour nous. Bien que les médecins aient affirmé qu’elle aurait un âge mental de dix-huit mois toute sa vie, il n’y a pas le moindre doute dans mon esprit : elle a bel et bien fait des progrès. Un bébé peut-il se montrer attentionné, compatissant, généreux ? Sarah, elle, le peut. Elle parle toujours à peine, mais on a l’impression qu’elle trouve chaque jour de nouvelles façons d’exprimer son amour pour nous. Peut-être n’a-telle pas « grandi sous nos yeux » comme l’aurait fait un enfant ordinaire, mais je me rends compte maintenant que d’une manière qui lui est propre, elle n’a jamais cessé d’aller de l’avant.
Quant à Verrou, j’essaie de ne pas y penser trop souvent. Lisa et moi sommes bien toujours amoureux l’un de l’autre ; nous sommes toujours ensemble. Aucun des mariages de nos amis n’a duré aussi longtemps. C’est à l’évidence un signe tangible de succès ; assurément, ça prouve… quelque chose.
Certains matins, pourtant, quand je reste debout près du lit, simplement à regarder Lisa dormir, je ressens sans le moindre doute — on pourrait même dire littéralement — le même sentiment de tendresse (ni plus, ni moins) que j’ai déjà éprouvé des milliers de fois auparavant dans des circonstances similaires au cours des quinze dernières années, et que je sais devoir ressentir de la même manière encore des milliers de fois jusqu’à ma mort. Et je suis partagé entre la sensation que le temps s’est arrêté et l’impression contraire que je suis là, debout, à observer, depuis peut-être une éternité.
Et je pense — sans aucune amertume, mais insensibilisé par une impression de perte que je n’arrive pas vraiment à définir, que je ne peux tout à fait saisir — que nous ne sommes peut-être pas sur la crête de la vague, mais qu’il y a au moins une certitude : ça ne peut pas aller mieux. C’est véritablement impossible que ça aille jamais mieux.
Die Pärchenlüge
Le mensonge des couples
1991, écrit et interprété par
Die Lassie Singers
Das Leben ist schon hart genug
Alleinstehende haben’s doppelt schwer
Pärchen sind wie Parasiten
Pärchen werden immer mehr
Sie küssen wo sie gehn’ und stehn’
und schaun sich niemals um
Pärchen bitte draußen bleiben
uns wird’s jetzt zu dumm
Pärchen stinken, Pärchen lügen
Pärchen winken und fahr’n nach Rügen
Cocktails trinken, Kartoffelchips essen
Händchen halten und die Freunde vergessen
La vie est déjà assez dure comme ça
Pour les célibataires c’est pire
Les couples, c’est comme des parasites
Les couples se multiplient à toute vitesse
Illes s’embrassent où qu’illes soient
Et ne regardent jamais autour d’elleux
Les couples, restez dehors s’il vous plaît
Nous, on en a marre
Les couples, ça pue ! les couples, c’est un mensonge !
Les couples font coucou et partent en vacances
Boire des cocktails, manger des chips
Se tenir par la main et oublier les ami·e·s
Pärchen verpisst euch, keiner vermisst euch
Pärchen verpisst euch, keiner vermisst euch
Les couples, cassez-vous, personne ne va vous pleurer !
Les couples, cassez-vous, personne ne va vous pleurer !
Wenn du abends voller Hoffnung in die ganzen Kneipen gehst
Wenn du morgens mit der neuen Bravo an der Haltestelle stehst,
Die Pärchenlüge ist überall, ihr Anblick ist nicht schön, schön
In jedem Winkel von deiner Stadt kannst du sie seh’n, kannst du sie seh’n
Le soir, quand tu vas plein d’espoir dans tous les bars
Le matin, quand tu attends le bus en lisant le dernier numéro de ton magazine préféré
Le mensonge des couples est partout, ce n’est pas beau à voir, pas beau
Tu peux les voir dans le dernier recoin de ta ville, tu peux les voir
Pärchen verpisst euch, keiner vermisst euch
Pärchen verpisst euch, keiner vermisst euch
Les couples, cassez-vous, personne ne va vous pleurer !
Les couples, cassez-vous, personne ne va vous pleurer !
Ihr denkt ihr seit im Märchen
und seit nur blöde Pärchen
los stürzt euch ins Verderben
denn Pärchen müssen sterben
Alle Pärchen müssen sterben
Vous vous croyez dans un conte
Mais vous n’êtes que des couples stupides
Allez-y, allez à votre perte
Car les couples doivent mourir
Tous les couples doivent mourir
The Size of Our Love
1999, écrit et inteprété par Sleater-Kinney
Our love is the size of these tumors inside us
Our love is the size of this hospital room,
You’re my hospital groom
Notre amour est de la taille de ces tumeurs en nous,
Notre amour est de la taille de cette chambre d’hôpital,
Tu es mon fiancé d’hôpital
Put the ring on my finger, so tight it turns blue
A constant reminder I’ll die in this room
If you die in this room
Passe l’anneau à mon doigt, si étroit qu’il en devient bleu
Un souvenir toujours présent que je mourrai dans cette chambre
Si tu meurs dans cette chambre
Sit like a watchdog and patiently wait
Listen for footsteps down the hallways
Visit beds like they’re graves
Assieds-toi comme un chien de garde et attends patiemment
Écoute les bruits de pas dans les couloirs
Visite les lits comme des tombes
Days go by so slowly
Nights go by so slowly
In a hospital room
In a box built for two
Les jours s’écoulent si doucement
Les nuits s’écoulent si doucement
Dans une chambre d’hôpital
Dans une boîte faite pour deux
I fight for air, fight for my own air
Forget all the things I can do alone
I fight for a heart. I fight for a strong heart
I fight to never know this sickness you know
But I know its my own, I gave it a home
Je me bats pour de l’air, me bats pour mon propre air
Oublie toutes les choses que je peux faire seule
Je me bats pour un cœur. Je me bats pour un cœur fort
Je me bats pour ne jamais connaître cette maladie, tu sais
Mais je sais que c’est la mienne, je lui ai offert un toit
Our love is the size of these tumors inside us
Our love is the size of this hole in the ground
Where my heart’s buried now.
Notre amour est de la taille de ces tumeurs en nous
Notre amour est de la taille de ce trou dans le sol
Où mon cœur est maintenant enterré
Sauver ce qui peut l’être
2010, nouvelle de Prune Matéo
Vous considérez-vous comme quelqu’un d’unique ?
Utilisez-vous fréquemment les termes « toujours », « jamais », « impossible », « rien » ?
Ressentez-vous parfois une confusion entre des sentiments contradictoires ?
Tenez-vous vos opinions pour constantes dans le temps ?
Avez-vous du mal à manipuler des grands nombres ?
Selon vous, l’image que l’on donne de soi est-elle nécessairement proche de celle que l’on a de soi-même ?
Considérez-vous la vie comme une suite de moments sans cohérence ?
Il faut déplacer un curseur sur une ligne imaginaire allant d’infiniment oui à infiniment non. Mais je ne peux pas voir ma main, cachée par le bloc plastique du capteur. Je vois le résultat de mon geste à l’écran et j’ai l’impression que ça ne correspond pas. À chaque légère hésitation, le curseur fait un bond. Le mouvement doit être amplifié…
Considérez-vous la vie comme une suite de moments sans cohérence ?
Le sens des mots commence à m’échapper et tout ici m’oppresse, jusqu’aux couleurs pastel des cloisons. Je n’aurais pas dû venir. Je tape Abandon sur le petit clavier et me dirige vers les imposantes portes de stucco translucides.
Une hôtesse m’interpelle : « Lucy Pierce ? »
Je suis tentée de partir sans me retourner.
Je me retourne.
« Votre cabine est prête. »
Elle sent ma réticence et ajoute, affable : « Il ne s’agit que d’une étape préliminaire, rien ne vous oblige à poursuivre ensuite.
— Je préfère réfléchir encore. »
Au lieu de rentrer directement, j’arrête le véhicule à une borne près du lac Sud. J’ai envie de marcher. À la maison, Stephen m’attend sûrement, j’aimerais éviter la conversation qu’on aura forcément à mon retour. Je me contenterai de la retarder.
Je longe les bâtiments déserts des anciennes Consignes jusqu’au chenal. L’air est doux et chargé d’odeurs de vase et d’herbe mouillée, le jour décline à toute vitesse. Vesma, la deuxième lune, apparaît au sud et décrit une orbe lente au-dessus des eaux sombres du canal. On dirait un œil qui se déplace très lentement dans le ciel. Je ralentis le pas. C’est la première fois depuis plusieurs dials que je respire un peu.
La double nuit est déjà amorcée quand je franchis le portique de la maison. Stephen a allumé le petit lampadaire de l’entrée. Le vigilo clignote avant de m’identifier, émet son petit uuumv-uuumv à peine audible. J’aime bien ce microsuspense, les quelques secondes pendant lesquelles on se demande s’il ne va pas faire une erreur et vous considérer comme étranger.
Stephen m’accueille avec tact, m’aide à retirer le masque et va le mettre à charger sans un mot. Je le connais assez pour savoir qu’il se retient de me demander où j’étais. Il s’affaire autour du synthétiseur, programme le repas. Il fait des efforts.
« Tu n’as pas faim ? »
Non, je n’ai pas faim, j’attends les première salves. Pourtant, je viens docilement m’asseoir à table.
« À quoi tu penses ? demande-t-il.
— Je dois forcément penser à quelque chose ?
— Fatalement. »
Il sourit mais il est tendu. Sans me quitter des yeux, il retire le film de protection, désolidarise les deux portions et les dispose devant nous. C’est un wishy aux indirelles.
Il mange quelques bouchés puis s’essuie les lèvres avec sérieux et prend ma main.
« Alors ? »
Je ne dis rien.
« C’est bon, tu es compatible ? »
D’un geste las, je repousse mon plat, intact, sur la partie incurvée de la table.
« Je n’ai pas passé le scan. »
Il fronce les sourcils : « Tu veux que je reprenne un rendez-vous ? Je t’accompagne si tu veux.
— C’est pas la peine. »
Je me lève et me poste devant le vitrage mural, dos à lui. Je suis fatiguée.
Il me suit : « Qu’est-ce que ça veut dire, pas la peine ? »
Je fixe le jardin clos, noyé sous la brume de double nuit. Ça fait comme une vapeur brune qui s’échappe du sol au ralenti.
Stephen soupire bruyamment : « Lucy, on se connaît depuis cinq cycles, je te respecte et je t’aime. Qu’est-ce qu’il te faut de plus ?
— Rien… Je pense juste que ce n’est pas une étape obligatoire.
— C’est sûr, dit-il, amer. Ce n’est pas obligatoire. »
Il fait quelques pas, ses longs bras maigres curieusement ballants, puis retourne à la table et regarde les restes du repas comme autant d’illusions perdues. Tout ça semble le dépasser, être complètement absurde. Au loin, on entend la rumeur assourdie des fusées du cap Vierge. Il secoue la tête, répète sans réelle conviction : « On se connaît depuis cinq cycles, bientôt six… »
Sa voix flanche. Je le regarde, ses yeux sont noirs et cernés, son front terriblement lisse. Je ne regarde jamais vraiment son visage, en fait.
« Ce ne sont pas mes sentiments qui sont en cause, Stephen. »
À peine ai-je prononcé ces mots que je sens que ce n’est pas totalement vrai. Toute cette histoire d’image mémorielle me pèse tant que je ne sais plus trop où j’en suis.
« Tu as quelque chose à cacher ? » me demande-t-il.
Je repense au test du centre Fidalis. L’image que l’on donne de soi est-elle nécessairement proche de celle qu’on a de soi-même ?
« Non.
— Alors où est le problème ? »
Sans attendre de réponse, il s’enflamme : « Je suis ton concubin, je veux te connaître, je veux que tu me connaisses, que tu saches qui je suis, pas en surface mais véritablement…
— Je ne veux pas tout savoir, Stephen, Pas comme ça. »
Je n’arrive plus à faire le tri dans mes pensées. Sans doute vaudrait-il mieux me taire, ne pas alimenter cette conversation que, d’une certaine manière, il tient déjà tout seul. Souvent, il me donne l’impression de se justifier tout haut sans réellement s’adresser à moi. Pour la première fois, je mets un mot sur ce trait de sa personnalité : c’est une sorte de syndrome du bon élève, qui anticipe l’arbitrage du professeur, s’y fie plus qu’à son propre jugement. Pour lui il serait apaisant de penser qu’il existe une autorité, une instance suprême à laquelle se référer en cas de litige.
Il peut être tranquille. Si quelqu’un, au-dessus de nous, observait la scène, il le jugerait légitime et de bonne foi.
Ensuite, la soirée s’est écoulée au ralenti, j’ai fait plus ou moins semblant de visionner une vidéoz pour avoir la paix et suis rapidement montée me coucher. Maintenant, je regarde le plafond pyramidal sans trouver le sommeil.
Je n’en peux plus de ces conversations. Je ne comprends pas pourquoi Stephen tient tellement à cette opération. C’est peut-être l’histoire avec sa précédente concubine qui refait surface… il a très mal vécu leur séparation. Mais après tout je n’y suis pour rien. Et s’il avait eu le temps, à l’époque, de faire l’opération, où en serait-il aujourd’hui ? Que ferait-il de son image mémorielle ? J’ignore quelle est la législation en cas de séparation des concubins…
Au matin, je me réveille avec un souvenir ténu du rêve de la nuit. Il y avait Stephen. Il voulait quelque chose… ou bien je lui aurais pris quelque chose. Le vent soufflait, mais ce n’était pas du vent, c’était un appel d’air, une aspiration telle que j’en perdais presque l’équilibre… Je ne me rappelle déjà plus.
Si, un trou se creusait. C’était un trou à l’intérieur de Stephen. Dans son ventre.
Je me retourne dans le lit. Qu’est-ce qui m’arrive, est-ce que je suis en train de dérailler ?
Je passe un long moment à l’hydrosoin. Je laisse les jets vitaminés me gifler le dos, la nuque, anéantir toute tension, puis la cabine m’envelopper de son souffle chaud. Sensation de bien-être immédiate, de sécurité. Je descends ensuite programmer un déjeuner. Je me sens molle apaisée.
Sur l’écran du Terminal, un message de Stephen :
Je m’excuse pour hier. Je sais que tu es fatiguée en ce moment.
Je ne veux pas te brusquer, mais ils ne garderont mon empreinte que trois dials.
Au-delà, tout sera à refaire.
Passe au moins un entretien avec un conseiller, on y verra tous les deux plus clair.
Ouais.
Les jours qui suivent, Stephen a des gestes de tendresse qui me laissent incrédule. Je ne sais pas ce que je ressens au juste, une sorte de lassitude, je suppose, la fin d’un cycle approche.
Ensuite, je sais qu’on a pris quelques jours libres, pour prendre du recul. Il a installé deux banquettes dans le patio pour profiter de la douceur des après-midi de fin de cycle. Les aalions en fleur nous enrobaient de leur parfum suave, le ciel était traversé de nuages d’altitude. C’est très clair dans ma tête.
Et puis, brutalement, on est en début de cycle. Je ne comprends pas ce qui s’est passé. Par la vitre du véhicule, je regarde défiler le paysage comme s’il pouvait m’aider à réunir tout ce qui, dans ma tête, se disperse. Entre les arbres, je vois le soleil couchant qui apparaît par intermittence. Petit à petit, je reconnais la route, on est sur le couloir périphérique bordé d’arbres de Myrtis, on roule vers la maison.
Je me vois descendre de voiture, me mettre au lit. C’est comme si tout se passait en simultané, je suis dans la voiture et déjà au lit, dans la chambre de Stephen. Il m’explique quelque chose à propos d’affaires qu’il faut prendre, ou qu’il a ramenées, j’ai du mal à saisir ce dont il parle. Il sort d’un sac une de mes tuniques. Je n’arrive pas à articuler ma pensée, alors je le regarde bêtement sortir un à un mes vêtements et les placer dans l’auto-clean.
Tout le monde dit que c’est normal, que ça fait partie du processus. J’ai subi une opération, semble-t-il. J’ai été opérée.
Pourtant j’étais contre. Je ne sais plus vraiment pourquoi, mais j’étais contre. Je revois Stephen dire : « J’attendrai que tu sois prête. » Ou bien c’était à propos d’autre chose… Les souvenirs que je garde des derniers jours sont incomplets, flous. Je vois encore ce ciel à la fois violent et étrangement calme avec une précision effrayante. Quand était-ce ?
Les images me reviennent sans hiérarchie. Stephen dans sa chambre, en contre-jour. Il s’est passé quelque chose, il est bouleversé.
Un entretien avec le conseiller : « La fonction de rappel est optimisée, affirme-t-il. Le mémoriel est fiable il est stocké, classé, accessible, transmissible. Les souvenirs sont stables, ils ne sont plus altérés par le temps, ne se modifient plus. »
Il joint les deux mains pour appuyer son propos, les applique à plat sur la table. Tous ses gestes ont quelque chose de rassurant, de solide. Mais pourquoi le temps altère-t-il les souvenirs ? Pourquoi la mémoire humaine est-elle sélective ? L’oubli doit avoir une fonction… Consolider certains souvenirs, en effacer d’autres permet à chacun de conserver du passé une idée différente. Ça construit notre identité individuelle…
Il est encore tôt, toute la chambre est plongée dans la lumière verte de Vesma, Stephen est couché à côté de moi. Je ne sais pas si il dort, je vois son profil ourlé de vert. Il a consulté ma mémoire aujourd’hui… Tout cela est tellement étrange.
Le lendemain, on va visiter la chapelle Fidalis. En surface, c’est un bâtiment quelconque entouré de sièges sociaux de banques et de sociétés d’assurance civile. Ascenseur jusqu’au sixième sous-sol. Les portes s’ouvrent sur une grande salle voûtée. Le sol, d’un bleu sombre, presque noir, contraste avec les colonnes orange vif. C’est ici que seront désormais archivées nos images, à l’abri de tout risque de détérioration. L’alignement des centaines de niches murales, à perte de vue, donne le vertige. Tous ces espoirs regroupés ici, sous terre…
On suit le tracé lumineux qui nous guide jusqu’à notre emplacement. C’est un petit autel semblable à tous les autres surmonté d’une espèce de marquise en matière composite. Un peu plus loin dans la même rangée, un groupe se tient devant un autel identique et parle à voix basse. Malgré moi, je me suis émue. Je jette un regard à Stephen, droit comme une sentinelle. C’est un étranger total.
Alors qu’on émerge à la surface dans le jour blafard, il me prend par le bras : « Lucy… »
Sa voix, à travers le masque, a cette teinte métallique. « Je… »
Il ne termine pas sa phrase. Ses joues rosissent, il tend vers moi ses bras anguleux et à cet instant ils ressemblent à des tentacules. Il prend mon cou dans sa paume, m’attire contre lui.
Dans ma tête, les questions se bousculent. J’ai peur, j’ai froid, j’ai l’impression de ne plus m’appartenir, mais je me laisse faire. Il se met à me bercer doucement, le temps s’arrête quelques instants. Mais je l’entends murmurer dans ma nuque : « J’ai consulté ta nuit, j’ai vu que tu avais des doutes… »
Un frisson me parcourt l’échine, je me dégage de son étreinte et le regarde. Lui aussi me regarde, inquisiteur. Je me sens transparente sous ses yeux, il pourra savoir exactement ce que j’ai ressenti à cet instant.
J’ai hésité tout la soirée. Finalement, au début de la deuxième nuit je n’y tiens plus et descends allumer le terminal. Il faut que j’en aie le cœur net. J’ouvre le répertoire Fidalis, le menu des options s’affiche.
GESTION DU MÉMORIEL
Archivage des données
Insertion d’index mémoriels programmables
Valorisation des souvenirs
Création d’une banque de souvenirs
MISES À JOUR
Mise à jour de l’image mémorielle
Sauvegarde externe automatique
Correction automatique des variables
CONSULTATION DU MÉMORIEL
Recherche type
Consultation des courbes d’évolution
Consultation accélérée en narration standard
Consultation aléatoire
Consultation aléatoire, parfait. J’ai le souffle un peu court tout à coup. J’enclenche l’inhibiteur et, avant de changer d’avis, lance la consultation. Une sensation étrange s’empare de moi, pénètre ma peau, mes muscles. Ma perception change, tout est différent, nouveau. Même la maison est transfigurée, elle a l’air plus petite et désordonnée, plus chaleureuse aussi. C’est une vision incroyablement intime, les objets, l’espace, portent l’empreinte d’habitudes inconnues. Et je remarque que les issues (la porte, les vitrages) ont l’air trop petites, ou moins praticables.
C’est alors que je vois cette femme — moi, vue à travers ses yeux. Transformée, sévère, l’air à la fois fermé et étrangement soumis. Mes yeux, maquillés de vert pâle, sont fuyants. Je retire le câble et reviens au réel, j’ai le cœur qui bat à tout rompre.
L’inhibiteur cesse de fonctionner. Je réintègre progressivement mes sensations. Pendant plusieurs minutes, je perçois tout avec une acuité aiguë, mes pieds nus sur le revêtement synthétique du sol, la lumière oblique qui tombe sur mon épaule… C’est comme si je me tenais hors de mon corps. Je vois nos deux masques, au pied du terminal, sagement posés sur leur chargeur commun, le petit voyant qui clignote sur le socle, témoin de la charge. Le monde n’est plus aussi réel…
Cinq dials ont passé. Je ne sais plus qui je suis.
Stephen organise nos journées. Comme une somnambule, j’accumule du ressenti, je stocke. Comme si la vie réelle allait avoir lieu ailleurs, au calme, lorsque les choses auraient recouvré leur finitude initiale.
J’ai pensé à m’enfuir mais où que j’aille, je serai accompagnée. Stephen saura ce que je fais, ce que je pense.
De nouveau aujourd’hui, j’ai allumé le terminal. Cette fois-ci, j’ai fait apparaître le contrat Fidalis pour voir les modalités de résiliation. J’ai tout lu et relu attentivement mais aucune clause n’est prévue pour revenir en arrière. L’image mémorielle est définitive. On ne peut ni l’effacer ni stopper l’encodage des souvenirs. Tout ce que je peux faire, c’est restreindre la liste des membres autorisés à les consulter, autrement dit bloquer l’accès de Stephen à mon image.
J’ai attendu qu’il rentre pour lui annoncer ma décision. Comme je m’y attendais, il a mal réagi. D’après lui, j’agissais dans la précipitation, c’était absurde, j’allais changer d’avis. Il a invoqué son ancienne concubine, sa dépression…
« Tu devrais y réfléchir encore avant de faire quelque chose que tu pourrais regretter.
— Ma décision est prise, ai-je répondu froidement. J’ai réuni mes affaires, je pars demain m’installer dans une résidence de transit. »
Par la vitre du véhicule, je regarde la route qui défile, les champs d’aréoles.
Je ne suis pas dans mon état normal, je n’arrive pas à situer les choses. Je vois les arbres de Myrtis qui bordent la route, mais on est à la maison. Stephen a réuni quelques amis. Il y a quelque chose d’anormal. Je ne comprends pas de quoi ils parlent. Stephen n’arrête pas de répéter que tout va bien, que c’est normal.
Il stationne le véhicule à la borne de la résidence, me prend par le bras et me guide jusqu’à notre maison.
P.S.
Les traductions, sauf explicitement mentionnées, ont été réalisées par nos soins.
Noël 2010