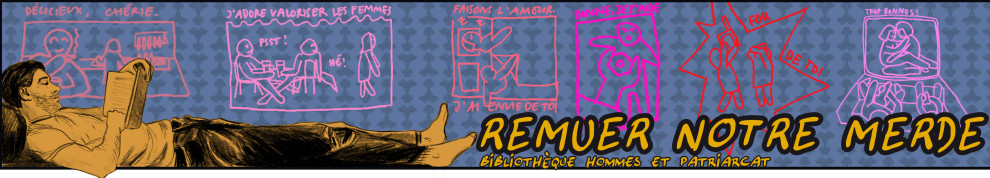« Ainsi, de briser le silence, la question devient celle de comment libérer la parole de manière à ce que chacun.e puisse, vis-à-vis de son vécu, examiner ses gestes. »
« Ainsi, de briser le silence, la question devient celle de comment libérer la parole de manière à ce que chacun.e puisse, vis-à-vis de son vécu, examiner ses gestes. »
Ce texte, publié initialement à Montréal en février 2014, traite de la question des agressions sexuelles et des réponses à leur donner…
Anonyme, 2014
publié par Tout mais pas l’indifférence
PDF mis en page
PDF page par page
Depuis quelques mois, les dénonciations d’agressions sexuelles se succèdent à l’intérieur du milieu militant montréalais. D’abord, il y a eu l’envie d’affronter la culture du silence et les positions de principe inappliquées qui traversent ce dit milieu. Il y a eu l’envie de confronter l’habitude de préserver un front uni des conflits internes, d’attaquer la loi paternelle ou patriarcale qui veut toujours escamoter les violences sous le tapis de la bonne entente à la table familiale, qui cherche à minimiser les actes destructeurs pour éviter « la chicane ».
Une des grandes forces du féminisme est bien d’ouvrir une porte qui nous permet d’interroger nos rapports, d’examiner leur ancrage structurel, en vue de s’affranchir des normes qui les régissent. Pourtant, nous ressentons que la situation actuelle bloque le débat : des tabous apparaissent, toutes les avenues semblent piégées.
Est-ce normal que, même si nous nous considérons féministes, nous trouvions difficile de prendre la parole pour interroger ce qui se passe, pour nommer notre malaise qui va grandissant ? Nous le faisons même si nous sentons que cela nous fait aujourd’hui courir le risque de nous faire traiter en ennemies, ou associer au backlash. Ni silence, ni censure.
Nous allons donc tenter d’exprimer quelques réserves, pointer les dangers qui nous guettent, les dérives possibles, et surtout, tenter de rouvrir la porte.
* * *
Derrière les principes à la base des processus en cours, il y a des raisons, des attentions qu’il s’agit de faire valoir. Ces raisons et ces attentions, nous les partageons. Par exemple, il est bien entendu nécessaire que ceux et celles qui vivent des agressions soient en mesure d’en parler et de ne pas être isolé.e.s dans le silence. Cette nécessité implique que le mot agression ne soit pas attribué à des gestes en particulier, ou qu’il en exclue d’autres : il désigne une façon de poser des gestes, et c’est à la personne qui les vit comme tels de l’établir. Ainsi, il n’y a pas à remettre en question ce vécu – car cela reviendrait à discréditer et à bloquer la mise en partage d’expériences douloureuses, et à faire l’impasse sur la problématique de l’attention à l’autre dans nos relations. Si ce sont ces mêmes sensibilités qui nous guident, nous croyons toutefois qu’elles ne peuvent donner lieu à un protocole de règlement, non critiquable et applicable sans égard aux situations. Ainsi, c’est le traitement que nous souhaitons questionner.
Le processus en cours semble être porté par deux logiques. D’un côté, ce qui est appelé « justice transformatrice » suppose un tissu de relations déjà existantes avec lesquelles il faut composer, une « communauté » plus ou moins concrète, ainsi qu’une volonté, plutôt bienveillante, d’investir les rapports et de les transformer. De l’autre côté, le fond théorique qui sous-tend le discours est celui d’une opposition claire, catégorique, contre la classe des « hommes » – visible dans des déclarations du type « tous les hommes ne sont pas des agresseurs, mais tous les hommes profitent des agressions », ou dans la réticence exprimée à l’idée que des hommes discutent entre eux des rapports de domination. On affirme ainsi une logique plutôt guerrière, où il ne s’agit plus de composer mais de combattre le camp opposé, celui des « hommes ».
Deux tendances s’entremêlent : soit il y a une communauté qui devrait collaborer de bonne volonté avec les visées transformatrices du comité, soit c’est la division sexuée qui prévaut, et toute communauté n’est qu’une fiction qui recouvre la réalité violente de la division entre hommes et femmes. Ni l’une ni l’autre de ces logiques n’est fausse en soi, lorsqu’elles sont assumées comme telles : ce qui trouble, c’est leur cohabitation non problématisée, et les contradictions à laquelle elle donne lieu.
Ainsi, le comité de justice transformatrice se retrouve dans la situation ambiguë de mener en même temps un combat frontal contre la logique de solidarité masculine et la domination patriarcale en général, et de ne devoir en même temps son pouvoir et sa légitimité qu’à son activité au sein d’une communauté militante qui, se disant « féministe », se doit d’être cohérente avec ses propres principes. L’efficacité des moyens de base du processus, la dénonciation « publique » d’agresseurs et leur exclusion, repose d’ailleurs sur l’existence d’une telle communauté, qui s’en fait garante. Suivant un même mouvement, une autre contradiction taraude : alors que les hommes, surtout, mais aussi les critiques, n’ont pas voix au chapitre, on s’attend à ce qu’ils respectent, voire à ce qu’ils adhèrent explicitement au consensus général, fondateur de la communauté.
Cette contradiction nous mène donc à l’hybridation quelque peu effrayante des deux logiques, conservant le spectre d’action et le soft power de l’une, et l’intransigeance de l’autre. Ainsi, ni la réelle transformation des rapports ni la guerre ne sont assumées en tant que telles.
Une telle ambiguïté ouvre la porte à ce que le processus dégénère en une simple justice d’exception. Étrange asymétrie où une fois que tombe l’opprobre, l’individu accusé, automatiquement coupable, ne bénéficie pas des principes sur la base desquels il est jugé. La justice d’exception permet aussi au comité de combiner les rôles d’accusateur, de juge et d’exécutant de la peine. L’idée ici n’est pas de s’insurger contre le « traitement injuste » fait à l’accusé, de crier au non-respect de la présomption d’innocence – après tout, il peut être entendable que le respect de ces principes n’est le problème ni de la personne ayant vécu une agression, ni du comité. Ce qui est plus inquiétant, à plus long terme, c’est ce à quoi nous amène collectivement une telle logique d’exception : face à une telle « justice », situation kafkaïenne où rien ne semble pouvoir être dit ni discuté, on pourrait en venir à regretter le bon vieux tribunal d’État.
* * *
Les actes de dénonciation résument en eux-mêmes toute la confusion du processus en cours, rassemblant en un seul geste une déclaration de guerre et l’ouverture d’un processus de transformation des rapports. On ne saurait remettre en doute la nécessité de sortir du silence, même si cela implique des conflits à l’intérieur du dit milieu. Or, on ne peut pour autant éviter d’affronter la question de savoir à qui l’on s’adresse et pourquoi.
Beaucoup de collectifs de féministes black et de queers [1] se sont confrontés à ce problème : faire appel à la justice de l’État ou ne serait-ce qu’aux médias redoublait la violence de la société à leur encontre sans rien résoudre des violences dans leurs communautés. Les processus de justice transformatrice sont en partie nés dans de tels contextes [2]. Ces collectifs prenaient acte de l’impasse logique qu’il y aurait à prendre pour juge une société qui les opprime dont ils nient les fondements. La question posée par un certain féminisme est ici celle de faire tenir ensemble une communauté de lutte qui s’oppose à l’ordre dominant, tout en tentant de contrer les reproductions de cet ordre à l’intérieur de cette dite communauté. Il s’agit donc de maintenir l’opposition contre la société majoritaire, tout en travaillant les divisions internes, refusant toute hiérarchie entre ces deux fronts.
La « justice transformatrice » désigne une manière d’agir dans cette complexité. Elle part du constat que ces violences qui se produisent dans une communauté, quand bien même une ou deux personnes serait punies ou exclues, continuent d’arriver. Elle analyse la situation non pas à travers le spectre judiciaire – qui cherche à désigner un coupable et le punir – mais plutôt à travers les agencements collectifs de pouvoir dans lesquels ces gestes se produisent [3]. La justice transformatrice mise sur la possibilité de modifier les conditions mêmes qui permettent une reproduction de ces violences et pas seulement à exclure quelques éléments indésirables, au fur et à mesure qu’ils apparaissent. Elle tend à se distinguer autant du modèle judiciaire étatique que du spectre d’une « justice populaire », qui n’est pas non plus exempte de dérives.
En ce sens, peut-on faire l’économie de se demander : à qui s’adressent les dénonciations ? Quel est leur objectif ? On ne pourra s’empêcher de nommer le malaise suscité par un usage symptomatique de Facebook. Drôle de substitut à « l’espace public » inexistant, Facebook est devenu depuis quelques années l’espace de discussion – et d’exposition – par défaut du milieu militant. Et pourtant, ce n’est pas sans péril, car n’oublions pas que sur Facebook, au bout des multiples partages entre « amis », le post intial est accessible à tout chroniqueur, journaliste, employeur, professeur, famille, etc. : à la société entière. Or si la dénonciation publique rend ainsi le privé « public », elle ne le rend pas pour autant automatiquement politique. Rendre politique, c’est-à-dire parler de ce qui est d’habitude confiné au privé, le mettre en partage de façon à tordre un peu nos relations, à faire réfléchir, problématiser les gestes.
Ce n’est jamais simple. Un processus de justice transformatrice, tel que pensé à l’origine, demande avant tout l’instauration d’un climat de bienveillance, de possibilité de dialogue. Ainsi, il devient nécessaire de ne pas bloquer l’échange, la mise en récit, le partage d’expériences.
Évidemment, on n’est jamais obligé de raconter, et le faire ne verse pas forcément dans le compte-rendu policier ou dans le voyeurisme violent qui accompagne l’exactitude des horaires, des dates, des personnes ou des lieux. Il ne s’agit pas de « prouver » qu’il y a eu agression, d’exiger que « justice soit rendue » par l’établissement des faits et d’une définition exacte de ce qui constitue une agression. Il s’agirait plutôt de raconter un geste, un comportement auparavant peut-être jugé inoffensif et dont il faudrait parler, d’autres pouvant s’y reconnaître. Des questions qui pourraient être alors posées : dans quels contextes ces agressions surviennent-elles ? Comment s’est établi ce rapport inégalitaire ? Qu’est-ce qui permet l’inattention à l’autre, à ses signaux ?
Raconter les agressions ainsi, de façon à politiser nos gestes, à les investir, cela implique une certaine prudence dans le recours à la dénonciation punitive. Et à éviter l’usage trop rapide d’une catégorie « agresseur » abstraite, indiscutable, inamovible. Ces dénonciations tombent telles un couperet : elles servent à la fois d’accusation, c’est-à-dire de déclaration de litige et de volonté de réparation, mais aussi de publicisation du geste reproché à une communauté abstraite et au-delà, à n’importe qui, même mal intentionné. Car elles agissent comme une punition immédiate : le jugement est d’emblée donné dans l’accusation, qui ne saurait être remis en cause, et la punition est incluse au passage, par opinion publique interposée. Peut bien s’ensuivre un processus de réparation à la mesure des besoins de la personne ayant vécu une agression : l’exclusion est déjà effective. Il ne s’agit pas de condamner tout recours à Facebook, toute désignation d’un agresseur dans la sphère publique. Seulement, un tel geste ne peut être considéré que comme une stratégie située, comme un outil, partie intégrante d’un processus, destiné à être chaque fois réadaptée à la situation – et non pas comme son point de départ automatique.
Ici, l’exposition du privé mène plutôt à départager entre bons et méchants, force à trancher, ou plutôt à appliquer les bons principes, à prendre des « positions » qui sont de simples étiquettes – « es-tu féministe, ou pas ? ». Une dérive pointe à l’horizon. C’est le passage des intentions réparatrices à un code de déontologie. Alors ces principes se renferment, s’appauvrissent en caricatures d’eux-mêmes : ce qui importe n’est plus de prêter attention les un.e.s aux autres mais de respecter un droit, des codes, qui nous protégeraient de nos déplorables manques d’attention, voire nous déchargeraient de la nécessité de prendre soin.
* * *
En somme il s’agit d’articuler deux plans, sans jamais les confondre : celui du bien-être de la personne ayant vécu une agression, qui cherche à se reconstruire, et pour laquelle il peut être absolument nécessaire de ne pas croiser la personne qui lui a fait du tort dans certains espaces, et le plan de la communauté à transformer. Pour qu’une telle transformation puisse avoir lieu, il s’agit dès lors d’ouvrir toutes les portes à la discussion, et mettre en partage des expériences, des vécus difficiles, de les affronter. Si le premier aspect implique la personne ayant commis une agression en tant qu’individu, le deuxième doit reconnaître la dimension structurelle et impersonnelle de la violence et de la domination. C’est sans doute la plus grande difficulté à laquelle la situation actuelle nous confronte.
Le deuxième plan excède le cas particulier, qu’il arrache à son exceptionnalité pour l’inscrire dans une dynamique plus large. Il implique d’éviter l’illusion selon laquelle la communauté pourrait se refonder sur une purge salvatrice. La justice d’État fonctionne en partie d’après ce précepte, et pourtant chacun sait qu’elle n’est qu’un système reproduisant cela même qu’elle dit combattre. Identifiant le déviant, l’inscrivant « hors la loi », la société se légitime elle-même, se renforce et se donne bonne conscience. Le recours au cas exemplaire permet à tous ceux qui ne sont pas directement visés par l’accusation de se laver de tout soupçon, notamment en affirmant publiquement leur adhésion au processus. L’effectivité d’un tel recours repose moins sur l’examen intime et collectif des logiques de domination qui contaminent nos rapports, que sur la peur d’être incriminé à son tour. Certes, ce procédé a historiquement fait ses preuves, il peut certainement arriver à modifier les comportements. On peut toutefois douter de sa capacité à installer le climat de confiance nécessaire à l’élaboration durable d’autres rapports.
C’est à ce point, précisément, que se révèle toute la complexité du brouillage entre ami.e.s et ennemi.e.s, à laquelle le féminisme se retrouve sans cesse confronté. Une réelle transformation ne viendra pas de l’adoption d’un code de comportements irréprochables, mais bien de l’attention toujours renouvelée à l’autre et aux signes qu’il ou elle envoie, à la circulation du pouvoir, à la complexité et la profondeur des relations.
Ainsi, de briser le silence, la question devient celle de comment libérer la parole de manière à ce que chacun.e puisse, vis-à-vis de son vécu, examiner ses gestes. Si le problème n’est pas le désir en soi, ni même la séduction, il va sans dire qu’un rapport à l’autre en tant que corps disponible et interchangeable ne pourrait jamais être recevable. Pour dépasser cette superficialité, cette violente médiocrité, il ne s’agit pas de définir les bons comportements. Ce dont il faudrait parler c’est aussi de ce flou, de cette maladresse qu’on a à exprimer nos désirs, notre nullité émotive et gestuelle, la façon qu’on a de se rabattre sur des gestes déconnectés, calqués sur les écrans, parfois trash, en tout cas inattentifs. Se l’admettre, explorer les façons singulières que ça a de se déployer en chacune de nous, de nos relations : voilà peut-être ce qui pourrait nous donner de la force.
P.S.
Publié initialement le 26 février 2014 sur le blog colonellerobles.wordpress.com.
[1] cf. le livre collectif Black Feminism : Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000 (L’Harmattan).
[2] cf. le Social Justice Journal.
[3] Ching-In Chen, Jai Dulani, Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha, The Revolution starts at home : confronting intimate violence within activist communities (South end press).