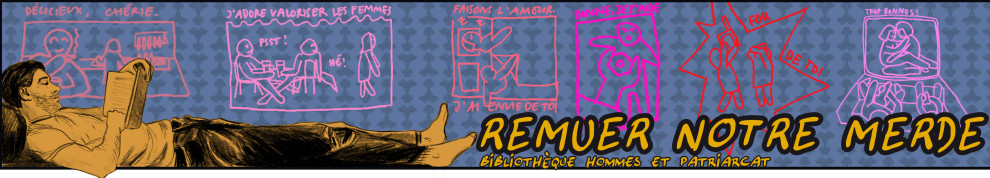Des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie.
Des déterminants matériels et psychiques de la conscience dominée des femmes, et de quelques-unes de leurs interprétations en ethnologie.
Chapitre V du livre L’anatomie politique, catégorisations et idéologies du sexe
Que l’anthropologie soit fille de l’impérialisme occidental, non seulement historiquement mais dans l’idéologie même qu’elle a pour une grande part véhiculée à travers ses descriptions ”scientifiques”, est un point désormais à peu près acquis. De nos jours, nombre d’ethnologues prennent des options ouverte de « défense » (et pas seulement d’illustration) des cultures minoritaires : dénonciation de l’impérialisme, des génocides, du fait néocolonial, ou de la colonisation intérieure de certaines minorités par les nouvelles (ou anciennes) cultures nationales, dénonciation de l’« ethnocide » – l’accent étant mis (ce que faisait déjà une partie de l’ethnologie traditionnelle à sur les valeurs, les organisations socio-politique et/ou les rationalités économiques, jugées meilleurs que les nôtres, qu’ont produites certaines de ces cultures en voie de disparition par « notre faute » – et, pour certains, appel à un véritable «engagement » de l’ethnologue auprès de la population avec laquelle il travaille.
Dans les différentes positions prises par des ethnologues occidentaux vis-à-vis des cultures minoritaires (qu’elles soient encore isolées, ou moins relativement, ou régionales ou nationales), on peut parfaitement discerner les orientations politiques qu’ils ont dans leur propre société, et il s’agit de fait d’un débat politique.
Soit. Mais la question que je pose est alors la suivante : quels minoritaires défendent ces ethnologues « engagés » ? À quels minoritaires s’intéresse ce noble débat, cette apologie de l’Autre ? Et bien (sans doute par définition : ethno-logie), aux «ethnies » minoritaires, aux « cultures » minoritaires, aux « sociétés » minoritaires, aux « économies » minoritaires, et même aux « groupes » minoritaires.
de Nicole-Claude Mathieu
publié par Éditions Côté-femmes, 1991
PDF mis en page
PDF page par page
La femme est, ainsi que l’homme, un être libre et puissant ; libre, en ce qu’il a l’entier exercice de ses facultés ; puissant, en ce que ses facultés égalent ses besoins.
Quand on parcourt l’histoire des différents peuples et qu’on examine les lois et les usages promulgués et établis à l’égard des femmes, on est tenté de croire qu’elles n’ont que cédé, et non pas consenti au contrat social, qu’elles ont été primitivement subjuguées, et que l’homme a sur elles un droit de conquête dont il use rigoureusement.
Et balaie-moi tous les obscurcisseurs, tous les inventeurs du subterfuges, tous les charlatans mystificateurs, tous les manieurs de charabia. Et n’essaie pas de savoir si ces messieurs sont personnellement de bonne ou de mauvaise fois, s’ils sont personnellement bien ou mal intentionnés, s’ils sont personnellement, c’est-à-dire dans leur conscience intime de Pierre ou Paul, colonialiste ou non, l’essentiel étant que leur très aléatoire bonne foi subjective est sans rapport aucun avec la portée objective et sociale de la mauvaise besogne qu’ils font de chiens de garde du colonialisme.
L’oppresseur n’entend pas ce que dit son opprimé comme un langage mais comme son bruit. C’est dans la définition de l’oppression […]
L’oppresseur qui fait le louable effort d’écouter (libéral intellectuel) n’entend pas mieux.
Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. C’est ainsi que de nombreux mots ont pour l’oppresseur une connotation-jouissance, et pour l’opprimé une connotation-souffrance. Ou : divertissement-corvée. Ou : loisir-travail. Etc. Allez donc causer sur ces bases.
Préambule sur soi et les autres
Ethnocentrisme et/ou androcentrisme
Que l’anthropologie soit fille de l’impérialisme occidental, non seulement historiquement mais dans l’idéologie même qu’elle a pour une grande part véhiculée à travers ses descriptions « scientifiques », est un point désormais à peu près acquis. De nos jours, nombre d’ethnologues prennent des options ouverte de « défense » (et pas seulement d’illustration) des cultures minoritaires : dénonciation de l’impérialisme, des génocides, du fait néocolonial, ou de la colonisation intérieure de certaines minorités par les nouvelles (ou anciennes) cultures nationales, dénonciation de l’« ethnocide » – l’accent étant mis (ce que faisait déjà une partie de l’ethnologie traditionnelle à sur les valeurs, les organisations socio-politique et/ou les rationalités économiques, jugées meilleurs que les nôtres, qu’ont produites certaines de ces cultures en voie de disparition par « notre faute » – et, pour certains, appel à un véritable « engagement » de l’ethnologue auprès de la population avec laquelle il travaille.
Dans les différentes positions prises par des ethnologues occidentaux vis-à-vis des cultures minoritaires (qu’elles soient encore isolées, ou moins relativement, ou régionales ou nationales), on peut parfaitement discerner les orientations politiques qu’ils ont dans leur propre société, et il s’agit de fait d’un débat politique.
Soit. Mais la question que je pose est alors la suivante : quels minoritaires défendent ces ethnologues « engagés » ? À quels minoritaires s’intéresse ce noble débat, cette apologie de l’Autre ? Et bien (sans doute par définition : ethno-logie), aux « ethnies » minoritaires, aux « cultures » minoritaires, aux « sociétés » minoritaires, aux « économies » minoritaires, et même aux « groupes » minoritaires.
Certes d’autres débats opposent différentes définitions de ces réalités. Mais la définition conceptuelle et politique commune, et cachée parce qu’évidente, que recouvrent ces mots et ces discours et que les groupes, les ensembles humains (minoritaires comme majoritaires) auxquels s’intéresse l’ethnologie sont (= doivent être) composés d’hommes et de femmes, point à la ligne, passons aux choses sérieuses, par exemple les ethnies minorisées, ethnocidées, génocidées. Et du même coup nous voyons s’opérer une dissociation entre la notion de « minoritaire », la notion de « dominé », d’« ethnocidé », et la notion de (groupe de) sexe 1.
Car dans tous ces minoritaires, ces Autres à reconnaître, à respecter, à « aider », ou même à « libérer », point de femmes2. Même dans les cas où il apparaît bien à certains ethnologues qu’existe, dans telle société, une « domination » des hommes sur les femmes, en définitive, ou plus exactement en priorité (et les priorités sont toujours quelque part définitives), c’est la société, la culture « globale » qu’il faudra sauvegarder, protéger, ou « libérer », au nom de la non-ingérence dans les affaires intérieures des sociétés3 Nous sommes bien en ethno-logie, et loin d’une anthropo-logie, ou plutôt dans une anthropologie qui nous donne une preuve supplémentaire que la science de l’être humain demeure une science de l’homme… Une politique pour l’homme ?
Aux ethnologues qui posent, à juste titre, des questions sur une certaine pratique de l’anthropologie, je peux seulement répondre que je ne saurais « défendre » aucune société, culture, option ou idéologie (fût-elle minoritaire d’un certain point de vue) dont la survie en l’état, le « progrès », la « modernisation » ou l’expansion dépendrait de l’oppression des femmes, ou l’aménagerait.
Aujourd’hui, les anthropologues « féministes » et les « féministes » occidentales en général4 sont à la fois accusées d’ethnocentrisme, d’impérialisme, et même de racisme, soit par leurs collègues hommes et femmes occidentaux « défenseurs » des peuples opprimés5, soit par certain(e)s représentant(e)s de ces peuples. Non seulement elles se mêleraient des affaires « intérieures » des autres « peuples » (les femmes en tant que peuple n’existant pas, voir plus haut), mais elles projetteraient « leurs problèmes » et leurs catégories sur des sociétés qui n’en peuvent mais, et où, au surplus, les femmes ne sont pas opprimées ou, si elles le sont, pas du tout de la même manière, ou ne le voient pas, ou ne voient pas de mal à ça…
Je tiens que ces accusations, lorsqu’elles sont produites par des occidentaux :
A. – Procèdent d’une forme d’ethnocentrisme, qui consistent en définitive à vouloir maintenir nos sociétés occidentales à part, donc à les considérer comme exceptionnelles (puisqu’on ne peut plus les dire supérieures) sous le prétexte qu’elles en dominent d’autres. ceci permet alors d’interdire qu’un problème « interne » à notre société (l’oppression des femmes) puisse être considéré comme ayant quelque rapport que ce soit même au niveau de la connaissance avec un problème « interne » qui se passe ailleurs. Or, semble-t-il, personne ne s’est jamais vu interdire d’aller étudier la « royauté » chez les X, Y, Z sous prétexte que là-bas le roi n’y peut toucher le sol, ou est mis à mort rituellement ; ni de réfléchir sur les « rapports de production » dans une société quelconque sous prétexte que la notion de travail n’y est pas la même, que les gens disent « on se promène » lorsqu’ils vont quêter leur subsistance.
L’étude des différences de formes, de contenus, ou de mêmes structures apparentes subsumées sous un même terme, relevant quelque part d’une même « réalité » (mettons « l’esclavage »), n’a jamais fait qu’enrichir l’appréhension de mécanismes généraux éventuels et en éclairer en retour les spécificités historiques. Mais voilà qu’il est mal venu, apparemment, pour l’oppression des femmes en tant que groupe.
B. – Procèdent de la négation, à l’intérieur même ce cet ethnocentrisme dont s’entre-accusent si volontiers certains ethnologues, de l’androcentrisme qui, s’il est loin d’être propre à notre société, en est partie intégrante puisque produit par le rapport du pouvoir entre les sexes dans cette société, rapport qui modèle les catégories de la connaissance ethnologique tout autant que d’autres rapports sociaux. (Montrer ceci fut l’une de premières tâches des anthropologues féministes, et plus généralement des féministes, universitaires ou non, dans divers domaines de la connaissance.) c – Procèdent d’une méconnaissance de la sociologie6. J’entends ici par « sociologie » deux choses :
a) le corps constitué du savoir académique qui s’intitule lui-même ainsi et étudie plutôt nos propres sociétés. Or, deux types de production de cette discipline, importants pour l’étude des rapports de sexe, sont d’une part la sociologie de la connaissance, de l’autre celle des minorités intérieures. Notons qu’il semble y avoir peu de rapports entre les ethnologues qui s’intéressent à la notion d’ethnie et les sociologues des minorités… Notons aussi qu’il a fallu l’intervention des féministes pour que les femmes soient considérées en sociologie comme un groupe « minoritaire »7.
b) j’entends surtout tout essai de réflexion sur les mécanismes propres à nos sociétés, ce qui, concernant les sexes, peut aussi bien s’appeler (si on parle de « disciplines ») sociologie, histoire, etc. ou (si l’on parle de « politiques ») féminisme ou antiféminisme. Les mouvements politiques minoritaires constitués d’universitaire et de non-universitaires ont parfois davantage contribué à cette « connaissance » que tous les historiens, sociologues ou anthropologues en titre du monde.
Et la méconnaissance, justement, de cette réflexion minoritaire, même sous sa forme académique et « intellectuelle », publiée donc accessible, révèle d’une idéologie obtuse qui préfère souvent fantasmer les problématiques féministes que les connaître dans l’espoir de se défendre.
Car dissocier ainsi le notion de « minoritaire » de la notion de « femme » à propos des cultures « autres » (y compris les minorités nationales) permet à tout un courant de pensée de nier un problème dont les ethnologues sont partie prenante dans leur propre société nationale. Refuser une prétendue ingérence dans les « affaires intérieures » des autres sociétés consiste en fait, concernant les sexes, d’une part à refuser de penser nos affaires intérieures, d’autre part et corrélativement à continuer de dissimuler une réalité fondamentale des sociétés étudiées. Ceci a donc des implications « académiques », au niveau de la connaissance ethnologique, mais aussi déontologiques car politiques pour les groupes concernés.
Si bien qu’on peut se demander qui est le plus « ethnocentrique », des « féministes » qui veulent diversifier l’étude de l’oppression des femmes (qu’elles connaissent de l’intérieur) dans d’autres structures sociales, ou des tenants d’une « neutralité » de bon aloi qui ne font — par leurs écrits et souvent leur attitude sur le terrain — que dupliquer le pouvoir des hommes sur les femmes, ici et ailleurs. L’ethnocentrisme et l’androcentrisme font alors bon ménage.
Non que tout ce qui se dit d’un point de vue androcentrique soit « faux », ni que tout ce qui se dit d’un point de vue « gynocentrique » soit vrai. Mais on ne peut se contenter d’avoir en cette matière un jugement de symétrie. En effet, l’un est un discours prégnant, majoritaire, ancien,et établi, l’autre un discours débutant, contradictoire parce que minoritaire et menacé (menaçant l’ordre établi). Une question « bien posée » peut n’être que le vain raffinement d’un discours creux mais assis sur la plénitude du pouvoir, une question « mal posée » dévoiler un questionnement… vertigineux devant le vide épistémologique !
L’enjeu, les intérêts n’étant pas les mêmes de part et d’autre (ils sont même antagonistes), la connaissance ne sera pas la même selon la place du locuteur dans le champ des rapports de sexe. Plus, rappelons que si l’on peut — dans un rapport d’exploitation donné — parler d’une position objective de classe pour les dominants, et d’une position objective de classe pour les dominés, on ne retrouve pas cette opposition simple dans le champ de la conscience. Il existe chez les dominés plusieurs types de conscience et de production de connaissance, fragmentés et contradictoires, dus justement aux mécanismes mêmes de l’oppression, ce dont nous tenterons de montrer des exemples8.
Pour les opprimé(e)s, une position de classe objective ne donne pas une seule forme de conscience. Il n’y a donc pas, concernant les rapports de sexe, la « position de conscience » des hommes et la position de conscience des femmes, mais la position des hommes (avec variantes plus ou moins subtiles) et les positions des femmes. Il y a un champ de conscience structuré et donné pour les dominants, et de toute façon cohérent face à la moindre menace contre leur pouvoir9 ; et diverses modalités de fragmentation, de contradiction, d’adaptation ou de refus… plus ou moins (dé)structurées de la part des dominé(e)s10, modalités dont l’appréhension semble particulièrement malaisée pour un dominant.
L’ethnologue, l’avocat et le juge.
Leurs contradictions et celles des « Autres »…
Dans un livre récent, Derek Fremnan (1983) reproche à Margaret Mead d’avoir fait une description idyllique de Samoa pour ce qui est des relations sexuelles prémaritales entre jeunes gens, et de n’avoir pas vu l’importance du viol (« subreptice » et « par force » ) et son caractère tout à fait courant à Samoa.
Avant d’en venir à l’argumentation de l’auteur, précisons tout de suite que si j’utilise ce livre, ce sera pour montrer un type de raisonnement simpliste (et fort courant) niant les contradictions que subissent les femmes. Pour ce faire — et bien que non qualifiée pour juger de l’ethnographie samoane —, j’admets comme hypothèse vraisemblable que Mead ait pu effectivement sous-estimer la violence structurelle contre les femmes de la sexualité des hommes à Samoa. Hypothèse vraisemblable pour plusieurs raisons : a) parce que cette violence est attestée par d’autres auteurs (cf. récemment Shore 1981 ; et Ortner 1981, notamment sur « le sexe comme vol » en Polynésie, pp. 373-375) ; et b) parce que cette violence a été longtemps sous-estimée dans notre culture, qui produit l’ethnologie (et ce particulièrement par les femmes, nous reviendrons sur ce point)11.
La raison de « l’erreur » de Mead est, selon Freeman (p. 245, mes italiques), que « … à Samoa Mead n’eut en fait pas de contact avec des groupes masculins, si bien qu’elle ne comprit pas cette situation » — à savoir que le viol est une préoccupation fondamentale des jeunes hommes, une affirmation de masculinité, et qu’il est donc loin de se limiter dans les faits à la défloration rituelle des taupou (vierges cérémonielles, filles de chefs).
Nous avons là l’argument, juste en lui-même, qu’en ne voyant qu’une partie de la société — ici en n’entendant pas les hommes (pour une fois), mais seulement les femmes — des faits importants peuvent vous échapper. Et certes, il se peut — à supposer qu’elle n’ait effectivement pas eu contact avec des mâles en groupe (?) — que Mead ait ignoré la préoccupation des jeunes hommes. (On peut aussi aisément supposer que des hommes ne la lui auraient pas révélée !) Quant à la réalité du viol — le taux de viols effectifs étant apparemment élevé et les jeunes femmes (vierges ou censées l’être) en étant les victimes — Mead n’aurait donc pas eu connaissance non plus par les femmes de ces pratiques dépassant le cadre rituel, ce qui pose un autre problème. Mais revenons pour le moment à l’argumentation de l’auteur.
Freeman explique (p. 290) les « fausses informations » quant à la prétendue liberté et douceur des mœurs sexuelles à Samoa que Mead aurait recueillies de ses jeunes informatrices, par le fait (outre que l’ethnologue était installée dans un poste et un dispensaire du gouvernement et qu’elle était donc perçue comme proche du pouvoir colonial) que les Samoans en général — et les jeunes filles en particulier — auraient une réticence marquée à discuter de « questions sexuelles » avec des étrangers ou des représentants d’une autorité quelconque. Or, dit-il, « c’était précisément ce genre d’informations que Mead, jeune Américaine libérée arrivant de New York et résidant dans le poste du gouvernement à Ta’ù, cherchait à tirer des adolescentes […] » (p. 290, mes italiques). Conclusion : elles lui racontèrent donc n’importe quoi, des histoires d’amours occasionnelles sous les palmiers…
Outre les erreurs qu’il dénonce dans les données de Mead sur la grande liberté sexuelle préconjugale des adolescents, Freeman accuse d’autre part Mead de contradiction dans son exposé puisque, dit-il
« … elle décrit effectivement les Samoans comme exigeant (demand) qu’une femme soit » à la fois réceptive aux avances de nombreux amants et cependant capable de montrer les signes de la virginité lors du mariage « . Il devient évident, à ce point critique, que quelque chose cloche terriblement, car aucune population humaine ne peut être aussi désorientée sur le plan cognitif au point de conduire son existence d’une manière aussi schizophrénique » (p. 289, mes italiques).
Pour Freeman, qui n’est pas schizophrène, les faits sont simples, clairs et nets : d’une part la sous-culture masculine à Samoa est véritablement obsédée du viol, et les jeune gens tentent de le réaliser le plus possible pour prouver leur virilité. D’autre part, le culte de la virginité des filles est très fort. Donc : il ne peut pas y avoir de norme de réceptivité de la jeune fille aux garçons, et il ne peut pas y avoir « promiscuité » sexuelle effective des jeunes gens, sauf viol, qu’il décrit.
Or, si Freeman réfléchissait un peu sur les cultures occidentales actuelles dont il fait apparemment partie — et surtout s’il était une femme — saurait que c’est exactement ces normes schizophréniques (en effet) qui sont imposées…aux femmes. Quelle fille/femme ayant cédé aux « avances » masculines ne s’est-elle pas, tôt ou tard, fait traiter de « putain » ? Ne pas céder est une norme et en même temps céder est une norme.
Dans les sociétés patriarcales (justement celles qui privilégient à la fois « l’honneur » de la femme — ou plutôt de ses frères et père — et le viol), il y a plusieurs normes contraires pour une femme. Contraires, mais qui, si elles sont vécues de façon contradictoire au niveau psychologique par les femmes — la contradiction permanente étant justement un facteur d’aliénation des femmes (qui fait que céder n’est pas « consentir ») —, ne sont pas du tout contradictoires au niveau sociologique12.
Freeman voit très bien (en homme qu’il est) que le viol et la virginité sont liés à Samoa, non seulement structurellement mais jusque la forme même que prend le viol « subreptice » (pendant le sommeil de la jeune fille) : pénétration digitale, analogue à la « défloration rituelle » publique de la taupou lors du mariage. Mais il ne voit pas que le viol et les « avances » sexuelles en toutes circonstances auxquelles le garçon veut que la fille « cède » sont une seule et même chose. Pas de « contradiction » sociologique mais, en effet, vécu de l’oppression par les femmes dans la coupure, la schizophrénie.
D’autre part, on peut se demander ce que Freeman entend — parlant de Mead qui avait vingt-trois ans et dont c’était le premier terrain — par « une jeune Américaine libérée ». (Outre qu’on se demande ce qu’il en sait.) Dans le dialogue entre Mead et les jeunes Samoanes, plutôt que la rencontre entre une « libération » de l’ethnologue et un « mensonge » des informatrices, je verrais la rencontre entre deux aliénations structurellement homologues. D’un côté (les Samoanes), un silence sur le viol, et qui n’est pas seulement dû à une pudeur imposée sur les « questions sexuelles », mais à la honte imposée à la victime du viol (Freeman en cite d’ailleurs d’excellents exemples à Samoa) ; de l’autre côté (Mead), peut-être une ignorance, et non pas due à une « libération » (??) des femmes américaines, mais à son contraire : les femmes occidentales elles-mêmes ignoraient, jusqu’à ce que les mouvements féministes récents organisent des groupes d’assistance aux femmes violées et fassent l’analyse du viol, qu’un nombre si important de femmes étaient effectivement violées, et notamment dans le mariage ou par des hommes proches, alors que le viol n’est présenté dans l’éducation des filles que comme une éventualité très exceptionnelle, une menace destinée à faire peur et à « bien se tenir » (car c’est la fille qui est tenue pour responsable). Mais on découvre de plus en plus l’importance du nombre de viols dans nos sociétés (comme du nombre de femmes battues)13.
Donc Mead était peut-être « libérée » au sens que semble lui donner D. Freeman, c’est-à-dire « pouvait parler de questions sexuelles », mais elle était, comme toutes, non libérée dans le sens de n’avoir même pas sans doute la connaissance de la réalité quotidienne du viol dans de nombreuses sociétés, y compris la sienne— connaissance que possèdent et se transmettent en effet, comme le note si bien Freeman , les « male groups ».
Ainsi donc, une meilleure connaissance — non pas seulement de la culture de Samoa, comme le dit Freeman — mais aussi de sa propre société (prémisse nécessaire bien que non suffisante de l’action pour la « libération » de tout groupe dominé) aurait-elle peut-être permis à Mead de douter légèrement des dires de ses jeunes informatrices. Toutefois, elle avait bien noté l’existence de normes contradictoires imposées aux filles (virginité/réceptivité) — ce que Freeman, de par sa position de dominant dans les rapports de sexe chez lui, refuse de reconnaître.
Ajoutons enfin que si Freeman aurait aimé que Mead connaisse mieux les discours et les pratiques masculines, il commet — et ce n’est pas pour nous étonner — la même erreur concernant des pratiques… féminines. Comme le note E. Leacock (1983) :
« Il prétend que Mead fut également dupée par une femme qui lui raconta que des parentes âgées pouvaient, si besoin était, habilement fournir du sang de poulet pour le rituel public où le fiancé déflorait cérémoniellement, de ses doigts, la taupou [..] Mais Freeman sait irrévocablement qu’une telle duplicité était impossible car il a interrogé là-dessus des hommes chefs qui « rejetèrent avec indignation » cette idée » (pp. 250-253).
Nous revenons ici à la question de la « connaissance » de chaque groupe (dominant/dominé) concernant la domination. La connaissance des faits et les idées sur la domination sont-elles « partagées » ? Rien n’est moins sûr (cf. infra, II).
Il est (il devrait être, car trop de femmes ont tendance à l’oublier) hors de question, dans l’analyse d’un rapport de force, de ne pas tenter d’obtenir le maximum d’informations du dominant (male groups, dans l’exemple), car il connaît le mode d’emploi, les mécanismes économiques et les justifications idéologiques, les contraintes matérielles et psychiques à utiliser et utilisées. Certes la conscience dominante peut être aussi mystifiée (les bourgeois n’avaient pas fait l’analyse de la plus-value), mais le dominant connaît les moyens de l’exploitation et de la domination.
Mais si un dominant connaît la domination, il ne connaît pas le vécu de l’oppression, c’est-à-dire l’autre versant. C’est pourquoi les « explications » données et les notions qui les accompagnent sont souvent si décevantes, tels le « consentement » des dominé(e)s ou le concept de force ou de violence, sur lesquels nous reviendrons dans la suite de ce texte. Car un inconvénient majeur est que si vivre en dominant n’est pas connaître l’oppression, vivre en opprimé(e) est peut-être encore moins connaître (avoir la pleine connaissance de) la domination et l’oppression…
… et une solution : Elle n’aurait pas dû. Elle l’a bien cherché
Paris, le 30 mars 1983. À un croisement, le feu passe au vert, je démarre : trois jeunes hommes14 décident de traverser quand même, manifestant clairement que « y en a marre des bagnoles », surtout si le conducteur est une conductrice. Je continue à avancer, passe à dix centimètres d’eux. Occupée par l’incident, je ne vois qu’en dernière extrémité, devant moi, une femme, qui regarde ailleurs. Je pile, lui fais signe que le feu était au vert, et je l’entends qui dit : « Pardon. »
Voilà sans doute ce que d’aucuns appelleraient le « consentement » des femmes à la domination (des automobilistes sur les piétons).
On manque de la tuer, elle s’excuse : Pardon… Je n’aurais pas dû… 1) Sa première réaction (totalement concomitante de la peur), réflexe, spontanée, immédiate, irréfléchie, subconsciente, est d’avouer qu’elle avait « tort ». 2) Elle ne sait pas — en tout cas elle n’a pas intégré dans ses réactions profondes — qu’un automobiliste qui heurte un piéton, a fortiori dans un passage protégé, a toujours tort, même s’il était théoriquement en droit de passer.
Nous avons déjà là quelques aspects propres à la conscience et à l’inconscient (et à l’inconscience) des dominé(e)s : a) la culpabilisation ; b) l’in-connaissance des règles non dites qui régissent les rapports avec les dominants ; c) l’inconnaissance du fonctionnement réel de la société au-delà des apparences des règles, lois, coutumes, etc.
On manque de la tuer, on l’accuse, elle s’excuse. Ou bien, on l’accuse, alors on la tue. Deux formules par lesquelles on pourrait résumer, pour les sociétés patriarcales (majoritaires à travers le monde), la position structurelle des femmes, et ses effets dans la conscience.
Une femme est-elle violée, « elle n’aurait pas dû » (parler à cet homme, se trouver à cet endroit-là, à cette heure-là, être habillée comme ci ou être habillée comme ça), et surtout elle n’aurait pas dû se laisser faire, en un mot, elle n’aurait pas dû se faire violer… D’ailleurs, si une femme est violée dans des circonstances « normales », par son mari, chez elle, dans sa chambre, eh bien elle n’aurait pas dû — pas dû énerver ce pauvre travailleur ou ce cadre cardiaque, pas dû se plaindre de sa fatigue, des enfants, pas dû ne pas consentir, pas dû résister à ses « besoins sexuels » à lui. Résiste-t-elle, il la viole et/ou la menace et/ou la tue.
Elle n’aurait pas dû. Et d’ailleurs, au fond d’elle-même (quelque part, comme on dit en style néo-lacanien), n’a-t-elle pas consenti ???
On sait que dans les procès de viol, l’argumentation des avocats — comme le sens final des sentences (acquittements fréquents des violeurs) — est presque toujours basée sur l’idée du consentement de la femme. Dans un procès récent pour viol collectif aux assises de Créteil (22-23 septembre 1982), l’un des avocats des violeurs, ne pouvant démontrer avec quelque crédibilité le consentement de la victime ni avant ni pendant le viol, tenta fort habilement d’insinuer son consentement après ! Son « raisonnement » fut que — les violeurs ayant, après le viol, transporté cette jeune femme en voiture, de nuit, aller et retour entre le boulevard Saint-Marcel (Paris 13e) et le boulevard Saint-Germain (5e) : « Je n’ai pas compté, mais enfin, il y a au moins treize feux rouges où elle aurait pu descendre, s’échapper ! » Notons que c’est justement au dernier feu rouge, en réarrivant sur le lieu du viol, que la victime s’est échappée, mais voilà, pour monsieur l’avocat, elle ne s’est pas échappée assez tôt, à son avis autorisé à lui, qui ne s’est jamais fait violer, à plusieurs reprises, par trois hommes, pendant plusieurs heures. Parmi d’autres arguments, celui-ci a dû compter dans le verdict des jurés : violeurs acquittés.
Et pourtant, tous les juges ou jurés ne sont pas du même acabit, dans nos sociétés occidentales. Voici en opposition un autre jugement concernant des violences physiques et morales — ici d’un mari contre son épouse — où la justice s’est prononcée contre les paroles mêmes de la victime… qui avait prétendu devant la Cour avoir consenti à la séquestration, et contre la défense qui parlait du « volontariat » de la victime :
« TOUS LES SOIRS, UN HOMME DE 50 ANS ENFERMAIT SA FEMME DANS UN COFFRE
Maladivement jaloux, M. Alfred Duclos, âgé de 50 ans environ, obligeait sa femme à passer ses nuits installée, au pied de son lit, dans une espèce de coffre fermé de deux serrures.
Dénoncé par son épouse qu’il avait battue au mois d’octobre, il a été reconnu coupable hier de séquestration par le juge Gabriel Lassonde de la Cour des sessions de la paix, et connaîtra sa sentence au mois de février.
Les faits mis en preuve pour la poursuite lors du procès pour établir les éléments essentiels de cette accusation sont, de l’avis du juge Lassonde, exceptionnels, incroyables et même répugnants.
Seul témoin entendu au cours du procès, l’épouse, qui avait demandé que la plainte qu’elle avait portée contre son mari soit retirée, a relaté qu’il y a quelques années déjà son mari avait fabriqué un genre de garde-robe dans lequel on serrait des vêtements le jour, mais qui lui servait de lit la nuit, une fois installée horizontalement au pied du lit de son mari. Après y avoir déposé un matelas et un oreiller, elle s’y étendait, après quoi son mari fermait le tout à clé avec deux serrures.
En d’autres occasions, Mme Duclos passait la nuit dans le lit conjugal, mais son mari prenait la précaution de lui menotter un poignet à l’un des siens. Ces précautions, selon la preuve entendue, étaient prises par le mari qui voulait ainsi s’assurer que son épouse ne fréquentait pas d’autres hommes pendant son sommeil.
En plus de toutes ces précautions, M. Duclos, à son réveil, après avoir regardé sa femme dans les yeux, procédait en outre à un examen gynécologique pour s’assurer qu’elle ne l’avait pas trompé durant son sommeil.
Lors du procès, Mme Duclos a relaté qu’elle couchait régulièrement dans ce coffre depuis deux ans, de son plein gré, et que son mari ne l’avait ni menacée ni frappée pour l’inciter à prendre cette couche. Jamais, a-t-elle affirmé, je n’ai opposé de résistance à me coucher dans cette boîte, ni pour y entrer ni pour en sortir.
Mme Duclos a expliqué qu’elle aimait s’installer dans ce coffre, qu’elle le faisait seule ou que ses enfants l’y aidaient parfois, et précisé qu’elle y était bien couchée. En se prêtant volontairement à ce manège, a-t-elle déclaré au tribunal, je prouve à mon mari que je ne sors pas durant la nuit et je ne suis donc pas accusée pour rien.
Du 28 avril 1982 jusqu’au 20 octobre dernier, elle a passé toutes ses nuits dans ce coffre mais, le 20 octobre, après avoir été victime de sévices corporels de la part de son mari, elle a porté plainte et c’est ainsi que M. Duclos s’est retrouvé accusé de séquestration devant les tribunaux.
C’était la première fois qu’elle portait plainte contre M. Duclos, qu’elle connaît depuis trente ans.
La défense a parlé du « volontariat de l’épouse » mais, pour le juge Lassonde, en fonction de la jurisprudence la victime a bel et bien été séquestrée, puisqu’elle passait ses nuits dans un coffre fermé de deux serrures. Il lui était impossible d’en sortir et de circuler librement.
Dans une telle situation, note-t-il dans son jugement, la Cour ne peut se convaincre que cette femme voulait ainsi être séquestrée, surtout que, depuis l’incarcération de son mari, elle ne passe plus ses nuits dans ce coffre.
Le juge Lassonde en vient donc à la conclusion que les gestes posés par M. Duclos constituaient de la contrainte et une manifestation force. Les examens gynécologiques qu’il pratiquait constituent pour le tribunal une attaque à l’intégrité de la personne de son épouse et c’est là également une manifestation de force. » Le Devoir, Montréal, 21 décembre 1982 (mes italiques)15.
Cet exemple est caricatural, mais — dans cette mesure même — il est riche d’enseignements. Ce sont souvent soit les détails les plus ténus (le « pardon » de la femme que je manque de tuer) soit les extrémités les plus sordides qui jouent comme révélateurs d’une structure de pouvoir. À l’inverse, c’est l’apparence quotidienne et banale de déroulement « normal » des choses qui peut obscurcir, pour les victimes et les auteurs de l’oppression comme pour leurs « analystes », ses mécanismes. Mais, dirais-je, encore plus pour les victimes : moins de femmes que d’hommes voient une continuité, une homogénéité, en situation de domination des hommes, entre relations sexuelles « normales » et « viol ». Moins de femmes que d’hommes voient dans le mariage ce que rappelle pourtant à chaque touriste le guide Michelin :
« Noces de Venise et de la mer.— De 1173 à. 1797, une somptueuse cérémonie exprimait admirablement ce qui faisait la grandeur de Venise et ce qui fait encore sa beauté. La République ayant soutenu le pape Alexandre III dans sa lutte contre l’empereur Frédéric Barberousse, le Pontife donna au Doge un anneau, » symbole de votre empire sur la mer « . En souvenir, chaque année, le jour de l’Ascension, le Doge, vêtu de drap d’or, montait Bucentaure, sa galère de parade toute dorée, et allait jeter à la mer un anneau en disant : « Nous t’épousons, mer, en signe de perpétuelle domination. » Voltaire niait que le mariage fût valable : il manquait, disait-il, le consentement de la mariée. »
Guide vert Italie, Michelin, 9e écl., 1971, p. 234 (mes italiques).
Du Pontife du XIIe siècle au guide du touriste moderne en passant par les Lumières voltairiennes, nul doute, dans les esprits masculins : le mariage est le sceau de la domination de l’homme sur l’épouse — à quoi elle doit, humanisme oblige, de préférence consentir. La première partie de la proposition me semble (quoique jamais assez) démontrée pour les sociétés patriarcales, c’est surtout sur la seconde partie que portera mon interrogation : 1) À quoi en effet la femme « consent-elle » : au mariage (par exemple) ou… à la domination ? 2) Quel sens y a-t-il à parler de consentement ?
On trouve fréquemment dans les textes concernant les femmes (ou d’autres dominés) des énoncés sur leur « acceptation » (de la situation), leur « adhésion à l’idéologie », « partage des idées dominantes », « coopération », « consentement à la domination ». Ces termes peuvent être posés là sans autre forme de procès, comme une explication suffisante ne requérant pas de commentaires (nous les retrouverons au passage chez quelques auteurs). On sait en fait qu’ils font partie, et depuis longtemps, des élaborations théoriques sur la domination.
En philosophie, J. Label par exemple — après avoir cité le Discours sur la servitude volontaire de La Boétie comme « classique méconnu du problème de l’aliénation » — mentionnait toutefois que l’acceptation n’est qu’un des éléments possibles du mécanisme psychique en question :
« Or l’oppression acceptée n’est qu’une étape de l’aliénation. L’étape suivante — la plus importante et notre sens — est celle de l’oppression — ou de l’infériorité — méconnue, « scotomisée16 » : l’illusion de l’ouvrier qui « croit être au pouvoir » dans un pays où il n’exerce pas la moindre influence sur la marche des affaires, celle du sous-homme nazi qui croit que son appartenance à la race supérieure lui confère la « participation » à une « valeur » extra-historique […], celle de la femme qui accepte passivement son « rôle » de femme comme expression d’une infériorité supposée […], celle du poor white sudiste qui, en faisant cause commune avec le gros planteur, se donne l’illusion d’appartenir à une élite, et j’en passe… Dans tous ces cas, l’illusion tenace, « existentielle », comportant parfois une néo-structuration des bases logiques de la pensée, apparaît inséparable de la définition d’un concept de l’aliénation qui se voudrait opérationnel » (Gabel 1970 : 56 ; souligné par moi — et sans m’attarder pour le moment sur le fait que seule la femme est censée accepter « passivement »…).
En ethnologie, M. Godelier semble restreindre le problème par les thèses qu’il défend en écrivant, par exemple dans « La part idéelle du réel » :
« des deux composantes du pouvoir la force la plus forte n’est pas la violence des dominants mais le consentement des dominés à leur domination » (1978 c : 176 ; cf. aussi Goclelier 1976,1977, 1978 a et b,1982).
Nous aborderons plus précisément leur discussion dans la troisième partie de ce texte, après avoir tenté de reconsidérer un certain nombre de faits concernant les rapports de sexe.
La part réelle de l’idéel, pour les femmes
L’idée de consentement des dominé(e)s, comme celle du partage des idées dominantes, renvoie à la subjectivité, à la conscience du sujet dominé. Mais, justement, quelle est-elle ? Avant de conclure au « consentement », il faudrait s’assurer que, pour chaque société, on ait pris la mesure des limitations de la conscience que les femmes peuvent subir. Une partie des limitations mentales est inextricablement liée à des contraintes physiques dans l’organisation des relations avec les hommes, l’autre est plus immédiatement une limitation de la connaissance sur la société.
Nous esquisserons d’abord un résumé des contraintes matérielles que — à la différence et au profit des hommes — peuvent subir les femmes, avec leurs implications mentales limitatives17 ; puis nous aborderons la question de la conscience des femmes médiatisée par l’homme, enfin celle du « partage » des idées et des valeurs, en nous demandant quelle peut être « la part réelle de l’idéel » pour les femmes.
Les exemples que je donnerai sont empruntés à des sociétés très diverses, mais essentiellement patrilinéaires18 et patri-virilocales19 où il y a parfaite congruence, pour les hommes, entre modes d’assignation de l’appartenance personnelle, des biens et de la résidence, et pouvoir économique, juridique et mental des hommes sur les femmes ; bref, sociétés que j’appellerais « homogènement viriarcales20 ». Elles présentent l’avantage de rendre plus lisibles des mécanismes qui jouent aussi dans d’autres sociétés, plus « hypocrites », comme les nôtres où sont produites les données et les interprétations ethnologiques. Inversement, ce choix tend à souligner que ces données et interprétations peuvent être utilement relues en fonction de la connaissance et du vécu de l’oppression des femmes dans les sociétés occidentales.
Toutefois, je propose ces exemples comme une ébauche de guide de lecture et d’interprétation, comme des questions à se poser pour chaque société en y considérant l’agencement des rapports de sexe qui lui est propre, et non comme des « vérités universelles ». Certains exemples ne sont pas directement transposables d’une société à l’autre (ce qui n’exclut aucunement qu’ils soient lisibles dans une grille d’interprétation générale). Par contre d’autres faits sont tout bonnement les mêmes dans un grand nombre de sociétés.
Les contraintes physiques et leurs implications mentales limitatives
La moindre disponibilité corporelle des femmes par rapport aux hommes est souvent mentionnée dans les études, mais il semble qu’on n’ait pas pris toute la mesure de ses implications psychiques. La fatigue continue du corps entraîne celle de l’esprit.
Dans beaucoup de sociétés, les femmes font un travail apparemment moins pénible que les hommes (voir les fameux « efforts violents et brefs » requis de ceux-ci et qui fascinent tant les ethnologues), mais 1) ceci est probablement faux car les efforts physiques des femmes sont mal et sous-évalués, leur fatigue est méconnue ; 2) ce travail dure beaucoup plus longtemps et surtout est dispersé dans une série de tâches cumulées et souvent interrompues (et ce, particulièrement du fait de la présence des jeunes enfants). En outre et conséquemment, il est rare qu’une femme ait des moments de loisir véritable comme peuvent s’en réserver les hommes. Comment pourrait-elle en plus penser clairement… par exemple sa situation ?
Ceci est devenu relativement connu pour nos sociétés modernes (« double journée » des femmes), mais même en prenant l’exemple d’une société « primitive » où l’on travaille moins, où le travail semble mieux réparti entre les sexes et où le rapport travail/productivité est meilleur que chez nous, comme les Yanomami du Venezuela (horticulteurs-chasseurs-collecteurs), on peut déduire des tableaux établis par Jacques Lizot (1978) que les hommes ont, en saison sèche, 1h50 par jour de « repos et loisir » de plus que les femmes, et 3/4 d’heure de plus en saison humide (p. 78). De même, si l’on reprend les tableaux 9 et 10 de cet article (coût énergétique des activités), on peut calculer, en regroupant les catégories « Endormi, allongé », « Assis inactif » et « Debout inactif », que les hommes ont 64 minutes par jour en saison sèche, et 39 minutes par jour en saison humide, de sommeil ou inactivité en plus que les femmes. En saison sèche, les hommes ont donc à leur profit 55 heures par mois de repos et loisir pendant lesquelles les femmes travaillent (donc une grosse semaine d’un travailleur occidental) — dont 32 heures de sommeil et inactivité, pendant lesquelles les femmes.. « s’activent » !21
Pour la détermination du besoin énergétique par personne, il est noté que, si l’on fait une moyenne, et compte tenu du poids : « L’activité d’un Yanornami adulte de sexe masculin tombe clans la catégorie « activité légère » […] l’activité d’un Yanomami de sexe féminin est « modérée » […] ». (p. 94).
Si l’on ajoute que le portage des jeunes enfants, essentiellement accompli par les femmes tout au long de la journée et au cours des déplacements, n’a pas été compté dans la dépense énergétique (qui n’est calculée que par rapport au travail fait pour les activités de subsistance), il est clair que les besoins énergétiques des femmes sont sous-évalués, parce que leur travail est sous-évalué en dépense physique (comme en temps). Selon J. Lizot22, les enfants sont presque constamment portés par les femmes jusqu’à l’âge de deux ans, mais « les enfants yanornami ne sont pas bien lourds ». Or d’après les tableaux, un garçon de deux ans pèse en moyenne 6,4 kg et une fille 5,9 kg — pour une femme adulte de 41,7 kg en moyenne (tableau 11 ; un homme adulte pèse, lui, 48,1 kg).
Interrogé par moi sur une éventuelle consommation alimentaire différentielle selon le sexe, J. Lizot pense qu’elle n’existe pas, mais n’a pas pour le moment étudié la question. En tout cas, vu l’écart d’activité physique entre hommes et femmes, il estime que — dans la formule générale qu’il a donnée pour les Yanomami : « L’apport énergétique est à peine supérieur aux besoins, l’apport protéique est trois fois supérieur » (p. 96) — la marge concernant l’apport énergétique est encore plus critique pour les femmes que pour les hommes.
Mais que pouvons-nous supposer de la consommation alimentaire ? Dès un an, la différence de poids entre garçons et filles yanomami est marquée : 5,5 kg pour le garçon, 4,4 pour la fille. Or des études de comportement menées en Europe par des psychologues (cf. par exemple Lézine 1965, abondamment citée in Belotti 1974) ont fait apparaître le nourrissement différentiel des bébés selon le sexe, à la fois en quantité et en qualité d’attention (ce qui entraîne en plus davantage de difficultés psychologiques à l’égard de la nourriture chez les filles).
D’autre part, on sait maintenant que la taille et le poids des individus augmentent avec le « niveau de vie » (différences diachroniques23 pour un même pays, différences synchroniques entre classes sociales ou entre pays plus ou moins riches). Il semble donc qu’on devrait étudier sérieusement la question pour les sexes : la différence importante de taille et de poids entre les hommes et les femmes dans un grand nombre de populations (par exemple, 10 cm d’écart moyen entre hommes et femmes chez les Yanomarni) n’est-elle pas due, de fait, à une alimentation moindre ou plus mal équilibrée des femmes (ajoutée à une plus grande dépense énergétique et à un moindre repos) ? Il a déjà été montré pour certaines sociétés à domination masculine une différence très nette en quantité et en qualité dans l’alimentation des hommes et des femmes (cf. par exemple pour la Tunisie, Ferchiou 1968 ; pour la France, Delphy 1975 ; pour la Turquie, Kandiyoti 1983 ; pour les Gainj de Nouvelle-Guinée, Lyons Johnson 1981).
Dans nombre de populations pauvres, où existent de véritables carences nutritionnelles, celles-ci affectent davantage les femmes que les hommes, et si l’on considère hommes, femmes et enfants, ce sont souvent les adultes mâles les moins touchés24.
Cette malnutrition relative des femmes par rapport aux hommes ne peut manquer d’avoir des incidences psychiques, d’augmenter la fatigue et de diminuer les capacités de résistance physique et mentale des femmes.
En outre, dans la mesure où ce qui est compté comme « travail » pour les femmes est généralement sous-évalué dans les études, ce qui leur est compté comme « loisir » est bien entendu surévalué. On peut de plus se demander, pour d’autres sociétés comme pour la nôtre, ce que peuvent signifier les mots « loisir » ou « inactivité » pour une femme avec de jeunes enfants. Ce que les ethnologues décrivent parfois comme « les enfants trottinent à côté des adultes » ou « les enfants jouent non loin » voudra dire bien souvent qu’ils sont dans les jambes… des femmes, qu’elles « travaillent » ou qu’elles « se reposent ».
La préoccupation et la fatigue physique et mentale que l’éducation quotidienne et la surveillance constante de jeunes enfants impliquent pour les femmes ne sont guère prises en compte — pas plus que la contradiction que cette tâche présente avec d’autres tâches aussi quasi universellement « féminines », telle la cuisine (utilisation du feu, de l’eau bouillante et dangers divers selon les sociétés), comme le montre un article intitulé « Le cru, le cuit et le bâclé [le mi-cuit] » (Guyer 1980 : 7) à propos des hypothèses faites et à faire sur le lien entre les soins aux enfants et la cuisine dans la répartition sexuelle du travail :
« On pourrait soutenir cependant que la cuisine est une simple extension de l’allaitement (nursing) et qu’elle est donc subsumée sous l’argument des soins aux enfants (child care and nurturing). Au contraire, je dirais que, bien qu’elles semblent liées au niveau idéologique, [ces deux activités] sont beaucoup plus difficiles à combiner dans la pratique que les arguments fonctionnels ne le laissent penser.
Il n’est ni commode ni sans danger qu’une femme cuisine et s’occupe en même temps d’enfants petits. Faire cela est nerveusement épuisant (nerve-wrecking), et il suffit de l’observer au cours du travail de terrain pour voir que la première expérience de l’impératif catégorique pour tout enfant a lieu dans la cuisine de sa mère, et que l’un des tout premiers mots qu’il comprend est « chaud ». »
Pour ce qui est du portage des enfants, il n’est pas inutile de citer le témoignage de Mary Jemison25 sur un long voyage qu’elle entreprit avec ses « frères » pour aller visiter leur famille (elle devait avoir approximativement 16-17 ans) :
« Shenin-jee [son mari] consentit à me laisser aller avec mes frères […] nous partîmes ensemble pour Genishau, mes trois frères et moi, mon petit garçon sur le dos […] ; [Le voyage se fait bien entendu à pied, sauf à un moment, où ils ont trouvé des chevaux.] Finalement, en faisant nager nos chevaux, nous réussîmes à atteindre la rive opposée ; mais avec mon petit garçon, j’échappai de justesse à la noyade […].
Seuls ceux qui ont parcouru, à pied, la distance de cinq ou six cents miles, à travers des contrées sauvages, presque sans chemin frayé, peuvent se faire une idée de la fatigue et des souffrances que j’ai endurées durant ce voyage. [Elle donne des détails.] Il me fallait en plus porter mon enfant, alors âgé d’environ six mois, tout au long de la journée, sur mon dos ou dans mes bras, subvenir à ses besoins, prévenir ses souffrances dans la mesure de mes faibles moyens. Ma fatigue était telle que je me sentais parfois incapable d’aller plus loin, prête à abandonner ; mes frères étaient attentionnés […] » (pp. 84-86, souligné par moi).
Attentionnés, sans doute. Mais c’est elle qui portait l’enfant…
La limitation physique et mentale des femmes du fait qu’elles sont littéralement liées aux enfants est encore plus évidente dans les cas d’urgence et de danger et notamment dans les cas de résistances des femmes par la fuite éventuelle. Point n’est besoin de faire appel au « consentement à la domination » quand on sait que, très matériellement, ce sont les enfants qui empêchent les femmes d’échapper (ne serait-ce que provisoirement) à leur situation.
Sous l’esclavage de plantation en Amérique, ce sont des esclaves hommes qui se sont enfuis en premier, comme le montre l’autobiographie, publiée en 1845, d’un esclave américaine (Douglass 1980). Par contre, pour les Antilles, Arlette Gautier (1984) note à la fois que beaucoup d’esclaves femmes marronnaient (« toujours sans homme, parfois avec d’autres femmes ») et que dans la population esclave en général le taux de natalité était très faible (« parmi les mères, une sur deux n’a qu’un seul enfant »).
Certes c’est au prix de sa vie qu’on s’échappe, mais s’il paraît fort noble de risquer sa vie pour la liberté, il est beaucoup plus difficile moralement de risquer en plus celle de son enfant. Enfin, l’enfant entraîne une limitation physique qui fait qu’une femme n’ira pas bien loin… Le poids de la liberté est plus lourd pour les femmes.
D’autre part, si d’un côté on peut trouver plus d’énergie mentale pour survivre quand on a un enfant à soutenir (lors de leur capture par des Indiens, le père de Mary Jemison était totalement abattu. Sa mère « manifesta une grande force d’âme », parlait aux enfants et les obligeait à manger, op. cit., pp. 51-52), d’un autre côté la limitation physique due aux enfants peut rendre ce courage quasi inutile, quelque part ineffectif.
Le fait d’avoir la responsabilité constante des enfants est non seulement un travail physique — souvent non évalué — mais aussi un travail mental constant et de surcroît un travail mental aliénant, à tout le moins limitatif de la pensée (à force de tout simplifier dans les explications aux enfants, est-ce qu’on peut développer une pensée complexe, « libre » ?).
Ceci est particulièrement grave dans les sociétés occidentales, où nombre de femmes sont isolées dans « leur foyer » toute la journée. Certaines expriment cette limitation ainsi : « À force de parler seulement aux enfants, je me sens devenir bête. » On répondra qu’au contraire, adapter pour de jeunes enfants l’explication du monde et des relations entre les gens est un exercice intellectuel complexe.
Mais la sophistication même d’un exercice intellectuel n’implique nullement qu’il ne puisse pas briser l’esprit si la technique est strictement maintenue dans certaines limites, et consiste même en fait à maintenir l’esprit et la personne à l’intérieur des frontières d’une situation. Un excellent exemple (qui concerne non le rapport aux enfants, mais aux hommes) en est fourni dans un article de Roberte Hamayon (1979).
Dans la société mongole, « l’entraînement à l’encodage et au décodage symbolique fait partie de l’éducation » pour tous, dès la petite enfance, car ni le nom des aînés ne doit être prononcé, ni un certain nombre de choses redoutables ne doivent être nommées. On doit user de substituts. Mais une fois mariées, les femmes se trouvent de plus confrontées à une situation spécifique, les deux positions extrêmes des hiérarchies de sexe et d’âge (comportant des interdits de langage) étant incarnées dans la relation entre beau-père et belle-fille. Celle-ci est soumise à un certain nombre d’interdits, en rapport notamment avec les noms de ses beaux-parents (chaque femme doit donc innover dans l’exercice linguistique en fonction de « sa » belle-famille particulière). N’échangeant avec son beau-père que des propos symboliques, la belle-fille doit user d’euphémismes, par déformation phonétique ou néologismes, mais en utilisant tout au plus la métonymie, « procédé rhétorique inférieur qui fait dire au substitut moins qu’à l’original interdit et permet donc toujours, du moins en principe, d’identifier ce dernier » (p. 126). En effet, la belle-fille ne doit « employer que des figures susceptibles d’être à coup sûr décodés par lui » le beau-père, qui, par contre, use envers elle à loisir, et à plaisir, de métaphores qui « lui fournissent un moyen de mettre à l’épreuve la perspicacité de ses inférieurs, de sa belle-fille en particulier, et sont par ailleurs un gage de son droit de création » (p. 126 ; mes italiques).
Ainsi, « faire respecter les prohibitions qu’impose la coutume, voire y ajouter celles que lui suggère sa propre fantaisie revient, pour le beau-père, à affirmer sa domination ; user d’euphémismes, c’est, pour la belle-fille, avouer et accepter sa subordination » (p. 127).
On voit donc que la limitation des procédés rhétoriques utilisables par la femme vis-à-vis de l’homme dominant — limitation tant sur le plan de la qualité du procédé lui-même que sur le plan du choix parmi les procédés théoriquement possibles — est à la fois un exercice plus complexe (puisqu’elle ne peut laisser vagabonder son imagination, sa créativité linguistique, au risque de produire une métaphore), et plus appauvrissant. Car, dans cette société, la « perspicacité » et l’ingéniosité intellectuelle requises des inférieurs (cadets, et surtout femmes), et reconnues dans les mythes et les valeurs, ne sont pas la liberté créatrice.
Pour en revenir aux rapports mère-enfants, il faut bien voir aussi que l’enfant se sert de sa mère (physiquement et intellectuellement), comme chez les Mongols le beau-père se sert de sa belle-fille, et les hommes des femmes. Là, dit R. Hamayon (p. 125 ; mes italiques), « l’homme, disposant du droit d’instaurer la conversation, d’en choisir le thème et de poser des questions, jouit d’une liberté de parole qui n’a pour limites que la présence d’aînés ou d’éventuelles restrictions imposées par les circonstances. La femme ne peut que répondre, écouter ou se taire, n’acquérant quelque droit d’initiative qu’avec sa maturité de mère comblée » (par la naissance d’un fils).
Or, face à des enfants, une mère ne peut pas parler, ses préoccupations (d’adulte), c’est l’enfant qui impose ses questions. Là aussi, elle ne peut que répondre, écouter ou se taire… La seule différence est qu’en « répondant » à l’enfant, la mère a affaire en lui à un moyen de limitation, et qu’en « répondant » au beau-père, la belle-fille est directement confrontée à la cause.
Le fait que les femmes soient limitées physiquement et mentalement par la charge (au sens propre) des enfants et par leur préoccupation à leur égard est d’ailleurs parfaitement connu du pouvoir masculin, qui simplement inverse, pour se justifier, la cause et l’effet, faisant de cette limitation des femmes la raison de leur non-pouvoir alors qu’elle en est l’effet.
Un mythe kikuyu (cf. Beecher 1938) nous en donne un extraordinaire exemple, qui explique « comment les hommes arrachèrent le royaume aux femmes » :
« Il y a très, très longtemps, les femmes dirigeaient le royaume. Les hommes commencèrent à trouver que ce n’était pas une bonne chose, et appelèrent à une réunion pour discuter de ce qu’il y avait lieu de faire. Ils décidèrent de réunir les femmes et de les faire danser nues devant eux. Quand les femmes arrivèrent et que les hommes leur dirent ce qu’elles devaient faire, elles refusèrent car, dirent-elles, elles avaient honte de faire une telle chose. Les hommes répliquèrent que quand on dirige un royaume, on ne doit pas connaître une chose comme la honte. Il fut décidé d’avoir une autre réunion des hommes et des femmes ensemble afin de résoudre la question.
Les femmes vinrent à la réunion, en amenant leurs enfants. Elles discutèrent longtemps jusqu’à ce qu’il commençât à faire froid et obscur. Une à une, les femmes partirent parce qu’elles avaient peur que leurs enfants souffrent du froid. Cela trancha la question. Les hommes venaient de réaliser que non seulement les femmes avaient honte de danser nues devant eux, mais aussi qu’elles avaient peur. Ils décidèrent que de telles personnes étaient totalement indignes de régner et que la meilleure chose qu’ils avaient à faire était de leur ôter le pouvoir » (mes italiques).
J’ai cité ce mythe pour montrer la connaissance du handicap physique et mental que représente pour les femmes la responsabilité des enfants, ce qui est très exactement ce que le mythe veut dire. (Notons aussi que cette responsabilité est individuelle : ce n’est pas toutes ensemble que les femmes quittent les hommes, comme un corps collectif « ayant le pouvoir » pourrait le faire, mais « une à une »…) Mais il est passionnant à plus d’un titre, et notamment en ce qu’il montre en quoi les hommes — qui ont effectivement le pouvoir chez les Kikuyu — ne peuvent pas être imaginés, conçus comme ne l’ayant pas, ce dont témoigne le langage du mythe : parfaite contradiction avec ce qui est censé être dit (que les femmes avaient le pouvoir), ils décident de réunir les femmes, ils leur disent ce qu’elles doivent faire — d’où elles « répondent », voir plus haut ! — etc. Même censément « sans pouvoir », les hommes ne peuvent s’imaginer que dirigeant et contrôlant les femmes, jusque dans la « honte » — ce qui est bien vrai.
Un second mythe kikuyu « comment l’homme devint le chef de la famille » :
« Il y a très, très longtemps, l’homme pensait que tous les enfants appartenaient à son épouse ; c’était elle qui leur donnait naissance, c’était elle qui les nourrissait. C’est pourquoi il n’osait pas leur donner des ordres, car il avait peur de sa femme.
Un jour, au retour de la chasse, il s’arrêta un moment à l’extérieur de la hutte, car il entendait le plus jeune enfant pousser des cris aigus. Comme il restait là à écouter, il entendit sa femme essayer de consoler l’enfant, qui s’était brûlé dans le feu. » Tais-toi, disait-elle, si jamais ton père rentrait et te trouvait en train de pleurer. S’il devait trouver son enfant en train de crier, je suis sûre qu’il me battrait. »
Elle disait cela parce qu’elle pensait que c’était son mari qui était le maitre des enfants.
De ce jour, l’homme sut qu’il n’avait absolument rien à craindre, et il fit faire aux enfants tout ce qu’il désirait d’eux » (mes italiques).
Là encore, des vérités sont dites par le mythe sur l’organisation sociale actuelle — aussi bien le danger du feu de cuisine, le fait que les femmes sont tenues pour seules responsables des bêtises des enfants, le fait qu’elles sont battues par leur mari, et leur peur (nous y reviendrons plus loin), cette fois-ci de l’homme (dans le mythe précédent, c’était pour les enfants). Les femmes ont peur à cause du pouvoir des hommes, en particulier du mari, sur elles et c’est cette peur même qui sert dans l’idéologie de justification au pouvoir.
Or la peur paralyse, non seulement le corps, mais l’esprit.
Une conscience médiatisée, pour les femmes
Entre leur vie et elles, un écran : les hommes
Si les enfants peuvent être considérés déjà comme un intermédiaire limitatif dans le rapport à soi-même, on peut se demander si les hommes qui contrôlent la femme (maris, frères, pères, fils, oncles, avec des modalités diverses selon les sociétés) ne lui sont pas un véritable écran, dans le double sens d’objet interposé dans sa conscience, et de surface opaque d’où lui est renvoyée une sorte de logique de la contradiction dans la conduite de sa propre vie — les deux pouvant avoir des conséquences mortelles…et pas seulement pour l’esprit.
Nous commencerons par un exemple extrême, où la faute de l’homme à son égard entraîne le suicide de la femme.
Chez les Gainj de Papouasie, Patricia Lyons Johnson (1981) montre que « le suicide est une réaction logique à, et un aboutissement du système traditionnel de croyances concernant les hommes et les femmes » (p. 325). Le taux de suicides dans cette population est extrêmement élevé par rapport aux statistiques mondiales. Au cours de ses quatorze mois d’observation, l’auteur a pu constater que « seules les femmes se tuent, et parmi les femmes, seules les femmes mariées », et que ces suicides représentaient plus de la moitié des morts de femmes entre 20 et 49 ans. Bien que, comme elle le note, la population soit restreinte et donc les nombres petits (4 suicides pour 277 femmes), la démonstration semble convaincante car parfaitement reliée au système de valeurs et à l’organisation matérielle de la société.
Chez les Gainj, les femmes font quasiment tout le travail physique, les hommes mûrs quelques travaux physiques et surtout le travail « social », politique. Mais la principale définition qu’ils donnent de leur « travail » est : « « prendre soin des femmes » (taking tare of women), ce qui signifie protéger les femmes, diriger (manage) les femmes, contrôler les femmes ». (p. 330). Ceci est assorti, comme dans beaucoup d’autres populations de cette région, d’une peur considérable des femmes et du mariage chez les garçons célibataires ; peur qu’elles leur enlèvent de la « force » (ce qui implique des aspects physiques et non physiques) — concept central pour les hommes gainj, et concept relatif (l’augmentation de la force de quelqu’un impliquant une diminution de la force chez l’autre), ce qui est très important entre hommes, mais surtout entre hommes et femmes : une fois marié, l’homme, sous risque de mort, doit empêcher la femme de montrer de la « force ».
Le mari doit donc entre autres « protéger » sa femme : c’est-à-dire notamment la soutenir, prendre son parti, lorsqu’elle a une contestation publique légitime avec une autre femme (il est hors de question qu’une femme puisse avoir une telle contestation avec un homme), et aussi ne la battre (ou lui donner un coup de lance) que lorsqu’elle « a tort », à savoir lorsqu’elle n’a pas rempli ses devoirs d’épouse, de mère, ou ses taches agricoles, ou lorsqu’elle « se montre volontaire (exhibits willfulness) » — auxquels cas c’est non seulement le droit du mari, mais son devoir de la battre.
Dans tous les cas de suicides de femmes observés, le mari n’avait pas rempli ses devoirs de protection envers l’épouse (deux renvoient une de leurs co-épouses qui se disputaient, l’autre soutient sa mère contre sa femme, l’autre bat « à tort » sa femme, et publiquement). Dans tous les cas, le fait de ne pas avoir été traitée correctement par son mari est psychologiquement insurmontable pour la femme puisque sa définition même (apprise de longue date) est d’être soumise mais « protégée ». Il s’agit là pour elle, dit l’auteur, d’un sentiment de rejet social. De fait, l’attente de la femme quant à sa propre personne est bafouée. Mais l’auteur expose par ailleurs les raisons pour lesquelles ni le retour dans le territoire de leurs frères (ce serait pour elles reconnaître qu’elles ont échoué (!) et elles y seraient très mal acceptées, non intégrées socialement), ni le recours aux tribunaux, extérieurs et lointains, ne sont des solutions possibles pour ces femmes.
On voit donc que devant la contradiction : être obligée de rester dans cette société et ne plus pouvoir y être en tant que personne sociale, la seule solution est le suicide… pour elle.
Quant à l’homme dont la femme se suicide, il sera « un objet de ridicule parmi les Gainj. Il a totalement échoué à contrôler sa femme ». En se tuant, sa femme l’a humilié socialement (en plus, il va perdre la dot et payer une compensation à la famille, sans compter que, sur le plan surnaturel, sa femme morte pourra revenir le rendre malheureux, ce qui donne aussi au suicide de l’épouse un caractère de vengeance)… mais on voit que, chez les Gainj non plus, le ridicule ne tue pas26.
Les Gainj expliquent volontiers pourquoi les femmes se tuent. Le suicide, dit P. Lyons Johnson, est certes une tragédie, mais « une tragédie avec précédents, un élément avéré et prévisible de leur mode de vie. Le suicide, ainsi que l’expliquait une femme, est « ce qu’une une femme peut faire lorsqu’elle a trop honte parce que personne ne va prendre soin d’elle » » (p. 326). (De même c’est pour éviter aux hommes la honte qu’ils ressentiraient à voir une femme dont personne ne prend soin que les veuves sont recluses environ six mois ; ibid., note 3.)
« Les femmes gainj ne se tuent pas discrètement. Elles le font à un moment qui exclut qu’on puisse les secourir (habituellement juste avant l’aube), d’une manière qui ne laisse aucun doute gluant à l’intention (pendue à un arbre) et en des lieux qui imposent un constat public (d’ordinaire près d’un chemin très fréquenté). C’est peut-être le seul moment dans la vie d’une femme où elle crée un événement public et calculé, de plus, pour humilier complètement son mari […] » (p. 332).
Sans doute ; mais il semble qu’on puisse n’être pas d’accord avec cette conclusion de l’auteur : « Le suicide est un acte drastique, définitif, mais un acte magnifiquement autonome ; il ne laisse aucun doute quant à qui contrôle sa propre vie » (p. 332). Une telle conclusion me semble certes compréhensible de la part d’une femme (jusqu’où n’irions-nous pas chercher une lueur de liberté), mals je serai plus (vulgairement ?) matérialiste : qui, de fait, contrôle la propre décision de la femme gainj sur sa propre vie (mort) ? Nous l’avons déjà vu, la « liberté » ou l’« autonomie » semblent plus lourdes pour les femmes, surtout « lorsque mieux vaut mourir que vivre » (titre de l’article).
Le contrôle des hommes sur une femme peut être tel que, même pour respecter et soutenir ses propres décisions quant à son existence, ils peuvent se sentir obliger de… la tuer. Ce que nous montre l’histoire de Mary Jemison (op. cit, et cf. supra, note 20) après qu’elle fut devenue veuve.
Les Anglais avaient offert des rançons pour tous les prisonniers qui seraient ramenés à un poste militaire. Mary ayant déjà réussi à échapper à un Hollandais qui avait voulu la capturer alors qu’elle travaillait seule dans un champ de maïs décida, en accord total avec ses sœurs et frères indiens et les chefs réunis en conseil, de ne pas se laisser « libérer ».
Malgré l’avis de Mary et de tous, celui qu’elle appelle « le vieux roi de notre tribu » fait savoir à l’un des frères de Mary qu’il emmènera celle-ci à Niagara pour la rendre avec d’autres prisonniers.
« Violemment irrité contre le vieux roi, mon frère vint à la maison de ma sœur, où j’habitais, et la mit au courant de tout ce qui s’était passé me concernant ; il répéta que, si le vieux roi tentait de m’emmener, comme il en était fermement convaincu, il me tuerait aussitôt et en supporterait les conséquences. Il retourna chez le vieux roi. Dès que je rentrai, ma sœur m’informa de tout ce qu’elle venait d’entendre, et de ce qui, à son avis, m’arriverait sans doute » (p. 95 ; mes italiques).
En attendant la décision finale du roi (et donc du frère), sa sœur lui conseille de se cacher avec son enfant dans les hautes herbes et lui indique le signal par lequel elle lui fera savoir si elle doit être tuée, auquel cas il lui faudra fuir vers une source. Le soir, le signal (de mauvais augure) est là :
« Je compris que mon sort était fixé, à moins que je ne me cache jusqu’à ce que l’orage soit passé. Je rebroussai subrepticement chemin vers les buissons où se trouvait mon petit Thomas, le pris sur mon dos et courus vers la source, aussi vite que mes jambes pouvaient me porter. Thomas avait presque trois ans, il était grand et lourd. J’arrivai à la source le matin de bonne heure, brisée de fatigue et craignant d’être poursuivie et capturée ; ma vie m’apparut alors comme un insupportable fardeau. Je m’assis avec mon enfant […] » (pp. 96-97 ; mes italiques).
Vers midi, elle voit arriver son frère (ne sachant évidemment pas que le roi, ne la trouvant pas, est parti avec les autres prisonniers) ;
« Dès que je le vis, je me mis à trembler, de peur de mourir, mais quand il fut assez près, et que je pus voir son visage, des larmes de joie coulèrent sur mes joues et je ressentis un grand soulagement dont nul ne peut faire l’expérience, à moins que, menacé de mort, il n’ait reçu une grâce définitive » (p. 97 ; mes italiques).
Il est difficile, à travers ce récit, de savoir si le frère en tant qu’individu avait vraiment l’intention de la tuer, si c’était sous le coup de la colère qu’il avait proféré sa menace de mort, si c’était seulement du chantage auprès du roi, etc. Mais ceci n’a guère d’importance. En effet ce qui compte, c’est que les deux femmes (Mary et sa sœur) y croient, et si elles y croient et ont si peur, c’est bien que quelque chose dans la structure des relations entre hommes et femmes rendaient l’acte non seulement vraisemblable, mais probable.
Face aux décisions des hommes, le « choix de vie » de Mary s’était présenté ainsi : être vivante mais étrangère chez les Blancs, demeurer chez les siens, mais morte.
Passons sur les sociétés où les hommes ont tout simplement droit de mort sur leurs femmes, filles, sœurs, etc. Dans la nôtre, où ça n’est théoriquement plus le cas, on peut en déceler comme un regret, compréhensible dans la mesure où il y a une légère contradiction pour les dominants entre d’une part, la réalité objective qui est qu’ils continuent à se servir économiquement et moralement des femmes et d’autre part, le Droit qui fait théoriquement des femmes des individus « libres ». Comme un regret donc, dans les justifications, les « circonstances atténuantes », accordées aux hommes pour les meurtres (comme d’ailleurs les viols) de leurs possessions : les femmes et les enfants.
Que ces justifications (qui évitent de reconnaître la structure de pouvoir objectif entre les sexes) soient, par exemple, la « dépression » ou la folie de l’assassin et le « mauvais caractère » (!) de la femme (cas Althusser/Hélène Rythman), ou des considérations psychanalytico-attristées sur la place difficile de l’homme comme « père » dans la famille matrifocale27, ainsi qu’en témoigne un article récent utilisant les dossiers des Assises criminelles de la Guadeloupe, publié par la revue L’Homme : « Tuer sa femme, ou de l’ultime façon de devenir père » (André 1982). Comme dit l’auteur en guise d’introduction, « la mort » est « excessive bien sûr » mais « avec elle au moins, on connaît le fin mot de l’histoire ». Le mot n’est pas fin28. Et sans avoir besoin de lire l’article, on appréciera immédiatement dans le titre le transfert du mot « ultime », de l’objet femme tuée au sujet homme tueur. Même de leur solution finale, les femmes sont expropriées.
Entre leurs actes et elles, un écran : les hommes
Le degré que peut atteindre l’envahissement du conscient et de l’inconscient des femmes par leur situation objective de dépendance aux hommes et le type de structuration du moi qui en découle apparaissent nettement à travers un article de Sarah LeVine (1982) sur les rêves de jeunes femmes gusii (agriculteurs du Sud-Ouest du Kenya). La recherche eut lieu en 1975-76 et 1979 ; quatre-vingt-huit rêves de vingt-deux femmes entre 18 ans (enceinte du 1er enfant) et 45 ans (11 enfants) — et dont dix-sept étaient enceintes — ont été analysés. Nous utiliserons assez longuement cet article car on peut y trouver rassemblés plusieurs aspects de la conscience dominée des femmes. Prenons d’abord un aperçu de la situation objective de ces femmes :
« Dans cette société exogame, les femmes épousent des hommes de clans qui leur sont traditionnellement ennemis. À l’occasion du mariage, une femme doit quitter sa famille natale pour la maison de son mari, où, au moins au début, elle est considérée avec suspicion comme étrangère (omogeni) : quelqu’un de socialement et moralement inférieur à tous les adultes plus âgés, tant hommes que femmes, de la ferme de son mari. On l’estime dénuée de jugement et incapable de prendre quelque responsabilité que ce soit, autre que les soins aux enfants et le travail manuel » (p.64).
Les Gusii ont un des taux de fertilité les plus élevés du monde. Les dix premières années de la vie d’une femme mariée sont très dures, physiquement et moralement. La jeune femme est surchargée par les travaux agricoles et domestiques, et par les enfants, elle doit être souple (compliant) et respectueuse, etc. Mais c’est uniquement par la maternité, en fait en donnant des fils, qu’elle peut s’assurer un certain respect de la part des membres de la famille de son mari, et que (en conséquence, dirais-je) elle « achieves an adequate measure of self-esteem » (p. 65).
Encore la mise au monde d’un fils n’est-elle pas suffisante puisque la mère ne progressera dans la considération des autres à son égard qu’en fonction de ce que j’appellerais le parcours social de ce fils dans sa carrière d’homme : sa circoncision (vers 10-11 ans), puis le fait que, marié, il aura lui-même (par l’entremise de son épouse) engendré un fils. C’est ainsi seulement à la naissance d’un petit-fils que l’épouse gusii pourra être nommée « respected elder ».
On voit que tout ceci n’a rien de bien particulier ; on retrouve ce schéma dans presque toutes les sociétés composées d’unités domestiques patrilinéaires et patri-virilocales, à pouvoir masculin. Mais ceci est généralement décrit dans les textes ethnographiques en terme de « statut » de l’épouse — dont on va alors pouvoir se contenter de dire qu’il « s’améliore » (ce qui n’est pas faux) avec l’âge, au fur et à mesure de la progression allant de la position de jeune épouse à celle d’épouse avec fils puis à celle de belle-mère (et, dans certaines sociétés, de femme ménopausée). La femme acquerrait ainsi une position de plus en plus forte au sein de la famille, et même du « pouvoir », sur sa ou ses belles-filles, ses fils, son mari… (nous reviendrons plus loin sur les interprétations du « pouvoir » des femmes).
Or, paradoxalement, ceci me semble obscurcir par une description « empirique », apparemment pourtant centrée sur la femme, une réalité théorique à effets empiriques plus fondamentaux : la définition même de la personne de la femme-épouse par son rapport à l’homme, ou plutôt en la personne de l’homme (eût-il deux mois ; on voit assez clairement dans cet exemple gusii que l’enfant mâle doit être mis dans la catégorie « homme » et non « enfant »).
Cette réalité est en un sens reconnue dans certaines descriptions théoriques de la patrilinéarité (cf. Schneider 1962), mais ses effets dans la conscience des femmes, qui nous intéressent ici, ont peu retenu l’attention à ce niveau29.
Cette dépersonnification des femmes (leur réduction à n’être que des supports biologiques et des servantes d’une lignée de mâles dans leurs belles-familles étrangères) me semble paradoxalement confirmée, chez les Gusii, par ce qui pourrait apparaître comme un avantage économique pour la femme et une amélioration de son « statut ». En effet, par la mise au monde d’un fils, la femme devient véritablement « engagée » (committed), commise à son mariage — et ce, que la compensation ait été ou non payée pour elle — car :
« un fils confère à sa mère des droits sur les biens de son père. Même si une épouse cesse d’avoir des relations sexuelles avec son mari, celui-ci ne peut pas la forcer à quitter la terre qu’elle occupe au nom de son fils (in trust for her son) » (p. 65).
On peut donc dire que cette stabilité dans la ferme de son mari (première marque de « statut ») ne lui est accordée que par fidéicommmis30 Cette terre qu’elle travaille dur, elle y devient liée non à cause de son travail de femme mais du fait qu’en tant que mère d’un fils, elle devient elle-même, disons, une procuration vivante, un bon pour pouvoir, (De même il est noté plus loin (p. 72) que les femmes peuvent cumuler des biens et propriétés, mais seulement au nom de « leur maison », c’est-à-dire leurs enfants, alors que les hommes achètent bien entendu pour eux-mêmes.)
Peut-on penser que dans ces conditions un minimum de conscience autonome puisse exister chez ces femmes (conscience autonome qui seule pourrait permettre de parler de « consentement » à la domination) ? Sarah Leine, citant un travail antérieur (Leine 1979), rappelle que certaines jeunes femmes, éprouvant déjà des difficultés vis-à-vis de leur mariage, peuvent réagir par la panique et en tout cas une forte ambivalence à cette marque de « stabilité », de permanence dans la maison de leur mari que représente la naissance d’un fils. (p. 65).
Enfin, pour être, par la naissance d’un fils, « attachées » à la maison du mari, elles n’en font pas pour autant vraiment partie, elles demeurent marginales 1) tant que, nous l’avons vu, ce fils n’est pas circoncis (dix à onze ans plus tard) et 2) tant que leur mari n’a pas payé pour elle la bride-wealth — sujet de préoccupation, de honte et de tristesse chez ces femmes. Or, certaines d’entre elles avaient déjà cinq enfants sans que la compensation ait été versée à leurs parents.. dont elles devaient en plus subir l’hostilité.
Au début du travail de S. LeVine, il y avait 14 « marginales » à un titre ou à l’autre sur les 22 femmes étudiées… De toute façon, même lorsqu’elles ne seront plus étrangères ni marginales, elles seront toujours subordonnées, et l’auteur a pu constater, même chez des femmes de quarante ans ayant dix enfants ou plus, la persistance d’une sorte de « conflit d’adolescence » (conflict of youth) : rester chez ses parents/partir se marier, et la nostalgie de leur jeunesse dans la maison natale. Chez toutes ces femmes mariées, un intense sentiment de souffrance s’exprime à travers les rêves ; et elles s’y représentent essentiellement comme victimes de violence.
La femme comme séparée de ce qu’elle accomplit, non-sujet de ses actes31
Alors que leurs rêves sont concrets et réalistes (pas d’abstraction ni de métaphores), et alors qu’elles passent un temps considérable à travailler la terre du mari et à s’occuper des animaux domestiques, ces femmes font très peu état dans leurs rêves des actes matériels de leur existence. (Le seul rêve où apparaisse la terre était celui d’une femme qui en avait effectivement la responsabilité, son mari étant alcoolique et souvent en prison…) D’une manière générale d’ailleurs, les objets matériels apparaissent peu dans leurs rêves ; mais celui qui apparaît le plus souvent est la voiture, symbole de richesse et de pouvoir… Symbole aussi, pour les femmes, de la possibilité de s’échapper, comme en témoigne le rêve d’une jeune femme supportant très mal sa situation conjugale (fils non circoncis, mari impuissant et jaloux, lui interdisant de quitter la ferme) ; elle rêve qu’elle conduit la voiture de l’ethnologue :
« Éveillée comme endormie, elle voulait être libre, mais elle redoutait que le prix à payer pour la liberté fût l’ostracisme et la mort » (p. 73).
De même, alors que la maison est un symbole central dans la culture gusii, et que les femmes sont dans la vie quotidienne très concernées par leur maison, elles en rêvent très peu, tout comme de la nourriture ou des récoltes pour lesquelles elles travaillent tant (p. 75).
La femme comme absente d’elle-même
De même que de leurs activités concrètes, ces jeunes femmes sont en quelque sorte « détachées » de leurs rêves et d’elles-mêmes, et ce de plusieurs façons :
1) LeVine note (pp. 69-70) une importante proportion de rêves d’où ces femmes sont absentes comme sujet participant à l’action (26 fois sur 100) et interprète cette disparition du sujet comme l’expression de la marginalité de leur statut et de la conscience de leur impuissance. (Dans les cas de ces femmes, dit-elle avec humour noir, il semble qu’on ne saurait appliquer la théorie, élaborée par Adelson, selon laquelle seuls les gens ayant un sens artistique créatif sont capables d’être absents de leurs rêves…)
2) Dans deux rêves seulement (sur 66 où il y avait violence ou danger), la femme agresse elle-même quelqu’un — ceci contrastant de manière frappante avec une étude menée aux USA où les femmes agressaient autant qu’elles étaient agressées.
Certes, dit l’auteur (pp. 70 et 75), l’éducation des enfants gusii (à qui on évite lorsqu’ils sont bébés toute expérience frustrante ou désagréable) décourage l’expression de l’agressivité ou d’une trop forte affirmation de soi, et la culture gusii elle-même permet la projection de ces sentiments interdits sur d’autres (qui peuvent donc devenir les agresseurs dans les rêves, par exemple).
Mais la placidité et la passivité sont inculquées plus fortement aux filles qu’aux garçons, filles qui auront à subir dans le mariage, en tant qu’étrangères soumises, les conditions psychologiques de défiance et de soupçon évoquées plus haut.
« Là, en tant qu’étrangères, elles doivent se conduire avec précaution (they must treat a fine line) car à la moindre, ou même sans, provocation, elles peuvent subir les critiques, l’ostracisme et autres mauvais traitements » (p. 75).
Enfin, cette incapacité à se concevoir comme se défendant soi-même ou agressant quelqu’un reflète à mon sens bien évidemment l’impossibilité réelle et concrète de tels actes, et notamment contre des hommes. Une jeune femme, dans le seul rêve où elle se voit agressant quelqu’un, lance une pierre à… une femme, l’épouse de l’homme (cousin de son mari) qui la poursuit sexuellement de fait.
3) Autre point intéressant : ces femmes se comportent vis-à-vis de leurs rêves d’une façon apparemment contraire à la conception conventionnelle du rêve dans la culture gusii. En contraste avec beaucoup d’autres groupes banni, les Gusii ne considèrent pas le rêve comme une communication de puissances ancestrales ou le résultat d’actes de sorcellerie. Le rêve est une affaire privée, on en est le seul créateur et on en porte seul le poids affectif éventuel, sans avoir recours à des devins ou à des guérisseurs. D’autre part, le rêve est censé prédire l’avenir (mais généralement de façon inverse ou détournée), et lorsqu’on rêve de quelqu’un on doit lui en parler (pp. 66-67).
Or, ces femmes présentaient leurs rêves comme des produits étrangers à elles-même, dont elles n’étaient pas responsables (p. 68). LeVine relie cette attitude, ainsi que la réticence des femmes à parler de leurs rêves, à la position de subordination des jeunes femmes mariées. Être réservée, ne pas s’affirmer, ne pas attirer l’attention sur soi, ne pas être « responsable » (même de ce qu’on pense…), de peur de conséquences néfastes.
Si l’on ajoute que (p. 67) — autre écart par rapport à l’attitude conventionnelle envers le rêve — plusieurs informatrices ont laissé comprendre qu’elles pensaient que leurs rêves prédisaient le futur exact (et non de manière inverse ou détournée) — i.e. rêver que quelqu’un va mourir veut dire que la personne va mourir — et en conséquence se taisaient — n’appliquant pas, volontairement, la norme d’en parler à la personne concernée (d’où culpabilisation, peur, isolement en soi-même) —, on voit dans quel puzzle psychologique se trouvent ces femmes, persuadées qu’elles savent la vérité, et ne pouvant appliquer la norme, parce que leur code est contraire aux idées officielles.
L’envahissement de la conscience par le pouvoir des hommes
Rêvant peu à leurs actes quotidiens, et peu à elles-mêmes en tant qu’actrices actives, à quoi rêvent donc ces jeunes femmes gusii ? « Exclues du pouvoir, elles rêvaient de relations », dit LeVine, relations où elles se représentent elles-mêmes essentiellement comme victimes de violence ou d’abandon :
« Plutôt que d’utiliser les rêves pour exprimer l’hostilité qu’elles doivent contrôler et réprimer pendant leurs heures de veille, ces femmes, tant dans leurs rêves que dans la vie réelle, se représentent elles-mêmes logiquement comme victimes de violence ou souffrant de rejet et de perte d’objet » (p. 70).
Elle ajoute aussitôt que, dans la vie réelle, seules quelques femmes étaient battues par leur mari, que la plupart n’étaient pas soumises « to violence as such » ; elle attribue leur sentiment de souffrance et leur impression d’être soumises à de l’hostilité, à des « more general factors » : marginalité du statut, circonstances économiques mauvaises (dont il est dit par ailleurs qu’elles sont en partie responsables de la fréquence du non-paiement de la bride-wealth), fardeau du travail…
Or, me semble-t-il, outre que la « marginalité » du statut et le fait d’être battue relèvent d’une seule et même violence faite à la personne, faut-il rappeler que — surtout dans des petites sociétés où le moindre fait est connu de tous — il n’est pas nécessaire que toutes les femmes soient battues à tout moment pour que l’assurance et la peur de la violence générale qui leur est faite leur soient imprimées dans l’esprit ?! Nous reviendrons sur ce point. N’oublions pas non plus que le viol fait partie intégrante des cérémonies nuptiales gusii, comme le mentionne P. Tabet (1985 : 78, parlant du « domptage meurtrier des femmes pour en faire des corps-outils de reproduction »), et que :
« la conception du coït en tant qu’acte par lequel un homme triomphe de la résistance d’une femme et la fait souffrir n’est pas limitée à la nuit de noces ; elle demeure importante dans les relations conjugales » (R.A. LeVine 1959 : 969).
La moitié des rêves sont donc centrés sur les relations sociales les plus proches du sujet, celles qui déterminent directement sa vie, avec à quasi égalité d’occurrences : les enfants d’une part, le mari et les parents de la femme d’autre part. Disons, ses enfants : seule source reconnue de la définition de sa personne, et de son « accomlissement » ; ses parents et son mari ceux qui l’ont échangée et se disputent sur le (non-)paiement de sa « compensation » ; son mari : celui auquel elle est aliénée.
Mais il est un point particulièrement frappant :
« Étant donné l’importance de leur relation avec la mère de leur mari, il est à remarquer qu’un personnage de belle-mère n’apparaît que 7 fois sur 88 rêves.
Au surplus, en dépit de leur contact quotidien intensif avec des femmes de leur belle-famille, il semble que ces femmes attachent plus d’importance à leurs relations avec les membres masculins du lignage où elles se sont mariées. Ainsi, alors qu’elles rêvaient souvent de femmes (26 fois) de leur ferme natale, elles rêvaient plus souvent des hommes (35 fois) de leur résidence maritale. Dans leurs rêves, elles reconnaissaient donc les réalités du pouvoir et de l’autorité. Bien qu’elles révèlent leur besoin de protection et leurs désirs de soins et d’affection dans des rêves portant sur leurs propres mère, sœurs, tantes et grand-mères, plutôt que sur leurs père et frères, elles rêvent plus souvent de leur mari, de ses frères et de ses cousins mâles que des femmes de la maison de leur mari. Toutes les femmes, en vertu de leur sexe, sont nées pour se marier à l’extérieur et devenir des étrangères sans pouvoir. Par définition, donc, même après le mariage, les femmes sont moins à prendre en compte que les hommes » (S. LeVine 1982 : 69 ; mes italiques).
Ainsi, souffrantes et sceptiques, les femmes gusii, semble-t-il, ne s’en laissent pas compter… C’est bien aux hommes qu’elles attribuent le mécanisme du pouvoir, pas aux belles-mères. C’est bien aux femmes qu’elles savent qu’on peut jeter des pierres, pas aux hommes. Ce sont les femmes de leur enfance qu’elles regrettent, pas les hommes.
La terre, qu’elles travaillent par délégation, un symbolisme culturel dont, si elles y participent, elles ne sont pas détentrices, tout cela ne les concerne pas autrement que médiatisé ? — Elles n’y rêvent pas. En revanche, ce à quoi elles ont un accès immédiat, c’est leur situation d’impuissance structurelle. De cela elles rêvent, et de façon réaliste. Leurs rêves et elles-mêmes sont englués dans le concret, dans un concret limité, et elles vont droit à l’essentiel : la limitation elle-même, la dépendance. Il semble qu’au sens propre elles ne puissent se désengluer de ce qui est la substance même de leur subordination le filet des relations où elles sont prises.
Elles sont d’ailleurs parfaitement conscientes que leurs rêves expriment directement les faits qui les concernent :
« Alors que ces femmes faisaient une différence très claire entre l’éveil et le sommeil, elles tendaient néanmoins à considérer leur expérience de rêve comme étant en continuité avec leurs pensées éveillées » (p. 73).
Prenant à juste titre leurs rêves au pied de la lettre, comme une description réaliste de leur propre situation, comment ne penseraient-elles pas alors, au fond d’elles-mêmes, que lorsqu’on rêve que quelqu’un va mourir, il va mourir (et non se bien porter, selon le code officiel) ? Et si certaines de ces jeunes femmes (celles qui rêvent le plus) ne partagent pas les idées officielles sur la psychologie du rêve, n’est-ce pas à mettre en relation avec le fait que, si elles « partagent » (et de quelle place) la connaissance de la réalité de la domination des hommes sur les femmes, elles semblent bien ne pas « consentir » à l’imbroglio mental ni à la souffrance de l’oppression ?32
L’envahissement de leur conscience par le pouvoir omniprésent des hommes sur elles semble assez clair dans le rêve suivant, où les décisions cruciales (et brutales) tout comme les symboles du pouvoir (la voiture du gouvernement) sont bien attribués aux hommes (père, maris et homme de la parenté du mari) :
« J’ai rêvé que ma mère était divorcée33 par mon père. Tous ses vêtements étaient ensanglantés. Elle portait dans ses bras un bébé garçon, habillé avec les vêtements que mon mari lui avait achetés. Eux aussi étaient couverts de sang. Ma mère est venue ici, trouver mon mari ; elle pleurait et criait : « Jacob divorce d’avec moi parce que tu n’as pas payé le bétail pour notre fille. Mon vêtement est couvert de sang parce que Jacob me bat. » Puis j’accompagnais ma mère tout le long d’un chemin environné d’eau, jusqu’à la route principale où nous avons trouvé un parent de mon mari dans une Land Rover du gouvernement du Kenya. Il nous conduisit jusqu’à l’hôpital. Puis je revins à la maison et je dis à mon mari que je le quittais parce que, en ne payant pas pour moi, il avait causé tant d’ennuis. Il me suppliait en pleurant de ne pas emmener nos enfants » (p. 68 ; mes italiques).
Notons de plus que le bébé « rêvé » (c’est le cas de le dire ) est un garçon. L’enfant mâle (et pas seulement chez les Gusii) étant l’incarnation la plus « proche » pour la mère de la masculinité, et en conséquence un des facteurs les plus importants de la médiatisation de sa conscience par le pouvoir masculin34.
Et ceci ne joue pas seulement au niveau des « représentations ». C’est très matériellement que cette médiatisation s’exerce (sous ce que les ethnologues désignent généralement par des formules apparemment inoffensives, du genre : « Les garçons restent avec les femmes jusqu’à l’âge de x ans où ils sont admis dans la société masculine »).
Pour ne prendre qu’un seul exemple, citons le cas des hammam dits « des femmes » (cf. Bouhdiba 1982 :197-213). L’auteur montre qu’elles y amènent en fait leurs enfants, dont les garçons jusqu’à l’adolescence. Il présente le hammam pour le garçon comme un lieu hautement érotique, laisse entendre que c’est quand celui-ci a touché une femme qu’on prie la mère de ne plus l’amener, et explique alors combien est dure pour lui cette séparation du monde des femmes, et l’entrée dans l’univers exclusivement masculin… Mais nous, que voyons-nous ? Qu’il ne s’agit pas seulement là du problème de la relation mère-fils (sur laquelle Bouhdiba fait des développements parfois fort justes). Nous voyons que sous l’interdit pour les garçons d’érotiser « concrètement » la nudité des femmes, de s’approprier ouvertement (en la touchant) le corps d’une femme, leur présence est le moyen objectif par lequel chacune et donc toutes les femmes du quartier ou de la communauté auront été vues, et appropriées en pensée, par tous les jeunes garçons, donc par tous les hommes. Apprentissage « érotique » du garçon, sans doute. Mais j’y verrai surtout, ce qui n’est pas relevé par l’auteur, l’apprentissage pour les femmes d’être constamment sous le regard (le contrôle) des mâles. On doit alors se demander si, dans ces circonstances, il peut y avoir conscience, pour les femmes, d’un « groupe pour soi »35… et quel apprentissage pour elles de « l’érotisme » (cf. infra, note 31).
Du « statut » de l’opprimée et de l’interprétation du discours
Ainsi avons-nous vu les jeunes femmes gusii savoir que ce sont les hommes, et eux seuls, qui ont le pouvoir sur les femmes, et non leurs représentants féminins, même sous forme « d’autorité » de belles-mères. Savoir qu’elles n’ont pas de part au pouvoir, que tout ce qu’elles « peuvent » faire, c’est d’être un peu mieux acceptées au fil des ans quand elles auront accompli ce que les hommes attendent d’elles. Pourtant, nombre d’ethnologues, et surtout des femmes — sans doute impressionnées, et à juste titre, par le travail mental et matériel considérable que doivent faire les femmes pour survivre un peu décemment en tant qu’être humain dans certaines sociétés — persistent à utiliser le terme de « pouvoir » pour désigner la maigre réussite des femmes dans les arcanes du pouvoir masculin.
Prenons à titre d’exemple les Mongols, chez qui « l’autorité ne peut venir aux femmes que lorsqu’elles ont mis des fils au monde et ne s’affirme vraiment, que lorsqu’elles cessent de pouvoir le faire » (Hamayon 1979 : 129). L’auteur affirme :
« En somme, c’est largement à elle-même (à sa fécondité, à son travail, à ses qualités et performances personnelles) que la femme doit sa part de pouvoir. Qu’elle soit responsable, du moins en partie, de sa position est en soi une sorte de compensation à son infériorité statutaire. Elle n’en semble pourtant guère consciente, persuadée qu’elle est d’être au service de l’homme, prête à n’exister que pour l’épanouissement de celui-ci ou, ce qui revient au même, de sa lignée. Aussi est-ce souvent par et pour ses fils qu’elle agit et s’exprime » (p. 130 ; mes italiques).
Plus haut, il est dit que « les ordres qu’elle donne sont présentés par elle comme venant de l’homme » et que « ses avis et ses décisions sont divulgués par l’homme » (p. 129). Enfin, les « voies d’émergence » pour les femmes dans cette société sont : soit (pour toutes) « promouvoir la position de son mari ou de son fils », soit, pour les fortes personnalités : 1) devenir chamanesse (voie contrecarrée chez les femmes36 ) ; 2) fuir ; 3) se suicider, « pour assouvir dans l’au-delà sa vengeance en envoyant aux vivants diverses catastrophes » (p. 130). On voit le choix…
« Persuadées qu’elles sont d’être au service de l’homme »… Mais elles sont au service de l’homme ! comme l’article lui-même le démontre par ailleurs fort clairement.
Il n’est pas rare de trouver chez des ethnologues une sorte de coefficient de dénégation des dires ou des comportements des ethnologisés. Mais cette dénégation semble curieusement (?) affecter davantage 1) les ethnologisées et 2) un aspect essentiel de la vie des femmes, la domination masculine. (Cf. entre dizaines d’exemples, Rogers 1975 sur la paysannerie française, et Cronin 1977 sur la Sicile. Au contraire, contre l’idéologie du pouvoir des femmes, cf. Tassé 1982.)
Qu’il s’agisse des pleurs ou plaintes rituels qui accompagnent la jeune fille au mariage dans de nombreuses sociétés, ou de n’importe quelle affirmation par les femmes de la dureté de leur existence par rapport à celle des hommes, on tend à mettre en doute le rapport direct entre ces faits et dits et la réalité qu’ils traitent. Or, met-on si facilement en doute le sens guerrier d’une danse guerrière des hommes (même si ce n’est pas, ou plus, le seul sens de la cérémonie), ou la signification d’exaltation des hommes à la guerre dans les chants et exhortations des femmes qui accompagnent leur départ ?…
Qu’en est-il donc de ce discours tenu par et sur les femmes, et quelle interprétation peut-on en donner ? Reprenons l’exemple des Mongols et Bouriates :
« À l’inverse [du discours masculin qui se déploie sur le mode de la glorification, et même de la vantardise], c’est sur le ton de la complainte que se déroule le discours féminin. En dépit de la tendresse qui entoure son enfance, la petite fille s’instruit vite du sort qui l’attend après son mariage : son rôle, sa raison d’être même sera de fournir à la lignée de son mari progéniture et main-d’œuvre. Le mariage lui est présenté comme une rupture brutale (et on la convainc que tel est le cas) entre une enfance choyée et une vie de production et de procréation forcenées. Des chants mélancoliques lui enseignent la douleur d’être séparée des siens, livrée en échange de quelques vaches, promise à une vie lointaine et dure dont aucun de ses frères n’ira la libérer. Elle apprend que de son bonheur nul ne se souciera […].
Aucune compensation ne vient éclaircir l’horizon de la jeune fille, si ce n’est la perspective bien lointaine d’établir un jour ses enfants et, satisfaite du devoir accompli, de se décharger des tâches domestiques sur ses belles-filles et de jouir tranquillement du respect général ; cela revient, pour l’épouse, à ne s’épanouir que lorsque cesse sa vie biologique de femme. Aussi voit-on des mariées en pleurs. On va même, dans certaines régions, jusqu’à leur bander les yeux au moment de partir en cortège nuptial, pour les désorienter et ainsi les empêcher symboliquement de revenir chez elles […].
Toutefois, bien des signes incitent à mettre en doute l’authenticité des doléances féminines explicites [note 16 : » Mais non celle de leurs frustrations et de leur ressentiment qui s’exprimeront plutôt par le refoulement silencieux, la fugue ou le suicide. » ] » (Hamayon 1979 : 124 ; mes italiques).
Parmi les « signes » invitant l’auteur à mettre en doute l’authenticité des doléances féminines ritualisées, il apparaît que le tableau serait « noirci » par rapport à « l’existence réelle » des femmes. Ceci réfère à l’idée que les femmes ont quand même du « poids », « du pouvoir », de « l’autonomie » dans la vie domestique (tous termes employés dans l’article).
C’est un argument extrêmement fréquent dans la littérature ethnologique (et n’importe quelle conversation), surtout de la part de femmes. Au fond, un peu d’autonomie par-là, un peu d’oppression par-ci, ça peut aller. Or le tableau, d’après les données elles-mêmes, ne semblent pas « noirci ». Simplement, il s’attache au fondamental, au structurel (comme les femmes gusii), pas aux détails. Les femmes dans ce type de sociétés patriarcales ne sont pas à mon sens autonomes, mais elles sont auto-mobiles, or, même à distance, une automobile est gouvernée, elle n’est pas auto-nome.
Au fond, utiliser « l’autonomie » pour dénoircir le tableau de l’oppression revient à s’étonner que l’opprimé(e) bouge encore — et donc à admettre sans parfois s’en rendre compte que « un bon opprimé est un opprimé mort », pour paraphraser une sinistre expression bien connue. Mais c’est là, en ce qui concerne les femmes (comme les esclaves, comme les colonisés), camoufler l’intérêt économique de certains types d’oppression (à quoi il faut ajouter pour les femmes l’intérêt biologique). Va-t-il falloir rappeler qu’il est tout à fait nécessaire que l’instrument de production (et de reproduction) que peut constituer un être humain exploité ne soit pas mort, qu’il agisse37 ?
Et d’ailleurs, ce que veut l’opprimé lui aussi, mais pas pour les mêmes raisons que l’oppresseur, c’est survivre, vivre quand même ; donc, d’une part, il faut considérer les (rares) occasions où sa situation est socialement exposée (que ce soit directement comme dans les rituels ci-dessus ou indirectement dans les rites d’inversion) comme une possibilité d’expression aussi de sa part (malgré la mystification et l’illusion d’autonomie qu’elles peuvent lui donner) ; d’autre part, et plus souvent, voulant survivre, il « refoule » dans l’oppression, ce qui ne veut pas dire qu’il consent à l’oppression. Rappelons l’histoire du coffre : la femme a dit devant le tribunal qu’elle consentait… mais à quoi ? — À être enfermée dans ce coffre la nuit ; c’est-à-dire à être tranquille quelques heures sans que son mari l’accuse d’adultère et sans être menottée à son oppresseur dans le lit conjugal. Un bel exemple de « l’autonomie »… contrainte.
Enfin, en ce qui concerne le discours direct (et non plus ritualisé) des femmes, peu d’ethnologues, semble-t-il — même lorsqu’ils/elles sont intéressés à le recueillir —, s’attachent à la situation structurelle dans laquelle il s’exprime : dans quel contexte objectif par rapport au pouvoir immédiat des hommes la personne s’exprime-t-elle, ou dans quelle situation de (même relative) liberté, non seulement de parler, mais de penser son expérience se trouve-t-elle ? Ceci peut être particulièrement important en ce qui concerne le vécu des relations sexuelles : voir par exemple Echard (in L’Arraisonnement des femmes, 1985 : 42, note 8) qui remarque que la violence et la surveillance exercées sur les femmes en ce domaine, de même que les subterfuges qu’elles trouvent pour tenter d’échapper à l’imposition des rapports sexuels sont surtout exprimés, et avec force, par des femmes se trouvant hors mariage… Nous retrouverons cette question plus bas, à propos de l’interprétation du « partage » des connaissances masculines par les femmes.
Un autre avatar de l’argument du « pouvoir » des femmes consiste à utiliser les femmes âgées (la maturité ou la « vieillesse » étant bien entendu relatives selon l’état démographique et l’organisation sociale de chaque population) : ce sont, dit-on, les vieilles femmes qui « reproduisent » la domination masculine par leurs pratiques envers les jeunes femmes (rôle dans les initiations féminines, contrôle sur la belle-fille ou les co-épouses plus jeunes, etc.).
Il ne semble pas difficile de comprendre que : 1) ne le feraient-elles pas, elles subiraient l’ostracisme, sinon même la répression physique dans certaines sociétés ; 2) étant donné que leur propre soumission dans leur jeunesse a été leur moyen de survivre, au sens d’échapper à la mort en cas de révolte, et plus généralement au sens de vivre quand même (« il faut bien vivre »), c’est-à-dire s’adapter aux conditions sociales données pour se faire quand même une vie d’être humain et pour être à peu près tranquilles — les vieilles femmes ne puissent imaginer d’autre méthode que d’enseigner aux jeunes ce qu’elles croient être « leur » méthode d’adaptation personnelle et qui leur est présenté de plus comme constituant leur valeur ou leur courage de femme. « Ma mère, parce qu’elle était très malheureuse avec mon père, elle me disait : Yolande, écoute, fais comme moi, sois souple », disait récemment une femme (devenue âgée…) à la télévision (cf. Tresgot 1983).
Le « pouvoir » des vieilles femmes sur les jeunes est certes en partie vrai, mais il semble mal interprété si l’on s’en tient là, c’est-à-dire si l’on n’ajoute pas qu’il s’agit d’une influence par délégation et contrainte mentale, un pouvoir qui n’exprime en fait que l’absence de pouvoir des femmes — de même que le prétendu pouvoir des femmes sur les enfants n’est que l’image inversée de la contrainte aux enfants qui pèse sur elles. (La contrainte aux enfants n’est pas seulement physique et mentale, comme nous l’avons vu plus haut, elle est aussi une contrainte morale, qui, puisque les femmes ont la responsabilité des enfants, les oblige à subir des choses auxquelles elles ne consentent pas : « Il me dégoûtait, il sentait le vin… Fallait le subir, sinon c’était toute la nuit qu’il faisait des sérénades. Alors, comme il y avait les enfants… » ; cf. Tresgot 1983.)
Cet argument est donc restrictif de la réalité de ce que vivent les femmes — ce qui n’est pas pour nous étonner, étant donné que la complexité, la structure contradictoire, de ce que vivent les dominé(e)s est généralement ignorée ou tout bonnement niée par certains ethnologues. Il élimine aussi un aspect important de la vie des femmes que l’on retrouve dans de nombreuses sociétés : ce que j’appellerais une sorte de « solidarité de survie » féminine (mais bien sûr non « féministe » puisqu’il ne s’agit que d’une adaptation au système ; cf. sur ce sujet Caplan & Bujra 1978).
On trouve dans Yanoama (Biocca 1968) de nombreux exemples de solidarité des femmes contre la violence des hommes. Un jour une cinquantaine d’hommes d’un autre groupe veulent prendre Helena Valero, la jeune femme blanche vivant dans un groupe d’Indiens. Ce sont les femmes de son groupe qui avaient pris soin d’elle jusque-là qui l’arrachent (au sens propre) à ces hommes.
« Les femmes de ce petit groupe accoururent à mon secours ; aucun des hommes, par contre, ne fit un geste pour me défendre. La femme leur disait : « On dira que vous êtes des lâches, lâches, que vous la laissez emmener sous vos yeux. » Elle criait, elle pleurait ; mais eux, mouchés dans leurs hamacs, ne regardaient pas ; ils nous tournaient le dos » (Biocca 1968 :142).
Il faut dire qu’elle n’appartenait encore à aucun… Plus tard, mariée, elle et deux de ses co-épouses se font battre par leur mari Fousiwe, parce qu’elles n’ont pas dénoncé une autre co-épouse dont l’enfant pleurait, ce qui énervait le mari. La mère de Fousiwe prend âprement la défense de ses belles-filles.
« Fousiwe dit alors à sa mère : » Tu protèges ces femmes. » — » Oui, je les protège parce que quand j’ai quelque petite blessure, j’en éprouve de la douleur ; elles aussi sont des personnes comme moi, comme toi. » Le touchawa alors s’éloigna » (ibid. : 176).
Les ethnographes préfèrent généralement insister sur les querelles entre femmes, notamment dans la polygynie, sans trop préciser qu’il s’agit là d’un effet direct (et d’une tactique) du pouvoir masculin — la relation entre ces femmes étant là encore, et de façon particulièrement évidente, médiatisée par l’homme, par un homme, le mari. Le comble est atteint lorsque la « division » des femmes (tout comme leur « consentement ») est théorisée comme l’une des « sources » (je cite) de la domination des hommes (Godelier 1982 : 233). Quand l’effet devient cause, la division des femmes n’est plus loin d’apparaître comme un facteur, un défaut intrinsèque… à elles-mêmes.
Du « partage » des idées
On va partager :
Une part pour moi, une part pour toi ;
Deux parts pour moi, une part pour toi ;
Trois parts pour moi, une part pour toi..
(Histoire plaisante)
Qu’il s’agisse des représentations, des valeurs, de l’idéologie, ou des biens matériels, quel est par définition le partage entre dominants et dominées, sinon le partage inégal ? Ceci continue d’être analysé pour les aspects matériels (cf. récemment Tabet 1979), mais semble avoir moins attiré l’attention pour les aspects idéels de l’oppression (Godelier [1982] donne toutefois de nombreuses infor-mations à ce sujet, sans en tirer toutes les conséquences).
Dominants et dominés — ici hommes et femmes — ne reçoivent en partage, comme on dit, ni la même quantité, ni la même qualité d’information sur les connaissances, les représentations et les valeurs. Je parle ici bien sûr des informations initiatiques lorsqu’elles sont différenciées selon le sexe, mais aussi des informations qui sont censées être communes. De plus, l’information serait-elle théoriquement « la même », l’expérience vécue n’en est pas semblable de part et d’autre de la barrière.
Du « partage » des valeurs
Nous avons vu plus haut qu’une des raisons de la limitation de la « conscience propre » chez les femmes est que la plupart de leurs actes sont orientés en fonction des autruis dont elles dépendent et qu’elles servent matériellement, soit parce qu’ils ont objectivement pouvoir sur leurs propres décisions, qu’ils les médiatisent, soit parce que la valeur utilisée pour amener la décision était reconnue comme liée à la situation spécifique de « femme » (comme par exemple dans le cas du suicide des femmes gainj lorsqu’elles ne sont plus « protégées » par leur mari).
Un autre aspect de la médiatisation, de aliénation de Ia conscience peut toutefois apparaître, paradoxalement, même lorsqu’une femme s’applique à un but 1) dont elle est (elle semble) l’objet principal et 2) pour lequel elle va prendre comme modèle d’action une valeur « générale » (ou qu’elle croit telle) de sa société ; — et même lorsque le pouvoir des hommes pourrait en cette circonstance apparaître, à elle ou à d’autres, lointain ou hors de question.
Prenons des valeurs comme la dignité humaine, le courage ou la force personnelle, dont on peut dire qu’elles sont quasi universelles (quoique avec des contenus ou des champs d’application différents, bien entendu, selon les sociétés).
Le courage
Chez les Ibibio du Sud-Nigeria, le Nyama est une société de femmes qui président à l’initiation des jeunes filles nubiles juste avant le mariage (la clitoridectomie ayant été pratiquée antérieurement). M. D.W. Jeffreys (1956) — à partir d’un texte de Robins (1867) sur les femmes ibo du Nigeria — décrit la technique des scarifications sur les jeunes filles ; puis il ajoute :
« Cependant, les filles qui ont beaucoup de scarifications sont évitées par les hommes, qui disent qu’une fille qui peut supporter un tel degré de douleur et de souffrance est trop difficile à manier. La battre est sans effet sur elle » (p.17).
On peut supposer que c’est la valeur générale « courage » qui est mise en avant lors de la cérémonie entre femmes, mais voilà, du courage il n’en faut pas trop non plus à une femme, sinon : elle ne trouve pas de mari… Or, c’est pour le mariage qu’elles sont scarifiées. La valeur générale est donc en contradiction avec une autre valeur, spécifiquement élaborée pour les femmes : elles doivent pouvoir être « maniées » et battues avec résultat (la soumission).
On doit alors se demander ce qui peut se passer dans l’esprit de ces jeunes filles en même temps que l’atroce douleur corporelle qu’elles subissent « courageusement ». La valeur qu’elles mettent en acte, elles doivent l’envisager au rabais. Subir une torture physique ne peut être acceptable (et éventuellement bénéfique) pour l’esprit que si la valeur qui lui est associée est pleine et au plus haut niveau d’adéquation entre l’idéologie qui sous-tend cette valeur et ce qui est attendu de la personne. Il semble que c’est ce qui se passe pour les initiations masculines avec épreuves physiques extrêmes qui existent dans certaines sociétés. Mais on ne contestera pas d’autre part que le réflexe de tout un chacun est que la douleur soit la moins forte possible ou du moins qu’elle dure le moins longtemps possible. Ainsi, ce qui s’imprime à mon sens dans la conscience de ces jeunes filles, à l’occasion de ces scarifications qu’elles sont à la fois obligées de subir pour se marier mais dans une mesure acceptable pour les hommes, c’est l’abandon de son propre courage et non son exaltation, l’abandon de la capacité à surmonter au maximum de soi-mêine l’épreuve, toute épreuve à venir. Le courage leur est mesuré. Elles n’auront plus ensuite à « consentir » à la domination des hommes, elles auront déjà en partie démissionné d’elles-mêmes. La limitation de soi leur aura été scarifiée dans la conscience. Leur accès à l’idéel général (idées, valeurs, représentations) est au sens propre borné38. Voyons d’ailleurs quelles interprétations donnent certaines sociétés du « courage » des jeunes filles lors des rituels, et par exemple de l’excision.
Les Gisu (société patrilinéaire à forte dominance masculine, à la frontière du Kenya et de l’Uganda) ne pratiquent pas la clitoridectomie39. Ils pensent que supporter l’excision donne trop d’indépendance d’esprit aux femmes :
« Les Gisu, prétendent que les femmes circoncises de leurs voisins les Sebei sont grossières (rude), désobéissent à leurs maris et défient leur autorité. Leur volonté est fortifiée, croient les Gisu, par l’épreuve du couteau » (La Fontaine 1972 :174).
Mais les Sebei, qui la pratiquent, estiment qu’elle brise toute arrogance et canalise vers une bonne conduite :
« ll est intéressant de noter que les Sebei tiennent que la clitoridectomie rend une fille humble et apte à être le conjoint subordonné. Ils désignent les femmes gisu, selon eux déréglées et couchant avec n’importe qui, comme des exemples répugnants de ce que peuvent devenir des femmes non circoncises » (ibid. : 185, note 10).
Peut-être pourrait-on conjoindre ces deux vérités partielles en disant que l’épreuve — dans la mesure où elle est déjà inscrite dans une pratique et un enseignement de limitation de soi par soumission à l’homme — fortifie sans doute la capacité de « résistance » (au sens de supporter) et brise la capacité de résistance (au sens de refuser)…
Plus encore que l’expression pleine du courage, c’est souvent la simple affirmation de soi qui est interdite aux femmes. Les exemples concrets ne manquent pas (cf. supra chez les Gainj, les Gusi, les Mongols…), mais reprenons plutôt nos mythes kikuyu dont on avait vu plus haut combien — à l’instar de Freud — ils disent merveilleusement les mécanismes de l’oppression des femmes, tout en la justifiant. Si une femme affirme trop clairement faire ce qu’elle fait, ou ce qu’elle pourrait faire, ou éventuellement se sentir en liberté de faire, voilà qu’elle est « arrogante » — et le malheur général s’ensuit. Après la justification du pouvoir politique d’État, puis familial, des hommes kikuyu (cf. Beecher 1938), voici la fustificatien de leur pouvoir économique. Un mythe, que je résume, raconte pourquoi seuls les hommes sont désormais autorisés à posséder des troupeaux :
ll y a très longtemps, les femmes comme les hommes avaient des troupeaux. Dieu visite la terre, rencontre un homme et lui demande à qui sont ces bêtes. Elles sont à moi, répond l’homme, jusques et y compris les poils de leur dos. Dieu est très satisfait. Plus loin il rencontre une femme et lui pose la même question. « …et, dans son arrogance, la femme répondit : bien sûr qu’elles sont vraiment à moi, et pour en faire ce que je décide, et même de les jeter ou de les détruire si j’en ai envie. » Dieu est très mécontent, fait se sauver les bêtes dans la forêt, où elles sont devenues les animaux sauvages de la terre. Et depuis, seuls les hommes… (refrain).
La dignité
En France, par exemple, l’une des situations concrètes qui fera entrer en jeu la notion de dignité personnelle est le manque d’argent : « Je ne vais pas mendier, j’ai ma dignité. »
Nombre de femmes séparées du père de leurs enfants invoquent encore cette notion pour ne pas lui réclamer la pension alimentaire de leurs enfants lorsqu’elle ne leur est pas versée. Chez une femme de ma connaissance, l’appel à la dignité était soutenu, de plus, par une autre valeur « générale » (dans notre société) : la notion d’autonomie de l’individu(e) : « Je n’ai plus rien à voir avec ce monsieur. »
On voit comment la référence à des valeurs générales :
1) permet certes au dominé de « traiter » psychologiquement la situation de façon supportable, en la déplaçant : plutôt que de s’épuiser en démarches et récriminations effectivement humiliantes pour la femme, on déclare que l’individu en question ne vous est plus rien, ce qui est faux :
2) mais obscurcit la réalité de la situation de dépendance. L’autonomie de l’individu homme est en effet réelle — puisque dans les sociétés modernes où le contrôle communautaire et familial est devenu de plus en plus lâche et où les tribunaux ne sont guère favorables aux femmes — le père a effectivement toute possibilité matérielle de fuir ses obligations (bénéfice financier). L’autonomie de la mère consiste à ne pas pouvoir renouveler les vêtements et chaussures de ses enfants (ce qui était le cas) ce dont elle avait « honte ». Même la dignité se colore de honte…
Étant donné qu’une valeur est invoquée en situation, expérimentée dans une situation concrète, si elle apparaît dans un contexte d’oppression, un rapport effectif de pouvoir, la valeur prétendument générale et commune aux deux parties n’aura pas la même coloration dans la conscience (et, plus grave, dans l’inconscient) pour le dominant et le dominé, car les effets concrets qui accompagnent l’utilisation de cette valeur par le dominé sont des effets de limitation, de pauvreté matérielle et/fou de pauvreté mentale. La valeur étant objectivement limitée dans son application par la situation limitée et dépendante du sujet, elle devient viciée, et son utilisation ne fait qu’entraîner la confusion de la conscience.
À la limite, l’utilisation même de cette valeur de référence par le dominé comme si il accédait par là à la généralité le prive — par l’effet d’une fausse symétrie — d’avoir accès à la notion même de son oppression. Donc croire qu’il utilise les « mêmes » valeurs que le dominant est une mystification dans l’esprit du dominé, tout comme parler de partage des valeurs ou des représentations est une mystification de la part du savant (cf. infra, III).
Je ne suis pas en train de dire ce que pensent beaucoup de femmes : que les dominé(e)s devraient abandonner les valeurs « générales » (dites « mâles ») pour des valeurs « spécifiques-dominés ». C’est aussi en s’appuyant sur des valeurs « générales » (c’est-à-dire forgées à partir de la situation du dominant — et servant donc au mieux, dans chaque culture, l’expression de la notion de « personne », de la notion d’humanité) que des dominés ont tenté de, ou se sont libérés. Mais ce n’est pas du tout la même chose de reprendre une notion générale à son bénéfice après avoir compris qu’elle vous desservait que de l’utiliser avant — auquel cas elle n’est qu’un instrument de mystification.
Je ne dis pas non plus que toutes les valeurs ou représentations « générales » d’une société soient bonnes à réutiliser par le dominé… Certaines de ces valeurs sont justement des valeurs de domination, ou, plus subtilement, des valeurs servant structurellement à la domination. Ainsi en est-il de la canalisation vers le mariage et la production d’enfants (cf. dans L’ Arraisonnement des femmes, les articles de O. Journet, N. Echard et P. Tabet) par le biais de l’obligation à l’hétérosexualité — et donc la répression de l’homosexualité.
Pour distinguer une valeur de domination (par rapport au groupe dominé en question) d’une valeur qui pourrait devenir « de libération » (qui pourrait — après prise de conscience — être réutilisée à son profit par le dominé), il faut dans chaque société se demander à quel groupe elle s’applique principalement.
Dans la plupart des sociétés, la valeur « hétérosexualité-mariage-enfants » s’applique bien sûr en apparence à tous, hommes et femmes : pour la reproduction-continuité biologique du groupe et la dite « reproduction sociale », pour que vos enfants accomplissent les rites funéraires, qu’ils vous apportent un soutien économique, pour établir l’alliance entre les groupes, etc. Ce ne sont pas les « raisons » qui manquent. Mais les modalités différentes que prend cette canalisation pour les hommes et pour les femmes sont très importantes. Il semble bien que dans nombre de sociétés, les hommes disposent de marges dont les femmes sont exclues. Par exemple, les femmes sont contraintes au mariage à un âge plus précoce que les hommes ; ceux-ci peuvent rester plus longtemps célibataires (cf. Echard .1985), et même parfois une partie des hommes (et eux seulement) peuvent rester définitivement célibataires (cf. par exemple R.M. Glasse 1974).
Enfin (une recherche est à entreprendre sur le sujet) il semble bien que les hommes ont davantage la possibilité que les femmes d’avoir des relations homosexuelles. Il est déjà connu que ce sont des sociétés à violente domination masculine qui ont poussé la logique de la « suppression » (comme on dit en anglais) des femmes jusqu’à l’institutionnalisation quasi permanente (du moins très longue), rituelle (et donc obligatoire), de l’homosexualité masculine (ceci est bien démontré par Godelier (1982) pour les Baruya de Nouvelle-Guinée, un exemple parmi d’autres). Sous des formes moins ritualisées, on connait aussi les relations sexualisées (sinon sexuelles…) entre beaux-frères par exemple (pour les Indiens d’Amérique du Sud, cf. entre autres Hugh-Jones 1979) et plus généralement entre hommes dans nombre de sociétés (voir la culture virile du sport chez nous ou le comportement de certains groupes nazis). Tout ceci s’accompagnant souvent d’une surenchère sur la valeur « hetéro-sexualité »… ce qui pourrait apparaître comme une contradiction, mais n’en est pas une, pour les hommes.
C’est que, dans la mesure où on a réussi à soumettre totalement les femmes à la reproduction, l’homosexualité masculine peut être structurellement homogène avec le pouvoir des hommes sur les femmes et n’est donc pas forcément contradictoire avec une hétérosexualité reproductive masculine. Par contre, l’homosexualité féminine, dans la mesure où elle exprime un refus du pouvoir des hommes, de l’utilisation des femmes aux seules fins du gouvernement des hommes (ce qui n’est pas toujours le cas : elle peut n’être que le résultat contingent d’un enfermement des femmes par les hommes, ce qui la rend alors in-importante sur le plan social), est évidemment plus dangereuse.
Si donc, dans une société donnée, on peut montrer que d’une part les femmes sont davantage, plus tôt, plus longtemps, contraintes au mariage, à la reproduction et à l’hétérosexualité en général que les hommes, et que d’autre part l’homosexualité est davantage réprimée chez elles, on se trouve devant une valeur de domination qui ne s’applique en fait vraiment qu’au dominé. C’est en réalité une valeur spécifique-dominé. S’y référer comme valeur « générale » est l’expression de la mystification du dominé, et non de son « consentement à la domination », puisque il ne sait pas, il n’a pas les moyens de savoir, que ce n’est pas une valeur générale. Cela lui est caché.
Du « partage » des connaissances
Des connaissances en général
Rappelons pour mémoire que dans nombre de sociétés, outre les valeurs, une grande part des connaissances sont également cachées aux femmes, parce que leur mise en pratique et les positions sociales qui la permettraient sont interdites. Il s’agit des connaissances techniques qui assurent la maîtrise du fonctionnement social, de l’organisation de la production et des échanges avec l’extérieur, des moyens autonomes de défense individuelle et collective, etc.
Paola Tabet (1979) a bien montré — à partir d’un nombre considérable de sociétés, y compris des sociétés (dites par certains « égalitaires ») de chasseurs-cueilleurs — le gap technologique constant entre hommes et femmes comme expression des rapports de production entre les sexes : « …le monopole de certaines activités clés est nécessaire aux hommes pour s’assurer le contrôle des instruments de production et, finalement, l’utilisation globale des femmes » (p. 14), pour permettre « une appropriation aussi totale des femmes, une telle utilisation dans le travail, la sexualité, la reproduction de l’espèce » (p. 50).
Concernant l’exclusion des femmes des moyens matériels et « matériels surnaturels » du contrôle de la reproduction de la société chez les Baruya de Nouvelle-Guinée, voir Godelier (1982 59-60) :
« En résumé, chez les Baruya, la domination des hommes sur les femmes nous semble établie sur les fondements suivants :
— les femmes sont exclues de la propriété de la terre, mais non de son usage ;
— les femmes sont exclues de la propriété et de l’usage des outils les plus efficaces pour défricher la forêt ;
— les femmes sont exclues de la propriété et de l’usage des armes, des moyens de destruction, donc de la chasse, de la guerre et du recours à la violence armée ;
— les femmes sont exclues de la fabrication du sel et de l’organisation des échanges commerciaux avec les tribus étrangères. Elles dépendent des hommes pour obtenir des barres de sel dont, cependant, elles disposent ensuite à leur gré pour acheter vêtements, parures, etc. ;
— les femmes sont exclues de la propriété et de l’usage des objets sacrés, c’est-à-dire des moyens matériels surnaturels de contrôler la reproduction de la force et de la vie sociale ;
— enfin, les femmes occupent dans le procès de production des rapports de parenté (qui constituent en même temps les conditions de reproduction des groupes sociaux qui composent la société baruya) une place subordonnée aux hommes ; qui les échangent entre eux et entre les groupes qu’ils représentent. »
Notons tout de suite que l’auteur conclut ailleurs que si les femmes baruya sont opprimées, elles ne sont pas exploitées — ce qui permet à son sens de réfuter la notion de « classe de sexe », utilisée dans certains écrits féministes pour les sociétés occidentales (non cités par Godelier ; cf. par exemple Guillaumin 1978). Sans aborder ici ce débat, remarquons que le terme « usage » dans la citation ci-dessus évite de dire au bénéfice de qui les femmes « usent » (ou n’usent pas) de la terre, des outils, etc. Le serf et l’esclave usaient aussi de la terre, mais encore ?…
Quant à la connaissance, d’une part lorsqu’on est exclu d’une activité et que donc on ne la pratique pas, on ne la « connaît » pas, nous allons revenir infra sur ce point. D’autre part, bien que les non-connaissances impliquées par les non-activités évoquées ci-dessus ne portent pas directement sur les rapports hommes/femmes, elles sont basées sur l’idéologie des sexes de ces sociétés et permettent le maintien des conditions concrètes de la domination.
Enfin, il existe aussi pour les femmes des non-connaissances pour des activités… qu’elles pratiquent. Voir Bisilliat & Fiéloux (1983 : 95) à propos de la surexploitation féroce des femmes travailleuses du tiers-monde, exclues du minimum de connaissances syndicales (que des hommes commencent à acquérir), où les maintient la conjonction des pouvoirs capitaliste et patriarcal :
« Leur ignorance est devenue facteur de production.
Le travail pour les femmes est, plus que pour les hommes, une pratique aliénante puisque la notion d’aliénation leur est et leur reste invisible. La mise à l’écart des fermes de ce champ de conscience est le fait du monde capitaliste mais elle est aussi exigée par les diverses traditions de leurs pères et de leurs époux » (mes italiques).
Des connaissances sur les rapports de sexe
Mais, m’objectera-t-on, l’argument du consentement des dominées est fondé sur l’idée d’un partage des représentations sur les sexes, légitimantes du pouvoir masculin. Soit. Mais, là non plus (et peut-être surtout en ce domaine), les femmes ne savent pas tout (et, là aussi, une « connaissance » ne peut pas être dissociée de sa mise ou non — en pratique).
Chez les Baruya, par exemple, les femmes n’ont jamais connaissance de la version ésotérique du mythe principal sur l’organisation du monde et la production de la vie, où finalement les humains ont été créés sans principe féminin (réappropriation, comme le dit Godelier, des capacités procréatives des femmes). Dans cette version, connue seulement des hommes les plus importants sur le plan spirituel : chamanes et maîtres des rituels, tout se passe entre principes masculins : le Soleil, masculin, et son frère cadet, la Lune.
Les femmes ont donc accès à la version exotérique, où un principe féminin aurait fait partie de l’ordre cosmologique initial (encore que, bien sûr, à titre subordonné) : Lune y est l’épouse de Soleil. Mais, alors que la simple qualité d’homme permet en principe l’accès à la connaissance supérieure de la société, ce sont bien les femmes en tant que telles qui en sont exclues, d’autant que les femmes chamanes ne semblent pas non plus y parvenir. En effet, celles-ci ne sont que des chamanes inférieurs ; elles ne peuvent introniser chamane d’autres femmes — encore un exemple de médiatisation : seuls les hommes chamanes peuvent les initier (cf. Godelier 1982 : 190-198) ; elles ne traitent pas les mêmes maladies que les hommes, etc.
Mais passons à une pratique fondée symboliquement, dont Godelier dit, fort justement à mon sens, qu’on peut à la fois l’interpréter comme une tentative de la part des femmes de « croître » sans les hommes, mais qu’elle ne semble toutefois pas autonome par rapport à eux : le fait que les femmes baruya échangent entre elles leur lait (et particulièrement en donnent, semble-t-il, à boire aux jeunes initiées), tout comme, entre jeunes hommes non mariés (et non parents en ligne paternelle ou maternelle), les alliés donnent à boire leur sperme aux cadets, dans la maison des hommes. Or l’époux donne aussi à boire son sperme à l’épouse pour la fortifier, dans certaines circonstances (notamment après ses règles ou un accouchement), et :
« Selon [les hommes baruya], une femme n’a du lait et de beaux seins que lorsque son jeune époux l’a nourrie en abondance de son sperme. Pour un Baruya, le lait de son épouse n’est donc que son sperme, transformé en substance nourricière pour l’enfant ; en donnant son lait à boire aux jeunes filles sur le point de se marier, l’épouse ne fait qu’anticiper sur ce que leur feront les jeunes mariés qui, eux aussi, les fortifieront de leur sperme. C’est donc dans la mesure même où les femmes partagent plus ou moins pleinement l’idéologie selon laquelle tout vient directement ou indirectement des hommes, qu’elles verront dans l’échange généralisé du lait, entre générations de femmes, la preuve qu’elles sont véritablement aussi inférieures aux hommes que ceux-ci le désirent et l’affirment, ou, au contraire, la preuve qu’elles le sont beaucoup moins, même si elles ne peuvent l’admettre publiquement. II y a dans cette possibilité d’interprétation distincte pour chaque sexe des mêmes représentations, un lieu où peuvent s’exprimer, se faire jour les tensions, les oppositions qu’entraîne inévitablement la domination d’une partie de la société sur l’autre, ici d’un sexe sur l’autre. Ce n’est donc pas véritablement un contre-modèle féminin qui apparaît ici, des idées distinctes des idées officielles plaidant pour une société autre, débarrassée de cette oppression, c’est une manière différente, en partie opposée mais en partie seulement, d’éclairer les mêmes idées et de vivre la même pratique » (Godelier 1982 : 98-99 ; mes italiques).
Pour moi, et au risque d’apparaître simpliste par rapport aux précautions de l’auteur, s’il y a « interprétation distincte » il n’y a pas « mêmes représentations » (voir l’interprétation du rêve par les femmes gusii) ; s’il y a « manière différente d’éclairer » il n’y a pas « mêmes idées ». La référence à, l’utilisation de mêmes notions (ou valeurs, cf. supra), par exemple ici la transmission de substances vitales, sperme et peut-être lait, ne veut pas dire partage de l’idéologie, laquelle consiste en l’agencement des notions avec d’autres. Autant dire que chez nous la gauche partage (plus ou moins pleinement ?) l’idéologie de la droite sous prétexte que les deux se réfèrent aux notions de « liberté(s) » ou de « loi(s) »40.
S’il y a chez les femmes baruya (mais y a-t-il ? cela ne nous est affirmé que pour les hommes) référence à l’idée du sperme comme force vitale fondatrice de l’ordre social, j’appelle à nouveau cela médiatisation de la conscience des femmes, et non partage d’une même idéologie — d’autant que l’auteur nous apprend par ailleurs qu’une grande part des idées des hommes sur le sperme est cachée aux femmes, et ce, non seulement dans les rites secrets des hommes (où des pratiques symboliques visent à fermer le sexe des femmes après l’intromission du sperme) mais aussi dans le fait que, si les chants publics des femmes sur le thème du sperme s’arrêtent au moment où tout un groupe de jeunes filles a épuisé un homme au cours d’une nuit, la fin de l’histoire qu’ont trouvée les hommes, et qui n’est pas chantée devant les femmes, raconte comment les hommes lui firent retrouver sa force (pp. 249-250).
Quant à la relation entre « connaissance » et pratique, nous allons y revenir à travers un autre argument sur les connaissances des femmes employé par des ethnologues, et où les « vieilles » femmes sont d’ailleurs à nouveau mises en scène. Il est assez fréquent de lire que finalement les femmes — surtout âgées — connaissent à peu près tout des prétendus secrets des hommes (sous-entendu : il ne faut donc pas « exagérer » la domination masculine) — et inversement.
Le problème est déjà dans l’« à peu près » et le « inversement ». On établit par là une fausse symétrie, qui ne correspond pas à la réalité. Tout d’abord, que les hommes, jeunes ou âgés, connaissent presque tout, un peu, ou pas du tout (selon les sociétés) les « secrets » des femmes n’a quasiment aucune importance s’ils ont le pouvoir économique et politique. En revanche, que les femmes — les dominées — connaissent « presque tout » (?) mais pas tout des secrets des hommes, c’est-à-dire qu’il y ait disjonction entre leurs connaissances et la connaissance qui justifie le pouvoir des hommes, est l’expression d’une parfaite conjonction, cohérence, dans l’organisation de ce pouvoir.
Mais encore, à supposer que dans telle société, les femmes « sachent » effectivement les secrets des hommes, la question de la « connaissance » n’en est pas résolue pour autant.
Stephen Hugh-Jones (1979) discute de la question des « connaissances » féminines pour les Barasarta chez qui il a travaillé, en faisant aussi référence à d’autres sociétés où les initiations masculines comportent des rites secrets dont les femmes ne doivent pas voir les instruments (destinés à les effrayer et à affirmer la suprématie des hommes). Selon lui, les interprétations courantes reposent sur le fait que ces rites ont été décrits par des ethnographes hommes « qui ont accordé peu ou pas d’attention au rôle joué par les femmes » (mes italiques) :
« Lorsqu’on a des informations sur cet aspect, il apparaît fréquemment que l’ignorance féminine est une fiction maintenue par les deux sexes [italiques de l’auteur] et que les femmes, souvent, sont de connivence et collaborent avec les hommes. Selon mon épouse qui est restée avec les femmes pendant les rites He […], les jeunes femmes barasana sont certes effrayées par les instruments du He […] Mais cette peur est activement induite par une sorte de fausse hystérie (mock hysteria) des femmes plus âgées […] En fait, la plupart des femmes barasana connaissent en détail à quoi ressemble le He et savent plus ou moins exactement ce qui se passe de l’autre côté de l’écran de palmes qui les sépare des hommes pendant les rites, au point même de pouvoir dire quels instruments ayant tel nom sont joués par quels individus. Les femmes disent qu’elles ont peur non pas tant de voir elles-mêmes le He que des réactions des hommes si elles le faisaient. Elles ne manifestent non plus aucune envie de voir les instruments même si elles le pouvaient, réaction dont on retrouve l’écho dans le fait que, lorsque des missionnaires ont expliqué le Yurupary à des femmes ; ailleurs dans le Vaupés, dans le cadre d’une campagne contre « l’adoration du démon », ces femmes tentèrent de refuser de voir les instruments » (pis. 129-130 ; mes italiques).
Notons tout d’abord que — a fortiori s’agissant de rites, et non plus seulement de connaissances techniques, que nous évoquions plus haut — la connaissance « intellectuelle » n’est rien sans la participation, c’est-à-dire la pratique. L’exclusion de fait des femmes (leur « rôle » étant celui d’auditrices disjointes) du rite importe plus que leur « savoir ». La disjonction des femmes, essentielle pour l’efficacité du rite contre elles, est donc affaiblie par l’argumentation de l’auteur dans la première partie de la citation.
D’autre part, dans la seconde partie, c’est une conjonction, tout aussi essentielle en ce qui concerne la conscience dominée des femmes, qui est affaiblie : celle de la peur et de l’exclusion, de la peur et de la non-visibilité. Certes, la peur de voir les instruments est, comme le dit l’auteur, consciemment associée par elles surtout à l’éventuelle répression des hommes. Mais (et en conséquence) la peur est pour les femmes indissolublement liée à la représentation des instruments interdits.
Dans le fait que, même lorsque les missionnaires leur ont « expliqué », les femmes refusèrent quand même de voir les instruments, l’ethnographe voit la preuve d’une « non-envie », disons d’un inintérêt des femmes antérieur (puisqu’elles « savaient » déjà). Il y a là une méconnaissance de la part de l’ethnographe homme de ce que peut être la structuration de la personnalité des opprimé(e)s par la peur :
1) elle « brouille » en fait la « connaissance » de l’objet de peur ;
2) elle empêche de réagir « logiquement » (ou adéquatement en cas d’attaque) à la confrontation avec la réalité de l’objet.
Ce n’est pas que la « connaissance » ne change rien à la peur, c’est que la peur engendre l’in-connaissance.
(Ajoutons et ce n’est pas un détail — qu’il ne nous est pas dit qu’au moment de la « révélation » des instruments, les femmes en question auraient été séparées de leur société, donc des hommes et de la répression éventuelle…)
On trouve assez fréquemment cet argument de la « non-envie », de l’ « inintérêt » des femmes pour les rites masculins dans les sociétés à forte domination masculine, et de fait, les femmes peuvent s’exprimer ainsi (cf. par exemple Murphy & Murphy 1974 : 140, pour les indiennes mundurucii de l’Amazonie brésilienne). Dans nos sociétés aussi, des femmes vont facilement dire qu’elles n’ont pas envie de sortir seules le soir pour aller au cinéma, par exemple, ou qu’elles n’ont aucun intérêt pour les productions (écrites ou filmées) pornographiques.
En fait, elles ont peur de réalités dont elles savent confusément (et pas toujours si confusément) qu’il s’agit là de situations objectives d’interdit et de danger pour elles, et d’expressions du pouvoir des hommes contre elles — ce qu’elles tentent de supprimer sous couvert d’une décision personnelle. Ou collective : Murphy et Murphy insistent dans leur livre sur la solidarité de groupe des femmes mundurucù (favorisée par la matrilocalité dans cette société patrilinéaire fortement viriarcale — conjonction statistiquement très rare). Mais on peut voir aussi que cette solidarité féminine même est médiatisée et conditionnée par la peur des hommes (une femme qui s’éloignerait seule du village est considérée par les hommes comme disponible au viol, si j’ose dire, et dans un passé proche toute infraction grave d’une femme était sanctionnée par le viol collectif).
Il est aussi souvent noté par des ethnologues que les femmes se moquent entre elles des rites secrets, ou des comportements, des hommes. (Soulignons déjà le « entre elles » ; il n’est pas indifférent que dans ces sociétés elles ne s’y risquent pas devant les hommes ; la punition serait immédiate, d’autant qu’elle existe déjà parfois en cas d’atteinte involontaire de la femme à la dignité masculine (cf. Godelier 1982 : 237). Mais chez nous aussi, se moquer des hommes, ou faire une remarque négative sur le comportement d’un homme dans la rue par exemple, est risqué physiquement.) Cette mention des moqueries féminines tend parfois aussi à induire que l’existence de cérémonies ou de pratiques jalousement (furieusement même) interdites aux femmes est considérée par elles comme peu importante. Une grande partie de l’humour juif porte pourtant sur le constat de l’oppression… Et, dans un autre registre, qui nierait que rien n’est plus significatif de l’impuissance, de l’angoisse et de la peur que les ricanements « en dessous » des enfants… et des jeunes filles.
Certes, certaines sociétés ont des cérémonies publiques où les femmes se moquent devant les hommes des prétentions masculines (cf. par exemple, pour les Rukuba du Nigeria, Muller 1981). ll serait intéressant d’ailleurs d’étudier comparativement à quels types de rapports entre les sexes cela peut correspondre, et en tout cas s’il ne s’agit pas là de sociétés où la répression des femmes est moins évidemment violente. Mais il est bien connu que les formes de charivari, où la hiérarchie sociale est rituellement inversée de temps en temps, ne font que la réaffirmer. Aussi, parler de « M.L.F. » (même qualifié d’« ancien ») à ce propos est une plaisanterie douteuse, car l’un des problèmes qui se posent est bien de la rupture (et non de la continuité) entre conscience de groupe de sexe et conscience de classe de sexe, la première pouvant empêcher la seconde…
Du « consentement » des dominé(e)s ?
— C’est quoi, pour vous, l’homme idéal ? :
— Qu’il ait quand même le dessus sur moi…
— Qu’il vous brime un peu ?
— Ah non !
(Interview d’une femme (Tresgot 1983))
My poverty but not my will consents.41
Violence et consentement, les deux mamelles d’un faux problème
« …des deux composantes du pouvoir la force la plus forte n’est pas la violence des dominants mais le consentement de dominés à leur domination. Pour mettre et maintenir « au pouvoir », c’est-à-dire au-dessus et au centre de la société une partie de la société, les hommes par rapport aux femmes, un ordre, une caste ou une classe par rapport à d’autres ordres, castes ou classes, la répression fait moins que l’adhésion, la violence physique et psychologique moins que la conviction de la pensée qui entraîne avec elle l’adhésion de la volonté, l’acceptation sinon la » coopération » des dominés » (Godelier 1978 c 176 ; italiques de l’auteur).
« Qu’on nous entende bien et qu’on ne nous cherche pas querelles imbéciles ou de mauvaise foi. » Cette suite immédiate de la citation précédente peut certes être lue comme la crainte exagérée d’un auteur d’être mal compris et qui va apporter des « nuances ».
Mais à qui s’adresse-t-elle ? Forcément aux dominé(e)s… Et sur quel ton ? Celui de la menace. La dominée qui lit cela, et dont l’esprit avait en effet commencé à formuler quelque interrogation sur les propositions précédentes, doit maintenant lire : tu te trompes, tu ne sais pas lire. Culpabilisation. Pardon ! je n’aurais pas dû… Si je conteste, peut-être suis-je une imbécile ? Confusion. Trouble résultant de l’humiliation, et désarroi des idées. Avant de passer à d’autres arguments, je tenais à souligner qu’on ne saurait parler pour le dominé de « conviction de la pensée » (ce qui suppose un esprit clair) mais de confusion — où le maintient le dominant. Peut-être un âne saurait-il dire que la carotte dont il sait, même confusément !, qu’elle lui évite le bâton (à laquelle, donc, il « adhère ») n’est pas une carotte-en-soi, une carotte à vrai goût de carotte, à champ sémantique de simple carotte telle que son maître se la représente ? Le maître croit et dit que l’âne aime la carotte, mais l’âne ne possède pas de représentation d’une carotte sans bâton, contrairement à son maitre (il ne partage donc pas « les mêmes » représentations). L’âne consent, tout en espérant la carotte, à ne pas être battu. On pourrait tout aussi bien appeler cela « refus » que « consentement ».
Certes, Godelier précise que :
« violence et consentement ne sont pas, dans leur fond, des réalités mutuellement exclusives », et que « même le pouvoir de domination le moins contesté, le plus profondément accepté, contient toujours la menace virtuelle de recourir à la violence dès que le consentement faiblit ou fait place au refus, voire à la résistance. Il n’y a pas de domination sans violence, même si celle-ci se borne à rester à l’horizon » (1978 c :177).
Il faudrait alors se demander ce qu’est la répression et ce qu’est la violence. Il semble bien qu’ici l’auteur utilise une conception de la « violence » typiquement dominante, masculine pour le cas qui nous occupe. J’entends par conception dominante de la violence, une conception de la violence entre dominants, ici entre hommes, c’est-à-dire entre égaux.
Or, la violence contre le dominé ne s’exerce pas seulement dès que « le consentement faiblit », elle est avant, et partout, et quotidienne, dès que dans l’esprit du dominant le dominé, même sans en avoir conscience, même sans l’avoir « voulu », n’est plus à sa place. Or le dominé n’est jamais a sa place, elle doit lui être rappelée en permanence : c’est le contrôle social (cf, Hanmer 1977 ; Whitehead 1978).
Certes, dans la Production des Grands Hommes (1982) en particulier, l’auteur prend en compte les violences psychologiques et sociales faites aux femmes, outre la violence « idéelle » et idéologique :
« Au cœur de la pensée et des pratiques symboliques des Baruya existe et se reproduit en permanence une formidable violence idéelle et idéologique dirigée contre les femmes.
Violence commise dans la pensée et par la pensée, mais qui se joint à d’autres violences moins idéelles, à des violences physiques, à des humiliations, des insultes et autres violences psychologiques, à des violences sociales aussi, comme celles qui consistent à forcer une femme à épouser un homme dont elle ne veut pas, ou à la séparer de ses fils. Or, toutes ces formes de violence factuelle ne surgissent que de loin en loin dans la vie d’une femme, à l’occasion de disputes entre époux ou des initiations masculines. Et ce n’est pas la même chose que de s’opposer à un mari pour des raisons particulières ou de consentir à se séparer de son fils dans l’intérêt général. La violence idéelle, en revanche, existe en permanence au cœur même de toute l’organisation sociale des Baruya, dans chaque aspect de leur pratique ; elle est d’autant plus efficace que, en même temps que ces idées naissent, elles produisent aussi leur propre légitimation et justifient toutes les autres formes de violence physique, psychologique, etc., qui débordent la pensée mais reviennent sans cesse s’appuyer sur elle pour se faire reconnaître comme fondées dans « l’ordre » même des choses. Car la force la plus forte des hommes n’est pas dans. l’exercice de la violence, mais dans le consentement des femmes à leur domination, et ce consentement ne peut exister sans qu’il y ait partage par les deux sexes des mêmes représentations, qui légitiment la domination masculine » (Godelier 1982 : 232 ; mes italiques).
Je dirai le contraire : la violence « idéelle », celle des idées légitimant la domination, n’est pas présente en permanence dans la conscience des femmes (dans l’esprit du dominant, oui). Pour la dominée, c’est la violence dite ici factuelle qui est permanente42.
Premièrement, il est inexact de dire (citation précédente) que les formes de violence factuelle n’apparaissent que « de loin en loin » dans la vie des femmes. Comme on le voit d’ailleurs dans le passage cité plus bas, et nous en avons évoqué bien d’autres au cours de cet article, nombreuses et quotidiennes sont les limitations imposées aux femmes, qui sont tout à fait « factuelles ». Deuxièmement, nous allons voir que le problème est finalement la manière dont l’auteur se représente l’action de la violence idéelle (celle des mythes et représentations) sur la vie quotidienne des femmes.
« Ces mythes disent non seulement la violence masculine mais ils constituent en eux-mêmes des actes de violence réelle, violence idéologique et symbolique certes, mais qui déborde de toutes parts la sphère de la pensée, ou du moins qui l’accompagne partout, puisque cette pensée est à l’œuvre non seulement dans les pratiques symboliques des rituels d’initiation, mais aussi dans les multiples détails de la vie quotidienne. Elle est dans le chemin qui serpente en contrebas de celui des hommes, elle est dans la manière de s’accroupir pour se déplacer dans sa maison, elle est dans l’habitude de ne jamais fixer un homme dans les yeux lorsqu’on lui parle, elle est dans le réflexe de s’effacer pour laisser passer, ou dans l’habitude de servir les hommes en premier, gestes quotidiens et de tous les instants qui sont à la fois des signes de la domination masculine et des moyens de produire et de reproduire la soumission des femmes. Pensées devenues gestes, actions, idées devenues réflexes du corps et ayant ajouté à la force de leur évidence celle de la tradition et de l’habitude, tous ces actes de la vie quotidienne renferment un noyau de violence idéologique et de violence symbolique qui agit en permanence sur l’individu, sur tous les individus, à la fois sur leur conscience, dans leur conscience et au-delà. C’est en cela que le pouvoir des idées se distingue de tous les actes visibles de violence directe, physique, psychologique, sociale que les hommes exercent de temps à autre sur une femme, ou sur plusieurs, ou sur toutes, quand il leur est nécessaire d’imposer leur volonté. La force des idées est dans leur partage, dans la croyance et la confiance en la valeur de vérité des interprétations du réel qu’elles proposent. C’est tout cela que l’on trouve en acte dans la mythologie baruya » (Godelier 1982 : 110-111 ; mes italiques).
« Pensées devenues gestes, actions, idées devenues réflexes du corps »… Ce processus, à mon sens, ne s’applique qu’au dominant. Il est sans doute vrai du vécu majoritaire, obsédé de sa légitimité. Pour l’opprimé(e), s’il existe, certes, « un noyau de violence idéologique et symbolique » dans les actes de sa vie quotidienne, il n’est pas lié fondamentalement au pouvoir de ses idées (ce qu’implique la notion du « partage » des représentations), il est dû d’abord au réflexe… de Pavlov. Ce ne sont pas les idées de l’opprimé(e) qui deviennent réflexes du corps. Ce sont les réflexes matériels, imposés et pratiqués dès l’enfance pour les femmes (bien « avant les initiations »), ce sont les ordres de servir médiatisant l’idéologie, c’est le dressage lui-même que (peut-être) elle « raccordera » (et mal, dans la contradiction) plus tard avec certaines fractions de l’idéologie du sexe (de la classe, etc.) dominant. D’abord, on empêche la fille par exemple de courir, d’abord on lui fait servir son père, ses frères (ou même son futur mari, cf. supra, note 34), ensuite elle constatera : les hommes peuvent courir, doivent être servis. Un constat. Un constat forcé n’est pas un consensus.
On ne peut faire si aisément le passage entre le fait sociologique que les idées de la classe (du sexe, etc.) dominante sont les idées dominantes, et l’explication — psychologique — que ces idées sont celles qui gouvernent la conscience du dominé. Et surtout, on ne doit pas « glisser » de la psychologie de l’oppresseur à celle de l’opprimé. Je ne pense pas que ce soit l’idée des « services » que leur rendent les dominants (Codelier 1978 c et ailleurs) qui soit principalement présente à la conscience des femmes, mais l’envahissement de leur corps et de leur conscience par l’interposition, par la présence physique et mentale constante et contraignante des hommes qui les fait céder.
Comment alors parler de consentement comme force principale de la domination, surtout dans des sociétés telles que les Baruya, ou d’autres que nous avons évoquées ? Notons d’ailleurs que des témoignages d’ethnologues contredisent absolument cette position. Selon J. Lizot (communication personnelle), chez les Yanornami les femmes savent qu’elles sont dominées, et n’y consentent pas. De même pour les Mundurucù patrilinéaires et matrilocaux, Yolanda et Robert Murphy (1974 : 137 et 139), parlant de l’antagonisme ouvert entre les sexes, « ritualisé par les hommes et verbalisé par les femmes », soulignent que :
« … les femmes mundurucù ne sont pas serviles envers les hommes, ni concrètement, ni symboliquement. Les hommes sont considérés comme exploiteurs et dominants ; pas comme supérieurs. Nous n’avons jamais entendu une femme dire que son absence de connaissance sur telle ou telle chose était due au fait qu’elle « n’était qu’une femme » ; elles ne parlaient pas non plus du fait que les hommes ont une position supérieure de la manière dont une femme américaine dira, souvent hypocritement : » Chez nous, c’est mon mari qui porte la culotte. » »
La violence physique et la contrainte matérielle et mentale sont un coin enfoncé dans la conscience. Une blessure de l’esprit. Après, si les coups ou les viols ne sont plus nécessaires à chaque instant, ce n’est pas que les femmes « consentent » — et il importe moins, et non pas plus que la violence et la contrainte physiques et mentales, que les femmes « partagent » ou non les représentations légitimantes du pouvoir masculin (représentations qui de plus, nous l’avons vu, ne sont pas aussi complètes que celles des hommes).
En fait, ce qu’implique la notion de consentement est une vision de la politique au sens classique, le modèle du contrat, ou de la « représentativité », qu’il s’agisse de régimes autoritaires ou de démocraties.
Et certes, c’est le modèle sur lequel beaucoup de femmes dans nos sociétés se représentent leurs rapports aux hommes et à leur mari. Mais c’est qu’elles ne voient pas (on les empêche de voir) que ce n’est pas un contrat entre égaux. (Par exemple, elles croient se marier à un individu, et dans la plus parfaite complémentarité. Or, que les femmes comme groupe doivent être maintenues inférieures aux hommes et leur servir, les servir, les « male groups », comme dit Freeman, le savent et se le transmettent, chez nous comme ailleurs, et surtout parmi les jeunes.) Elles croient donc pouvoir conjoindre une délégation d’autorité et une liberté personnelle… Quel étonnement quand on leur en signale les conséquences et quelle évidente contradiction, comme le montre cette récente interview d’une femme française d’une trentaine d’années, donnée en exergue (Tresgot 1983) :
— C’est quoi, pour vous, l’homme idéal ?
— Qu’il ait quand même le dessus sur moi…
— Qu’il vous brime un peu. ?…
— Ah non !
Il apparaît que cette séparation (même « articulée ») entre violence et contrat (consentement) concernant les femmes est : 1° (androcentrisme) une idée de dominant dans les rapports de sexe de notre société : en fait on ne retient du comportement et du discours des femmes que, dirais-je, la première partie de l’assertion ci-dessus (« qu’il ait le dessus sur moi » — en oubliant d’ailleurs le « quand même ») ; et 2° (ethnocentrisme) permise par le fait que dans les sociétés occidentales modernes (d’où parle l’ethnologue), l’oppression des femmes est moins visible que dans d’autres, même aux yeux des hommes (et encore moins aux yeux des femmes). De nos jours, si on ne fait pas trop attention (par exemple à l’énorme gap économique entre hommes et femmes) et si on y ajoute une certaine dose de mauvaise foi, les femmes peuvent apparaître comme ayant une liberté de conscience et de comportement. Et d’ailleurs, des possibilités de marges leur sont (quoique avec ostracisme) laissées, comme le divorce définitif, le célibat ou le lesbianisme, et donc des possibilités de prise de conscience. Je ne pense pas non plus qu’on puisse parler de consentement pour les femmes de nos sociétés, mais que les mêmes structures (et les mêmes valeurs, individualistes) qui permettent leur mystification permettent aussi la résistance.
Remarquons qu’en général, dans les relations d’oppression, les membres de la fraction consciente des dominés, s’ils reconnaissent l’état de fait de la soumission, n’emploient guère le mot « consentement » pour expliquer ou décrire l’état de conscience non encore politisée du groupe auquel ils appartiennent. Je n’ai trouvé ce terme, appliqué aux femmes, que rarement dans la littérature théorique militante : par exemple Atkinson (1975 : 23) et encore avec précaution ; réticence aussi chez Collin (1978) qui parle de la « complicité » due aux « gratifications » de l’oppression. Le résumé que fait Césaire (1955 : 19-20) du rapport de colonisation s’applique tout aussi bien au vécu du rapport d’oppression hommes/ femmes :
« Entre colonisateur et colonisé, il n’y a de place que pour la corvée, l’intimidation, la pression, la police, l’impôt, le vol, le viol, les cultures obligatoires, le mépris, la méfiance, la morgue, la suffisance, la muflerie, des élites décérébrées, des masses avilies. »
D’autre part, les termes qu’il utilise pour les institutions seraient parfaitement adéquats pour décrire l’état de conscience des personnes dominées et notamment des femmes : (homme indigène) instrument de production, (colonisation =) chosification, (sociétés) vidées d’elles-mêmes, (cultures) piétinées, (institutions) minées, (terres) confisquées, (religions) assassinées, (magnificences artistiques) anéanties, (possibilités) supprimées. Et enfin :
« Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d’infériorité, le tremblement, l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme. »
On voit qu’il y a là plus de violences que de consentements… (Notons que le larbinisme n’implique pas forcément le consentement, et que le seul cas où Césaire parle de « complicité » concerne les tyrans locaux.)
Toujours pour la colonisation, Albert Memmi (1957 : 116-117) semble près d’adopter l’idée marxiste traditionnelle, qu’il rappelle, du consentement des classes dominées à l’idéologie légitimante de la classe dominante. Mais ce n’est pas non plus sans hésitation… L’oppression serait « bon gré, mal gré, tolérée par les opprimés eux-mêmes » ; le colonisé donnerait « son assentiment, troublé, partiel, mais indéniable » ; il y aurait « une certaine adhésion » du colonisé à la colonisation… (mes italiques). Et par ailleurs, Memmi décrit le colonisé comme « un être de carence » (pp. 147-154), il parle de déshumanisation, de pétrification (p. 135), de « décalage d’avec soi » (p. 182) ; le colonisé est « hors de jeu […] il n’est plus sujet de l’histoire […] il en subit le poids […] mais toujours comme objet » (p. 123), il est « brisé dans son développement, composant avec son écrasement » (p. 118), etc.
Quant aux effets psychiques du rapport d’esclavage (situation plus proche encore de celle des femmes, car les femmes — contrairement aux colonisés et moins encore que les premières générations d’esclaves américains — n’ont pas de culture antérieure à la situation d’oppression), F. Douglass (1980 : 69) constate :
« J’étais brisé dans mon corps, dans mon âme et dans mon esprit. Ma souplesse naturelle fut broyée, mon intelligence dépérit […] »
(Et n’oublions pas qu’aux femmes esclaves était imposé en plus, comme à toutes les femmes, le travail de la reproduction forcée — souvent sous forme de viol par des esclaves et par les maîtres.)
Il semble bien que les rapports d’oppression basés sur l’exploitation du travail et du corps se traduisent par une véritable anesthésie de la conscience inhérente aux limitations concrètes, matérielles et intellectuelles, imposées à l’opprimé(e), ce qui exclut qu’on puisse parler de consentement. Et au cas où la malade se réveillerait au cours de l’anesthésie (résistance), la violence qui lui est alors appliquée ne consiste pas seulement dans les coups, le mort ou les insultes : la violence principale de la situation d’oppression est qu’il n’existe pas de possibilités de fuite pour les femmes dans la majorité des sociétés, sinon pour retomber de Charybde en Scylla, du pouvoir d’un groupe d’hommes à un autre.
La violence principale de la domination consiste à limiter les possibilités, le rayon d’action et de pensée de l’opprimé(e) limiter la liberté du corps, limiter l’accès aux moyens autonomes et sophistiqués de production et de défense (« aux outils et aux armes », cf. Tabet 19179 ), aux connaissances, aux valeurs, aux représentations… y compris aux représentations de la domination.
Si l’on tient absolument à parler de « violence » et de « consentement », il faudra étendre — en ce qui concerne l’opprimé(e) — le champ sémantique du mot violence et restreindre celui de consentement au point que seul le mot violence doit être finalement retenu si l’on veut bien se souvenir du sens des réalités : « domination » et « oppression ». L’oppresseur est dans sa conscience un dominant, il respire sur ses hauteurs ; l’opprimé (l’oppressé) étouffe dans l’abaissement, et la bassesse, de l’oppression.
Si violence et consentement sont deux ingrédients de la domination, et si un consentement se produit d’autant plus sûrement que les « services » rendus par les dominants se situent dans le domaine des réalités invisibles, de l’imaginaire, comme le dit Godelier, je dirais qu’en effet, s’il faut parler de consentement à la domination, c’est de celui… des dominants. Les dominants possèdent, en plus des bénéfices concrets, et en provenant directement, le privilège de forger l’imaginaire du réel — où se déploie la légitimation de leur pouvoir. Le problème de la légitimité, donc de la légitimation du pouvoir, est typiquement le problème du dominant. Il lui faut une raison pour entamer et maintenir l’exercice de son pouvoir. La dominée, elle, est engluée dans le concret et sa part éventuelle (et toujours limitée) à la connaissance de et à la croyance en la « légitimité » de son oppression, si elle existe, n’est qu’une goutte d’eau (fade) dans l’océan de sa fatigue — dans la mer des contradictions qu’elle ne peut surmonter autrement qu’en n’en prenant, oserai-je dire, qu’une part à la fois : soit en se mettant totalement au service des autres (si ce n’est l’homme, ce sont les enfants, les fils, cf. Journet 1985 17-36) — ce qu’on lui demande « en tant que » femme ; soit en se tuant elle-même (voir les femmes gainj ou, dans nos sociétés, les dépressions nerveuses, les tentatives de suicide et l’anorexie mentale, qui sont davantage le fait des femmes).
L’oppresseur et l’opprimé(e) ne sont pas des sujets à consciences identiques, parce qu’ils sont en situations contraires. Faut-il rappeler une chose aussi simple que : ce n’est pas la même chose 1) d’utiliser une « idée », une représentation (par exemple les hommes sont supérieurs aux femmes) en réponse à une violence, pour s’expliquer une violence subie (j’ai eu tort de ne pas rester à ma place, qui après tout est celle de ma dignité de femme), et 2) d’utiliser la même idée pour exercer cette violence (elle va rester à place, oui ? sinon elle m’atteint dans ma dignité d’homme).
Certes, la part idéelle du réel doit, selon la proposition de M. Godelier (1978 c), être reconnue comme part efficiente des institutions sociales, et notamment de celles qui remplissent la fonction dominante de rapports de production. Mais cette part idéelle efficiente — s’agissant de la légitimité — est du côté de la Loi, du pouvoir ; on ne peut la projeter telle quelle dans la conscience de l’opprimé(e). Ce n’est pas, à mon sens, la « reconnaissance » par les opprimé(e)s de la légitimité du pouvoir et des bienfaits et services des dominants qui maintient principalement, « en plus de la violence », la situation de domination, mais bien plutôt la conscience contrainte et médiatisée et l’ignorance où sont maintenus les opprimé(e)s — ce qui est leur part réelle de l’idéel et constitue, avec les contraintes matérielles, la violence, force principale de la domination.
La fausse symétrie de la conscience
Ou : une course d’obstacles sans handicap ?
Comment brûler les étapes
Parler de consentement à la domination est très exactement sauter par-dessus l’obstacle du problème qu’on prétend poser : celui de la prise de conscience. Godelier parle dès l’abord de « consentement à la domination » pour décrire un état qui en fait précède la prise de conscience, puis il dit qu’il faudra se demander quelles sont les conditions qui rendraient possible une prise de conscience. Or, le concept de consentement, à supposer même qu’on l’accepte, ne saurait de toute façon référer qu’à cette étape ultérieure.
Pour pouvoir dire d’un sujet dominé qu’il consent à la domination, encore faudrait-il que ce sujet se soit déjà révélé à lui-même comme sujet dans ce rapport de domination, donc qu’il ait identifié ce rapport, et ait procédé à une reconversion de lui-même.
Il faut tout de même se rappeler que c’est justement chez les opprimé(e)s qu’existe la négation la plus forte de l’oppression — et négation n’est pas consentement. Négation qu’on peut trouver sous sa double forme de :
— déni (terme par lequel Laplanche et Pontalis (1967) traduisent la notion freudienne de Verleugnung : « refus de la perception d’un fait s’imposant dans le monde extérieur », p. 113). Nier une proposition qui vous est présentée sur la réalité, ici par exemple, le refus de la proposition « nous sommes opprimées » ;
— (dé)négation (expression proposée par Laplanche et Pontalis pour Verneinung) : refuser qu’une idée, un sentiment qui commence à émerger de l’inconscient (à ne plus être refoulé) ait un rapport avec votre moi. Ainsi, le malaise profond de l’opprimé(e) qui, s’il se transforme dans la conscience en contenu de la représentation « domination » ne lui permet pas pour autant de l’appliquer à soi-même43 :
« À l’aide de la négation, dit Freud, il n’y a qu’un des effets du processus de refoulement qu’on puisse faire rétrograder, celui qui veut que le contenu de la représentation n’atteigne pas la conscience. Il en résulte une sorte d’acceptation intellectuelle du refoulé, tandis que l’effet essentiel du refoulement persiste » (Freud 1934 : 174-175)44.
La (dé)négation par les opprimé(e)s de leur propre oppression n’a rien d’étonnant si l’on sait (mais pour le savoir il faut être de ce côté-ci de la barrière) qui il est tout à fait insupportable et traumatisant de se reconnaître opprimé(e). Pourquoi ? Parce que, dans le mouvement même où la personne voit son oppression, elle se constitue en nouveau sujet (sujet de l’oppression) et en juge de l’autre sujet : cet autre elle-même qu’elle croyait être avant. Il y a là un effet de dissociation qui peut être insurmontable.
C’est au moment, et au moment seulement, où non seulement l’idée de la domination ne sera plus refoulée, mais où la personne se sera admise partie du rapport de domination qu’elle serait en mesure de se dire éventuellement : « Mais comment ai-je pu consentir à cela ? », parce qu’elle s’envisage alors comme actrice d’une lutte à venir. (D’où les luttes parfois sanglantes entre fractions et factions politiques des groupes conscients d’opprimés : car être juge de soi, en cas de prise de conscience collective, est aussi être juge de ses co-opprimés…) Ce n’est donc qu’à partir de la prise de conscience (individuelle et collective) que le mot « consentement » — à supposer qu’il soit adéquat — pourrait être posé45.
Et si l’opprimée peut se poser cette question, c’est dans une tentative de surmonter cet effet de dissociation dont nous parlions. Pour surmonter aussi — en se posant en tant que sujet volontaire (volontariste) dans l’oppression — l’idée (la réalité) que c’est justement en tant que sujet non conscient de l’oppression qu’elle a subi cela, en tant que sujet agi, alors qu’elle se pensait actrice de sa vie. (À ceci se rattache la nécessité éprouvée par certaines femmes de trouver du pouvoir chez les femmes, parfois contre toute évidence, dans nos sociétés ou dans d’autres.)
Mais ce qui peut se comprendre chez l’opprimée, lorsqu’elle fait référence au consentement, comme une tentative de surmonter une dissociation, ne peut s’entendre chez l’« analyste », le savant dominant, que comme une tentative de nier, pour tout dire de supprimer cette même dissociation, à savoir l’état réel de la conscience aliénée, puisque la notion même de consentement implique là connaissance, la décision.
Si les opprimés « consentaient » à leur domination, on se demande bien pourquoi les premières fractions conscientes de la classe passent la majeure partie de leur temps et de leur énergie 1) à faire entre soi l’analyse de l’oppression, 2) à tenter de la révéler à leurs co-opprimés, que ce soit par la voie du discours politique ou par le biais de l’action violente. Autrement dit, si la conscience claire de la domination était déjà donnée, on se demande pourquoi existerait, et elle existe, l’étape nécessaire de la prise de conscience.
Mais, outre qu’un dominant est fort peu en mesure d’avoir ressenti ou de comprendre cela, s’ajoute sans doute une inconnaissance chez beaucoup d’ethnologues de toute une part de la sociologie politique constituée, écrite et pratiquée par les mouvements de minoritaires 1) de nos sociétés, 2) des sociétés contemporaines du second, du tiers ou même du quart monde. Et justement, par cette inconnaissance (cette dénégation ?) même, des ethnologues, hommes et femmes, pratiquent une « politique de la connaissance » et une politique concrète s’agissant des rapports de sexe dans d’autres sociétés, qui sont le produit des rapports de sexe dans la nôtre et de la place particulière que chacun y occupe, soit comme dominant (totalisant) soit comme dominée dénégatrice.
La symétrie réintroduite dans l’asymétrie
Pendant longtemps, une grande part de la pensée ethnologique — bien qu’ayant parfois décrit « l’inégalité » entre hommes et femmes — avait laissé tomber les femmes à la périphérie des explications des systèmes sociaux, estimant que l’étude des relations entre hommes présentait suffisamment le cœur des sociétés. Il n’y avait pas, à la limite, constitution des femmes en acteurs sociaux, et ceci a été critiqué notamment par des ethnologues féministes.
Mais depuis nous voyons surgir un autre courant de pensée qui, ayant saisi à la fois, et que la domination des hommes sur les femmes est un phénomène fondamental dans les rapports sociaux, et que les femmes sont des acteurs sociaux importants, les constitue en sujets… à conscience identique au dominant. Je vois là, appliqué aux antagonismes de sexe, un retour à une pensée hégélienne et un éloignement conséquent d’une analyse matérialiste de la conscience.
Godelier lui-même a dénoncé la confusion fréquente qui est faite, et souligné la distinction à faire, entre le principe de l’identité des contraires et celui de l’unité des contraires ; l’opération qui fonde selon lui l’opposition entre les dialectiques hégélienne et marxienne étant que, des deux principes présents chez Hegel, Marx n’a retenu que le second, l’unité des contraires :
« …le fondement scientifique de la logique dialectique n’est pas, selon nous, le principe de l’identité des contraires, mais celui de l’unité des contraires. Il est facile de démontrer que si le principe de l’identité des contraires implique a fortiori celui de l’unité des contraires, la réciproque n’est pas vraie […]. Des contraires peuvent être unis sans nécessairement être identiques. Pour Hegel le maitre est lui-même et son contraire, l’esclave. Pour Marx, le capitaliste ne peut exister sans l’ouvrier mais n’est pas l’ouvrier. Le principe de l’unité des contraires pose que des contraires, à la fois s’impliquent et s’excluent, c’est-à-dire qu’aucun ne peut prendre la place de l’autre sans se détruire comme tel, mais non qu’il soit identique à l’autre.
Quand on pose que chaque contraire s’oppose à soi parce qu’il est l’autre que soi, on pose l’identité de ces contraires et a fortiori leur unité. C’est parce que la thèse est déjà l’antithèse, donc se contredit elle-même, que thèse et antithèse contiennent a priori leur synthèse.
Il devient donc clair que, si l’on conçoit de façon matérialiste les rapports de l’être et de la pensée, on est amené à rejeter le principe de l’identité des contraires et de ce fait la dialectique de Hegel perd sa forme mystique et s’ampute de la partie de son contenu qui est directement au service de l’idéalisme absolu » (Godelier 1977, t. Il : 137-138 ; italiques de l’auteur).
N’y a-t-il pas, dans le postulat implicite de conscience identique entre dominants et dominé(e)s qui sous-tend la notion de consentement, ce que Godelier reproche à Hegel : une solution imaginaire, une opération magique, idéologique, au sein d’une dialectique simple46 ?
Certes la pensée idéaliste d’une symétrie entre dominants et dominés est le mieux représentée par un autre type de discours ethnologique (ou sociologique) : le fonctionnaliste classique, celui de la complémentarité des sexes. Là le pas est vite franchi de l’unité à l’identité, si bien qu’à la fin il reste à peine des contraires. Sous la formule de l’« égalité dans la différence » perce celle de l’identité dans la différence, les deux étant une négation du rapport de force concret. Cette problématique s’est d’ailleurs généralement contentée de décrire la dite « division » du travail entre les sexes, ou les « oppositions »… — symboliques sans trop se poser la question de ce que sont les femmes comme sujets.
Au contraire, dans le parti-pris de Godelier, raisonnant au niveau théorique (et malgré les données ethnographiques qu’il apporte) comme si les femmes étaient des sujets égaux aux hommes : à conscience identique aux hommes, on peut discerner l’attitude du dominant subtil qui est capable de reconnaître, et de décrire, la violence de la domination masculine. Mais, reconnaissant, au moins intellectuellement comme le dit Freud, la réalité de l’oppression des femmes, il la (dé)nie pourtant d’une certaine manière : en faisant de l’opprimée dans sa pensée à lui un sujet libre et égal dans sa pensée à elle (elle consent).
On peut noter la reproduction d’un type de raisonnement décelé chez E. Ardener attribuant aux femmes bakweri elles-mêmes ce qui était leur rejet par les hommes dans le monde du sauvage, de la nature (cf. Mathieu 1973 [chap. II, supra]). Que les femmes soient ici, avec Godelier, rejetées au contraire dans un excès de privilège culturel n’empêche pas qu’une fois de plus nous soyons pensées hors de la société réelle, hors des déterminations matérielles et psychiques de notre conscience — autrement dit hors de nous-mêmes.
Comme le dit Christiane Rochefort (1971) dans sa « Définition de l’opprimé » :
« L’oppresseur qui fait le louable effort d’écouter (libéral intellectuel) n’entend pas mieux.
Car même lorsque les mots sont communs, les connotations sont radicalement différentes. »
Mais les mots eux-mêmes, justement, sont loin d’être toujours communs entre l’oppresseur et l’opprimé. On notera que si du côté de la pensée dominante (hommes et femmes) on parle volontiers de domination (et de consentement), du côté des mouvements de femmes on parle plutôt d’oppression (et de coopération, ou même de « collaboration »).
Le mot « domination » porte l’attention sur des aspects relativement statiques : de « position au-dessus », telle la montagne qui domine ; d’« autorité », de « plus grande importance ». Tandis que le terme oppression implique et insiste sur l’idée de violence exercée, d’excès, d’étouffement — ce qui n’a rien de statique… du moins jusqu’au moment de l’anesthésie, du coma, de la mise à mort ou du suicide.
Intéressante aussi est la différence entre le mot « consentement » et le mot « collaboration » (de classe) utilisé depuis longtemps et repris notamment par certaines tendances des mouvements de femmes.
La « collaboration » (travailler avec, mais aussi travailler pour) peut certes être active, consciente, et même politiquement délibérée comme pour les pro-nazis pendant la guerre et sous l’Occupation. Elle peut aussi exister objectivement, pour des bénéfices limités, mais sans la pleine conscience des conséquences de ses actes pour lui-même par le sujet (telles ces Allemandes pro-nazies sous le troisième Reich qui « militaient » aussi pour les droits, y compris économiques, des femmes… et subirent les interdictions professionnelles imposées aux femmes en tant que telles ; cf. Thalmann 1982, et notamment les stratégies du parti vis-à-vis des femmes).
Le « consentement » suppose déjà la conscience pleine, libre, du sujet et au moins la connaissance des termes du contrat, sinon de toutes ses conséquences (or les femmes, comme j’ai tenté de le montrer, n’en connaissent pas tous les termes). Quant au « consentement à la domination », il impliquerait la connaissance pleine et entière de la situation et l’acceptation des conséquences, y compris des conséquences destructrices, du contrat… Autant dire que l’opprimé s’opprime, ce qui est une idée finalement assez courante, avec les connotations de « masochisme » que cela évoque47.
Le terme consentement, apparemment plus anodin, est donc en fait, appliqué au sujet opprimé, plus fort et plus grave que le mot pourtant violent mais plus objectif de collaboration. On peut alors se demander pourquoi il fait moins peur, il « passe » mieux, il est mieux agréé par beaucoup de femmes que le mot collaboration. je vois à cela plusieurs raisons :
1. Le mot consentement appliqué aux dominé(e)s annule quasiment toute responsabilité de la part de l’oppresseur. Puisque l’opprimé consent, il n’y a rien de véritablement immoral dans le comportement du « dominant ». L’affaire est en quelque sorte ramenée à un contrat politique classique.
2. Le mot collaboration, en tout cas dans le contexte européen de l’après-nazisme, contexte loin d’être oublié, suppose une conscience mauvaise (moralement répréhensible) tant de la part du dominant que du dominé, alors que le mot consentement suppose une conscience… tout court. Et de quoi l’opprimé a-t-il le plus besoin pour survivre, sinon de pouvoir se dire que ce qu’il vit, il le décide, il le fait, il le reconnaît comme part de lui-même ?
Ainsi, avec le terme consentement, d’une part la responsabilité de l’oppresseur est annulée, d’autre part la conscience de l’opprimé(e) est promue au rang de conscience libre. La « bonne » conscience devient le fait de tous. Et pourtant, parler de consentement à la domination rejette de fait, une fois de plus, la culpabilité sur l’opprimé(e).
Ils tenaient seulement à le tirer par les cheveux. Ils ne voulaient pas lui faire de mal. Ils lui ont arraché la tête d’un coup. Sûrement elle tenait mal. Ça ne vient pas comme ça. Sûrement il lui manquait quelque chose.
Henri MICHAUX48
- Deux exemples, récents et publics :
– Un ethnologue, examinateur de deux étudiantes présentant un mémoire d’U. V. en ethnologie à l’université de Nanterre (1981) sur la domination masculine et la division sexuelle du travail dans les sociétés de chasseurs-collecteurs : « Pourquoi avoir voulu parler des rapports entre les sexes dans une problématique sur le pouvoir ? Un rapport politique, ça n’existe qu’entre des groupes sociaux, et un groupe social, c’est composé d’hommes, de femmes et d’enfants ! » Et, défendant l’idée d’une simple complémentarité entre les sexes et celles des « avantages » qu’y trouvent les femmes : « Vous verrez quand vous serez mariées et que vous tiendrez les cordons de la bourse ! »
– Une ethnologue, en séance plénière finale du premier Colloque de l’Association française des anthropologues (Colloque international du CNRS : « La pratique de l’anthropologie aujourd’hui », Sèvres,19-20-21 novembre 1981), où tentaient de s’exprimer des ethnologues femmes sur la question des rapports de sexe : « C’est la première fois que j’entends dire que les femmes, qui forment la moitié de l’humanité sont une minorité ! »
Précédement, la présentation du compte rendu de l’Atelier « Anthropologie des femmes et femmes anthropologues » fut la seule à susciter dans l’Assemblée ce qu’il est convenu d’appeler des « mouvements divers ». Nous eûmes le plus grand mal, l’après-midi, à faire simplement passer au vote la motion suivante :
« Compte tenu du souci des anthropologues de l’A.F.A. ici présents :
1. de respecter les droits et l’autonomie des minorités ;
2. de mettre en cause l’emprise de l’idéologie dominante sur la science anthropologique ;
3. de poursuivre des voies de recherches et de critique susceptibles de jeter une lumière nouvelle sur les rapports humains et leurs transformations passées, présentes et futures ;
Nous proposons qu’à l’avenir tous les membres de l’A.F.A., lors de leur participation à des rencontres scientifiques, formelles et informelles, accueillent avec le respect accordée à d’autres courants minoritaires et d’autres chercheurs qui parlent au nom de groupes opprimés, les interventions émanant d’anthropologues féministes et qu’ils encouragent une attitude semblable de la part de tous leur collègues. »
(Motion présentée par Mona Étienne, Research Associate à la New School for Social Research, New York. Adoptée (Pour : 60 – Contre : 3 – Abstentions : 15). Séance plénière du samedi 21 novembre après-midi. Cf. Bulleting de l’AFA, juin 1982, 8 : 36 ; Paris, Maison des Sciences de l’Homme.)↩
- Un exemple, pris chez ces défenseurs de l’Autre qui prétendent se fonder sur la critique de la société occidentale : « Mais c’est surtout, pour nous Européens, à l’intérieur même de la citadelle occidentale que le combat décisif doit être mené. La négation de l’autre commence avec la prétention d’une classe à la totalité. […] Plus rien à voir avec l’exotisme ou l’indigénisme qui faisaient de l’autre une extension de notre moi le plus conventionnel. Un aussi petit pays que la France est plein d’autres, ouvriers, paysans, manœuvres, artistes, dont est bafoué le droit d’inventer leur propre existence. La civilisation du multiple, qu’il nous incombe d’édifier sur les ruines de l’actuelle société post-coloniale, sera le comble de la différence » (Monod 1970-1971 : 1120 ; mes italiques). Ainsi donc, même dans l’idéologie de la « différence » (particulièrement pernicieuse pour les minoritaires), on peut ne pas citer les femmes sans doute est-ce qu’il s’agissait là de défendre… le droit d’inventer sa propre existence.↩
- Cf. par exemple Dumont (1978 : 88, note 6) à propos des récentes informations de la presse sur les mutilations sexuelles des femmes : « Voilà, n’est-ce pas, un cas où l’anthropologie est directement en cause, et où elle ne peut ni rejeter en bloc les valeurs modernes qui fondent la protestation, ni endosser simplement la condamnation prononcée, qui pourrait constituer une ingérence dans la vie collective d’une population. Idéalement, nosu voilà donc obligés d’établir dans chaque cas, selon sa configuration propre, sous quelles formes et dans quelles limites l’universalisme moderne est justifié à intervenir. »↩
- Je donnerai dans cet article au mot « féminisme » le sens courant et minimal de : analyse, faite par des femmes (c’est-à-dire à partir de l’expérience minoritaire), des mécanismes de l’oppression des femmes en tant que groupe ou classe par les hommes en tant que groupe ou classe, dans diverses sociétés, et volonté d’agir pour son abolition. J’estime en effet ne pas avoir à exposer ici les débats politiques internes aux mouvements de femmes concernant les définitions et les tactiques. Mais il est utile de signaler dès à présent que les mêmes divergences de politiques « féministes » se retrouvent de pays en pays, qu’ils soient développés ou non, et capitalistes ou non.↩
- Voir par exemple la manière dont le Bureau de l’Association française des anthropologues a introduit, dans son Bulletin n° 4 (février 1981), un texte sur la question des mutilations sexuelles : « Sans refléter nécessairement la position du Bureau de l’AFA, il [ce texte] a le mérite de montrer comment, de faire, un certain féminisme ressucite aujourd’hui l’arrogance moralisatrice du colonialisme d’hier » (p. 37, mes italiques). Pour une réponse de femmes occidentales, soulignant entre auteurs que les féministes ont d’abord dénoncé la barbarie de l’Occident vis-à-vis de ses propres femmes (contrairement aux racistes qui n’ont dénoncé que celle des autres), cf Echard & Mathieu 1982 ; et pour une réponse de femmes africaines, cf Modefen 1982.
On peut aussi se poser la question de savoir si, lorsque les représentants du colonialisme ont interdit l’esclavage dans certains pays africains par exemple, il y eut beaucoup de voix de protestation chez les ethnologues, au nom de la « non-ingérence ». Les féministes, elles, n’ont pas le pouvoir d’interdire quoi que ce soit : elles soulèvent un voile de silence, à quoi l’ethnologie a largement participé en se cantonnant, au niveau théorique, à l’analyse du seul symbolisme culturel des mutilations sexuelles féminines et masculines.
Sur la mutilation génitale des femmes occidentales, sous forme de la généralisation inquiétante de la pratique chirurgicale de l’épisiotomie (coupure du périnée pendant la phase finale de l’accouchement) sur laquelle les femmes n’ont aucune de pouvoir de décision et qu’on leur fait « accepter » en leur inculquant la peur des « risques » de complications, cf. Coquatrix 1983. Or : « Dans le cas du Québec, si l’on considère qu’en fait seulement 10 à 15% des accouchées présentant de réelles complications auraient vraiment besoin d’une épisiotomie, on s’aperçoit que chaque année plus de 70.000 femmes représentant 80 à 90% des accouchées pourraient rentrer chez elles le corps intègre alors qu’en fait ce même nombre élevé de femmes subissent une épisiotomie et quittent l’hôpital le corps douloureux » (p. 74). L’auteur met en cause, entre autres, le contexte économique etorganisationnel des hôpitaux (dont le gain de temps et d’argent pour les médecins-accoucheurs) ainsi que les représentations de la femme comme un corps à « corriger » dans les ouvrages d’obstétrique. Ce qui n’est pas sans intérêt de rapprocher de la dimension « corrective » de l’excision partagée à la fois par les idéologies africains et les ethnologues occidentaux (Sindzingre 1977), et les aliénistes du XIXe (Sindzingre 1979).↩
- Le mépris et l’ignorance de la sociologie (après en avoir bien sur miraculeusement abstrait Mauss, Durkheim, et pour certains Marx et Althusser) très généralement affichées par les éthnologues de l’exotique auraient-ils un lien, de nos jours, avec la menace professionelle que fait justement peser sur eux l’autonomie ou l’indépendance des peuples opprimés, ou, du moins, puisque néocolonialisme il y a, le désir de ces dernier de faire leur propre… sociologie et histoire ? Il semble qu’on assiste en effet à un début de « concurrence » entre sociologues et ethnologues sur le terrain…occidental.↩
- Or, que les femmes soient un peuple, une gent, une ethnie ou une « race », et les hommes une autre (supérieure), nombre de sociétés le pensent ainsi ! Cf. par exemple Loraux (1978) sur la race des femmes, génos gyanaikôn : « Car c’est de celle-là [de la première femme] qu’est sortie la race des femmes en leur féminité. D’elle est sortie la race maudite, les tribus des femmes » (Théogonie). Ainsi, dit N. Loraux, « la première femme de la Théogonie n’est pas la « mère de l’humanité », mais la « mère » des femmes. Voilà qui nous entraîne très loin de la femme reproductrice, ce mal nécessaire » (pp. 44-45).
Pour les Peul Djelgôbé, Riesman (1974 : 198-199) parle de « ce qu’on pourrait appeler la relation « inter-ethnique », entre l’ »ethnie » des femmes et l’ »ethnie » des hommes. Ce rapport concerne tous les hommes et toutes les femmes, quels que soient les liens de parenté entre eux, lorsqu’un membre d’un sexe se trouve en présence d’un membre de l’autre en public […] Dans ces cas, tout se passe comme si chaque femme représentait la Femme, et que chaque homme représentait l’Homme. Chacun ressent la honte et la peur devant l’Autre, mais pour des raisons légèrement différentes. Devant l’Homme, la Femme craint d’être mise à sa place, c’est-à-dire, dans une position d’infériorité, tandis que l’Homme, devant la Femme, craint de se révéler incapable de tenir la place supérieure que lui accorde la structure sociale uniquement parce qu’il est homme […] Dans ces conditions, la conduite observable des deux sexes est presque identique. La seule chose qui révèle une différence de sentiment est le fait que la peur des femmes est plus évidente leurs yeux deviennent plus gros, par exemple , alors que les hommes cachent la leur dans une attitude de bravade. »
Ceci dit, je laisse à Riesman ses euphémismes : « les raisons légèrement [!] differentes » de la honte et de la peur de l’Homme et de la Femme… tout comme ses subtiles distinctions sur la virtualité et réalité de l’inégalité dans un cas particulier de ce rapport inter-ethnique, les relations de mariage en public : « D’un côté, l’inégalité entre l’Homme et la Femme reste virtuelle dans la mesure où chacun accomplit ses tâches traditionnelles sur sa propre initiative et sans avoir reçu l’ordre de le faire. Mais, de l’autre côte, cette virtualité peut à tout moment devenir réelle si le mari donne un ordre à sa femme en public [une demane de services personnels]. Alors, la seule façon qu’a la femme de montrer sa solidarité à l’homme est de lui obéir. »
Du côté de la sociologie des minorités nationales, et pour des analyses, d’aillleurs diverses, des rapports entre appartenance de groupe de sexe et appartenance de groupe « ethnique » cf. le numéro spécial « Ethnicity and Feminity » de la revue Canadian Ethnic Studies / Études ethniques au Canada, vol. XIII, n°1, 1981. Comme le disent Danielle Juteau-Lee et Barbara Roberts (Introduction, p. vii) : « … what is often refereed to as » ethnicity » in Canada, is a social construct in much the same way femininity is ».↩
- Voir aussi C. Michard-Marchal & C. Ribéry (1982, et 1985 : 147-167) décelant chez des femmes ethnologues quelques utilisations de la dénomination ethnique générale (les N…) en parlant des seules femmes, ce qui ne se produit pas chez les locuteurs masculins ; le terme est en revanche constamment utilisé par tous (hommes et femmes) à propos des seuls hommes.↩
- Cf. Marx et Engels dans L’Idéologie allemande (1975 : 88) : « [La division du travail] se manifeste aussi dans la classe dominante sous forme de division entre le travail intellectuel et le travail matériel, si bien que nous aurons deux catégories d’individus à l’intérieur de cette même classe. […] À l’intérieur de cette classe, cette scission peut même aboutir à une certaine opposition et à une certaine hostilité des deux parties en présence. Mais dès que survient un conflit pratique où la classe tout entière est menacée, cette opposition tombe d’elle-même […]. »↩
- Gramsci, dans Littérature et Vie nationale, comparant la culture comme conception du monde de la classe dominante au folklore comme culture de la classe dominée, oppose les aspects élaborés, systématiques, centralisés, unitaires, explicites, intégrés de la première aux aspects a-systématiques, morcelés, multiples, fragmentaires, implicites, inorganiques, disséminés de la seconde, bref, un ensemble intégré à une combinaison indigeste d’éléments juxtaposés. Je remercie Paola abet d’avoir attiré mon attention sur ce point ; analysé par Cirese (1976).↩
- Mais le livre de Freeman est éminemment contestable en ce que son but principal et explicite est — à travers Mead — de discréditer l’école du « déterminisme culturel » de Boas (qui s’était développée face au social-darwinisme biologisant de Galton), et d’appeler de ses vœux une « meilleure articulation explicative du biologique et du social » … Or, démontrer que Sarncia est une société hautement hiérarchique, violente, et répressive quant à la sexualité, et non un paradis de liberté et de jouissance, n’entame en rien le point de vue culturaliste ! Le viol s’explique suffisamment comme rapport de force social.
Ce livre est bien sûr contesté par des anthropologues américains : cf. par exemple E. Leacock (1983) qui, outre des distorsions dans la présentation des écrits de Mead et la faiblesse de certaines « contre-preuves » développées par Freeman, dénonce une certaine politique de la Harvard University Press, qui publia déjà Arthur Jensen et E. O. Wilson…↩
- Ainsi la société des hommes pourra-t-elle « effacer » un viol (en disant que la femme était consentante) si la vengeance théoriquement requise risque d’avoir des conséquences jugées politiquement inopportunes. On en trouvera un exemple dans un article de J. Favre (1968) sur la manipulation de la violence en Kabylie entre 1830 et 1870. Parmi les diverses « solutions » possibles, une fois la femme prétendue consentante : « [Le tuteur de la femme] peut aussi faire lapider les amants par l’assemblée, solution moins prestigieuse, mais intéressante car elle fait l’économie d’un cercle de représailles. » L’effacement du viol — outre le choc qu’on peut supposer qu’il provoque dans l’esprit de la (des) femme(s) — entraîne donc, on le voit, la « solution » finale de la victime…
Certes, vis-à-vis des hommes aussi, il peut y avoir, en cas de meurtre, manipulation politique des faits, traitement de la contradiction momentanée entre deux normes sociales, mais on notera ici que pour la personne du coupable homme existent parfois physiquement des possibilités de délai (par exemple, la fuite ou le bannissement) qui sont bien entendu hors de question pour la victime femme dans l’exemple cité. Coupable ou non la mort est plus immédiate pour elle…
D’autre part, sur le viol comme logique sociologique, cf. le tract « Justice patriarcale et peine de viol » (1977).↩
- Sur les femmes battues, cf. par exemple MacLeod 1980. Sur le viol, cf. par exemple parmi les plus récentes publications aux USA, Russell & Howell 1983. Effectuée sur un échantillon de 930 femmes à San Francisco, leur enquête révèle que 44% de ces femmes avaient violentées sexuellement au moins une fois (viols « effectifs » : completed rape, plus tentatives de viol), dont la moitié plus d’une fois. Un calcul de probabilité (par life-table analysis) montre qu’il y a une probabilité de 46% pour qu’une femme soit victime de viol ou de tentative de viol à un moment de sa vie, et une probabilité de 26% pour le viol « effectif » (précisons que cette définition était la définition officielle, très restrictive). La tranche d’âge la plus « vulnérable » aux attaques sexuelles se situe entre 16 et 24 ans.
Russell & Howell expliquent — avec une forte vraisemblance pour toute femme ayant eu des entretiens avec d’autres femmes sur le sujet — la différence entre leurs chiffres et ceux, beaucoup plus faibles, d’autres enquêtes, par la manière dont ont été conduites leurs interviews, qui tendait à diminuer le plus possible ce qui est pour les femmes le problème spécifique du viol : l’« underdisclosure », la sous-divulgation d’un secret, due à la honte de la victime. (Il est aussi noté que la formulation même des questions dans certaines enquêtes nationales sur les crimes empêche les femmes de parler du viol.) Russell & Howell estiment que leurs résultats confirment largement ceux d’un autre chercheur (A.G. Johnson 1980 : 146) qui avait été critiqué pour avoir trouvé une probabilité de 20 à 30%, et en avoir conclu : « It is difficult to believe that such widespread violence is the responsability of a small lunatic fringe of psychoptthic men.That sexual violence is so pervasive supports the view that the locus of violence against women rests squarely in the middle of what our culture defines as « normal » interaction between men and women » — ce que, rappellent Russel & Howell, des féministes avaient analysé dès les années 70. Cf. aussi Carrier 1980 ; Schwendinger 1983.↩
- Je dis bien jeunes hommes, et non jeunes gens. Il est intéressant de noter que le mot « gens », en principe générique, est totalement résorbé dans le masculin lorsqu’il s’agit des « jeunes ». Plus que ce qu’on appelle l’absence des femmes dans le discours, c’est l’absence des jeunes filles (notamment dans les discours en sciences humaines et en ethnologie) qui me paraît le plus significatif, mais ceci serait l’objet d’un autre développement. Voir aussi que ce sont les jeunes garçons qui ont le maximum de latitude pour exprimer les valeurs d’une société (par exemple, l’agressivité à l’égard des étrangers, ou des femmes) — les adultes étant liés par des considérations plus pratiques (peur de la police, ou intérêt personnel à ne pas manifester à une femme son mépris profond, etc.).↩
- Je remercie la Comitelle, groupe d’étudiantes en anthropologie de l’Université de Montréal, pour la communication de cette coupure de presse.↩
- NDE via le Wiktionnaire : Scotomiser 1. (Psychologie) Rejeter inconsciemment de sa conscience une réalité pénible. 2. Omettre intentionnellement.↩
- Je ne parlerai pas ici des contraintes sur la sexualité et la reproduction — où le physique et le mental sont le plus inextricablement liés —, dont traitent les articles de P. Tabet, de N. Echard et de O. Journet publiés dans L’Arraisonnement des femmes, 1985. Or ces « contraintes » (et le mot est faible) — dans la mesure où elles s’exercent sur le sujet opprimé dans un rapport de force global qui inclut aussi l’oppression économique, juridique et politique — peuvent être considérées comme l’un des plus sûrs facteurs de la dépossession de soi qui atteint les femmes en tant qu’individues et en tant que groupe social.↩
- NDE via le Wiktionnaire : 1. (Anthropologie) Relatif au système de filiation dans lequel chacun relève du lignage de son père.↩
- NDE via le Wiktionnaire : Virilocal 1. Qui vit chez les parents du mari, en parlant des couples, des familles qu’ils forment.↩
- NDE via le Wiktionnaire : viriarcat 1. (Néologisme) (Sociologie) Situation de domination des hommes, qu’ils soient pères ou non, sur les femmes.↩
- Inutile de multiplier les exemples. À chacun de le voir (et de le comptabiliser) dans les sociétés qu’il connaît. Une ethnologue me disait récemment de son terrain africain : « À cette heure-là, inutile d’aller dans le village, on ne peut voir personne, tout le monde fait la sieste. » Devant mon œil interrogatif, elle ajouta quand même « ….enfin, sauf les femmes. »
Notons seulement que lorsque la disproportions traditionnelle entre le nombre d’heures de travail respectives des femmes et des hommes se conjoint à l’exploitation spécifique des femmes par le patriarcat capitaliste moderne, on peut atteindre des extrémités à la limite du pensable. Tel est le cas des dentellières à domicile de la région de Narsapur en Inde (Bisilliat Fiéloux 1983 : 72-73 ; mes italiques), dont « la journée de travail, rémunérée et non rémunérée […] est de 15 heures environ » : « Si dérisoires soient-ils, les salaires des Minutas sont indispensables, dans 50% des cas, pour faire survivre leurs familles. L’homme, seul, ne peut y parvenir. Par rapport à la contribution de la femme, de l’ordre de 23%, celle de l’homme est évidemment plus importante, mais non pas en raison d’heures de travail plus nombreuses. Au contraire, les hommes ne travaillent que 8 heures par jour pendant six mois alors que les femmes travaillent 14 heures par jour pendant douze mois. La différence vient du fait que le travail masculin est mieux rémunéré : en six mois, l’homme gagne 900 roupies, et la femme seulement 90 roupies. » Cf. aussi Michel 1983.↩
- Communication personnelle. Je remercie Jacques Lizot d’avoir répondu à mes nombreuses questions sur les femmes yanomami, tout en admettant mes critiques et objections.↩
- NDE via le Wiktionnaire : Diachronie 1. Transformations des faits linguistiques dans le temps.↩
- Des exemples et références sont donnés dans l’article de Alice Kehoe et Dody H. Ciletti (1981) : « Women’s preponderance in possession cults : the calcium-deficiency hypothesis extended ». Sans être entièrement d’accord avec cet article, qui rejette trop légèrement les explications « politiques » de la possession chez les catégories opprimées, je pense qu’il était important de souligner l’incidence nutritionnelle, comme le font les auteurs pour les « attaques involontaires » : tremblements, tétanie, etc. (qu’elles distinguent très nettement des « transes volontairement induites » dans les cultes). Que des crises puissent être déclenchées par les carences nutritionnelles des « pauvres », dont surtout les femmes, n’est pas du tout exclusif du fait que certains types de possession puissent aussi répondre à des conflits sociologiques et psychiques, dus également à l’oppression ! (Sur les rapports des femmes à la possession, cf. par exemple Constantinides 1978, Corin 1981, Dupré 1978, Echard 1978, Ferchiou 1972, O’Connell 1982, Vincent 1979.)↩
- Cf. Jemison 1978. Le Récit de Livie de Mrs. Jemison enlevée par tes Indiens en 1755 à l’âge de 12 ans fut publié pour la première fois en 1824, et eut de nombreuses rééditions. Mary Silernison fut adoptée par une famille seneca, de la Confédération des Iroquois (matrilinéaires25 et, en principe, matrilocaux26). Elle eut deux maris, huit enfants dont sept vivants, et vécut parmi les Indiens jusqu’à sa mort.↩
- En revanche, l’auteur cite une information de Counts (1980) sur Kallai, où les cas de suicides masculins concernaient des hommes qui n’étaient pas parvenus à… exercer leur autorité sur les femmes.↩
- NDE via le Wiktionnaire : Matrifocal 1. Qualifie un type d’organisation familiale centré autour de la mère.↩
- Pour nous, il ne s’agit pas de « La Mort » abstraite, psychanalytiquement conçue (mais réellement appliquée — en plus, sans résultat bénéfique, nous précise-t-on !) par un Moi qui aurait des problèmes avec sa « paternité ». Il s’agit de l’assassinat de femmes, c’est-à-dire de gens dont on peut disposer. Il se trouve que, là ou ailleurs, les femmes, qui ont des problèmes avec la maternité, n’en assassinent pas pour autant les hommes avec une telle régularité statistique. Voilà, sociologiquement, quel est le fin mot de l’histoire. On voit qu’à la limite, si « la mort » est jugée excessive par l’auteur, c’est… pour l’assassin.↩
- Si les conflits « d’autorité » pour les hommes ont été élevés au rang de problème théorique, les conflits d’impuissance pour les femmes n’ont pas ce privilège, puisqu’ils « fonctionnent » bien pour les sociétés structurellement masculines. Le « puzzle matrilinéaire » réside pour l’homme dans la disjonction entre le rôle qu’il doit maintenir dans son lignage maternel d’appartenance et l’autorité qu’il doit acquérir sur une épouse et des enfants qui lui sont « étrangers » — autorité en retour limitée par celle des hommes du groupe de filiation de l’épouse (limitation extrêmement variable dans les faits selon les sociétés matrilinéaires ; cf. Schlegel 1972 pour une analyse cross-culturelle de l’autorité respective du mari et du frère de la femme dans l’unité domestique).
Mais je dirais volontiers que pour la femme, en sociétés patrilinéaires, patri-virilocales et fortement viriarcales, la conjonction entre : la séparation de son lignage paternel d’appartenance, le fait qu’elle n’avait de toute façon qu’un rôle limité à y jouer, le fait qu’elle produise des enfants étrangers, comme simple courroie de transmission mâle dans le lignage de son mari, et le fait que tout le travail qu’elle accomplit par ailleurs n’est considéré que comme une annexe de son travail de procréation, tout cela crée ce qu’on devrait bien appeler le puzzle patrilinéaire. Puzzle qui pour la femme se présente, non sous la forme de pièces d’autorité à assembler, mais sous celle d’un bloc compact d’autorité imposée, d’où il lui faut tenter de détacher (notamment par ce qu’on appelle « stratégies féminines ») quelques parcelles pour former une sorte de « Moi mineur ».
A. Schlegel (1972 : 140-141) évoquait aussi la possibilité d’un « « patrilineal puzzle » for women in a patrilineal society, creating a pull between love and duty to her lineage and her children » . Mais ceci me semble encore trop pris dans un raisonnement de symétrie entre l’homme (en matrilinéaire) et la femme (en patrilinéaire). Les « loyalties » de la femme envers son lignage patrilinéaire ne consistent souvent qu’à bien démontrer qu’il a fourni à l’autre une bonne reproductrice. Quant aux liens aux enfants, qui sont ceux de son mari, ils seront plus forts chez la femme, objectivement et subjectivement, que tout lien avec son propre lignage…↩
- NDE via le Wiktionnaire : Fidéicommis 1. (Droit) Disposition par laquelle un testateur charge son héritier institué de conserver et de rendre à une personne désignée la totalité ou une partie des biens qu’il lui laisse, soit au bout d’un certain temps, soit dans un certain cas.↩
- Ce sous-titre comme ceux qui le suivent se réfèrent bien entendu à l’analyse qu’on peut faire de la conscience des femmes pour nombre de sociétés, et dont je ne donne ici qu’un exemple — et à travers des rêves. L’exposé qui suit reflète la manière dont j’ai lu les données de S. Leine, tout en étant généralement d’accord avec ses interprétations. L’auteur elle-même suit un schéma d’analyse élaboré en ethnopsychologie dont je n’ai pas repris l’ordre d’exposition ni nécessairement la problématique.↩
- Faut-il alors s’étonner si ces jeunes femmes se trouvant dans la période la plus « stressante » de leur vie sont, comme le note l’auteur, « hautement conservatrices » — ce qui est, rappelons-le, un des phénomènes les plus frappants dans l’oppression (… et permet entre autres à certains de parler de « consentement ») ? Faut-il donc exiger — dans des sociétés elles-mêmes hautement conservatrices — et devant un tel état d’impuissance objective, matérielle et mentale, que ces opprimées aient en plus l’imagination sociologique d’une société futuriste ?↩
- Qu’on me permette cette liberté avec le français mais le passif anglais (was divorced by) est en l’occurrence plus exact pour la femme.↩
- S’agissant de la médiatisation et de l’envahissement de la conscience du sujet-femme par l’omniprésence, l’omnipotence de l’homme, eût-il deux mois, je me réfère surtout dans cet article, comme je l’ai dit, aux sociétés patrilinéaires et/ou fortement viriarcales.
J’émets toutefois l’hypothèse qui fera l’objet d’une élaboration ultérieure — qu’en sociétés matrilinéaires (même viriarcales), la maternité de filles, la production de femmes par des femmes, c’est-à-dire la reproduction de son propre sexe, donc de soi-même, doit avoir une incidence différente sur la conscience de soi. Je parle ici du statut de sujet et non du statut du sujet (la « position sociale des femmes » ), que nous allons aborder infra, et dont on sait qu’il n’est pas forcément « meilleur » en sociétés matrilinéaires, surtout virilocales. (Les variations de l’autorité du mari sur l’épouse — cf. Schlegel 1972 et note 23 ci-dessus — y sont toutefois beaucoup plus grandes qu’en sociétés « patrilinéaire dures », selon l’expression de Echard, Journet & Lallemand 1981,)↩
- Je n’aborderai pas systématiquement dans cet article les questions touchant à la différence, et aux rapports, entre conscience « sexuelle » de l’individue, conscience de groupe de sexe (ce que j’appellerais « identité sexuée ») et conscience de classe de sexe (là où elle existe), dont j’avais donné une première ébauche dans une communication antérieure (« La conceptualisation du sexe dans la pratique des sciences sociales et dans les théories des mouvements de femmes », Symposium 33 « Strategies for Women’s Equality », Xe Congrès mondial de Sociologie, Mexico,août 1982).
La différence entre conscience « de groupe » et conscience « de classe » concernant les sexes est particulièrement importante à élucider, non seulement pour connaître les conditions possibles ou non d’apparition de la seconde selon les sociétés (par exemple sociétés « mixtes » ou ségréguées — et quelle « ségrégation » ?…) et leur évolution historique, mais aussi pour l’analyse des diverses manières dont les ethnologues traitent des « résistances » des femmes. Certain(e)s parlent trop aisément de « féminisme » (il semble que l’utilisation de ce terme devienne « plaisante » — sinon ce qu’il suppose), d’autres sous-estiment le sens véritablement politique de certaines révoltes, même individuelles. Mais justement, il semble nécessaire, pour comprendre les formes de résistances, d’avoir pris la mesure de la conscience dominée.↩
- Devenir chamanesse est une voie contrecarrée chez les femmes, parce qu’elles sont destinées à vivre dans le patrilignage de leur époux, et feraient courir un danger aux deux patrilignages : « … en l’emportant [son essence chamanique] chez son mari, elle fait courir un risque tant à sa famille d’origine qu’à sa belle-famille. En effet, son essence chamanique consistant en un droit à des rapports privilégiés avec les ancêtres chamans de son patrilignage, elle peut en tirer parti au détriment de l’une comme de l’autre lignée en coupant de chaque essence ses représentants masculins ; le chaman, lui, n’appartient qu’à un groupe social ». (Hamayon 1979 : 133). (Ajoutons que « aucune chamanesse n’exerce de fonctions lignagères ou claniques » ibid., n. 21)
Enfin, sans vouloir faire de généralisation hâtive, en l’absence d’une étude approfondie sur la qestion, remarquons au passage que dans une société matrilinéaire et matrilocale comme les Coajiro (frontière de la Colombie et du Venezuela), six chamanes sur sept sont des femmes (cf. Perrin 1976 : 118). (Le rapprochement entre ces deux aspects de la société goajiro est de mon fait, non de l’auteur.)↩
- Bien que les camps de concentration aient également servi des buts économiques (et bien que l’oppression des Juifs ait été liée à des exclusions ou des impositions économico-professionnelles au cours de l’histoire), il n’y avait pas au préalable exploitation économique des Juifs, ni des homosexuels, ni des Tziganes en tant que tels (ce qui permettait donc de concevoir leur extermination), alors que de la colonisation, de l’esclavage et du « sexage » (selon le terme de Guillaumin 1978a et b), l’exploitation des outils vivants fait partie intégrante. Certes, on en sacrifie quelques-uns, pour l’exemple, en cas de révolte, mais point trop. Et si l’on tue moins de femmes que d’esclaves ou de colonisés masculins, c’est bien par calcul démographique et économique.↩
- À propos de scarifications certes, dans certaines sociétés africaines, les hommes aussi portent de splendides scarifications, notamment sur le visage, qu’on peut trouver très érotiques. Disons tout de suite que le nombre de ces scarifications n’atteint pas le degré que l’on peut trouver, là ou ailleurs, pour les femmes.
Mais voyons d’autre part comment un ethnologue africaniste parlait récemment des scarifications des femmes, en réponse à une question sur « l’érotisme vécu » et soi-disant non transposé en art (??) en Afrique « Certaines cultures de l’Afrique centrale favorisent un apprentissage érotique des femmes ; celles-ci portent des tatouages en relief, destinés non seulement à avoir une efficacité symbolique, mais à favoriser l’excitation et le plaisir du partenaire. L’érotisme n’a donc pas à être nommé, puisqu’il est ; il n’a pas à être raconté, puisqu’il est pratiqué ; il n’a pas à être montré, puisque chacun sait qu’il fait partie de la vie » (interview de C. Balaridier, Le Monde du dimanche, 20 février 1983).
Tout est dit dans la contradiction (qui n’en est pas une pour les hommes) et la véracité (pour les hommes) des formules soulignées par moi. Cet érotisme-là nous semble au contraire avoir besoin d’être nommé, et autrement : apprentissage érotique desfemmes ou apprentissage des femmes eux l’érotisme des hommes ?↩
- Chez les Gisu, c’est l’accouchement qui est explicitement considéré comme l’équivalent de la circoncision des hommes pour rendre adulte, notamment par l’épreuve de la souffrance, un être auparavant immature. Mais les hommes estiment — et les femmes ne les contredisent pas, du moins en public — que accouchement est une agonie bien moins dure (!)… si bien qu’il ne permet pas pour autant aux femmes d’être en cela les égales des hommes, note J.S. La Fontaine (1972).
L’exaltation de l’accouchement comme analogue au courage du guerrier est aussi un thème assez fréquent (cf. par exemple Loraux 1981). Analogie sans doute, équivalence non ! Enfin, le courage est quand même permis aux femmes dans la maternité, seul domaine où elles ne soient pas vraiment en concurrence avec les hommes (du moins dans les faits, car on sait la leur reprendre sur le plan symbolique…).↩
- Or il s’agit plutôt de singulier et pluriel inversés : la Liberté et les lois, pour la gauche ; les libertés et la Loi , pour la droite (je remercie Colette Capitan Peter d’avoir attiré mon attention sur ce point). Cette double opposition est déjà un agencement idéologique de notions de référence qui, de ce fait, n’ont plus le même contenu ni le même rapport entre elles, ne sont donc plus les « mêmes » représentations.↩
- Roméo et Juliette, acte V, scène I. « Ma pauvreté consent, mais contre ma volonté », dit l’apothicaire remettant, au risque de sa vie, le poison à Roméo contre une bourse de quarante ducas. À quoi Roméo, le puissant, qui ne se fait pas davantage d’illusions, répond : « Je paie ta pauvreté, et non ta volonté. » C’est aussi la pauvreté, l’impuissance physique, technique et mentale, savamment entretenues, des femmes (et des exploités en général) que les hommes paient par de (maigres) bénéfices secondaires.↩
- Et ce, dès la petite enfance, dès la structuration inconsciente de sa personne, bien avant qu’elle ait la moindre idée des idées légitimant la domination masculine, et des « services » que lui rendraient les hommes… L’apprentissage est précoce et continu des petites filles à servir les autres (« aider », au travail domestique, etc, disent pudiquement les descriptions ethnographiques) et s’accompagne dans de nombreuses sociétés du constat, qu’elles enregistrent, qu’on demande moins (et pas le même genre de choses) aux garçons de leur âge.
Enfin, dans certaines sociétés, on peut trouver un apprentissage très matériel du service au mari. Ainsi chez les Yanomami (Lizot 1976 : 210) : « La femme de Kiyêkô n’a pas plus de six ans, elle vit avec ses parents. Lorsque Kiyêkô est revenu de la forêt, les beaux-parents envoient la petite lui apporter un paquet de plantains rôtis. On la voit traverser le camp, hésitante, se perdre parmi les abris, regarder craintivement les adultes qui la guident, tendre le paquet à son gaillard d’époux, allongé avec nonchalance, et s’en retourner sans mot dire. »
Tout ceci bien sûr n’empêche pas d’admettre la thèse générale de Godelier selon laquelle les idées légitimantes sont efficientes (et non simple reflet) dans la formation et le maintien d’un rapport de domination ; mais l’analyse des instances ou des fonctions est une chose, dont la sociologie de la conscience n’est pas non plus le simple reflet.↩
- Ce qui est le cas de nombre d’intellectuelles occidentales ; sur la haine de soi poussée au point que « les femmes se sentent [même] indignes d’être opprimées », cf. Delphy 1977 : 46.↩
- Il ajoute en note que le même processus se trouve à la base de la « conjuration du malheur » « « Quel bonheur, il y a longtemps que je n’ai pas eu ma migraine ! » Mais c’est le premier indice de l’accès qu’on sent venir, auquel, cependant, on ne veut pas encore croire. » Ceci fait penser à ces femmes qui vous répètent « je suis heureuse, je suis heureuse (d’être à nouveau enceinte) » , et dont il est clair qu’elles conjurent par là la crise pressentie de leur mariage, qui ne manque guère d’arriver.↩
- Si on le trouve d’ailleurs, quoique très rarement, dans la littérature militante des femmes, c’est qu’il s’agit là, en même temps que d’analyses, d’exhortations politiques au « réveil », à l’action.↩
- « Le postulat de l’identité des contraires garantit à tout instant à Hegel une solution interne, imaginaire, aux contradictions internes qu’il analyse et cette solution n’est le plus souvent qu’une opération magique, idéologique au sein d’une dialectique « simple » » (Godelier 1977, t. II : 103-104).↩
- Masochisme au sens banalisé. Mais, à mon avis, le masochisme n’est pas une simple demande de souffrance ou d’objectivation, mais une tentative du sujet aliéné d’agir en tant que sujet — par la mise en scène (dans les fantasmes) ou la mise en faits (dans l’actualisation), bref par la théâtralisation d’un vécu réel de l’agression et de l’objectivation qu’il ne peut maîtriser dans la réalité sociologique, et que le personnage, la persona, tente de penser, de réprésenter↩
- L’arrachage des têtes, Un certain Plume (1931), in L’Espace du dedans, Paris, Gallimard, 1941 : 120.↩
P.S.
Paru en 1991 dans l’ouvrage L’Anatomie politique. Catégorisations et idéologies du sexe, de Nicole-Claude Mathieu.